
Voir rapport en 2023.
Il s’est écoulé plusieurs années avant que je me décide à documenter un sujet qui, pourtant, concerne notre santé, notre style de vie et notre « vivre ensemble »… La survie de l’espèce humaine serait même menacée : « Nous roulons sur une autoroute qui mène à un enfer climatique, avec un pied sur l’accélérateur », déclarait Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, à l’ouverture de la COP 27, le 7 novembre 2022.
Longtemps, je m’étais contenté de garder sous le coude des articles, des liens vers des blogs, ainsi qu’une pile d’ouvrages accusés de « climato-scepticisme ». C’est de cette littérature qu’il est question ici, dédouanée de toute forme de dissonance cognitiveN1. Les écrits sérieux et documentés se prêtent à un examen critique, dédramatisé, du discours sur le climat.
Quelles sont donc les vraies causes du changement climatique ? Soyons clair : je vais parler des causes, et non des conséquences…
Pour un accès immédiat à des documents qui font débat, suivre les liens de la section Pétitions et déclarations.
Avertissement : toute prise de parole sur « le climat » s’expose à une tentative de disqualification entendue des centaines de fois dans les débats francophones : « Mais vous n’êtes pas climatologue ! » Je me demande si les auteurs de tels commentaires savent en quoi consiste le métier de climatologue… Le physicien François Gervais ouvre quelques pistes (Moranne JM, 2024aA184 p. 4) :
Le mot-clé « climatologie » est l’un des 55 qui définissent le champ d’application des enseignements et des recherches dans le cadre de la section 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale du Conseil National des Universités. Autant les universités savent définir, pour éventuellement le recruter, les compétences d’un mathématicien, d’un physicien, d’un chimiste, d’un biologiste, d’un géographe, autant la climatologie apparaît-elle ainsi à sa vraie place, une sous-discipline de la Géographie parmi 54 autres. Combien d’auteurs des rapports du GIEC, le Groupe d’Experts (traduction un peu pompeuse du titre anglais “Panel”) Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, justifient-ils d’une thèse en climatologie ?
Mais, après tout, c’est sans importance : quand des journalistes, des politiciens ou des militants (souvent très jeunes) relaient avec autorité un message sur la « crise climatique », personne ne s’autorise à les questionner sur leur culture scientifique et technique. En tout cas, pas moi.
Les arguments d’autoritéN2 servent à court-circuiter tout débat avec les réfractaires à une doctrine, exposée avec passion, qui s’impose à la manière d’un embrigadement. Chacun accuse le camp opposé de « complotisme », un autre verrou de l’esprit critique.
Le terme « embrigadement » peut choquer. Mais je le crois approprié, certainement dans la continuité du « Nous sommes en guerre » proclamé par le Président Macron en mars 2020, au début de la crise sanitaire causée par la circulation du virus SARS-CoV‑2. Car, si l’on doit faire face à une crise climatique, il est légitime de se mobiliser pour entrer en rébellion…
Documenter le discours sur le climat m’est apparu bien plus difficile que suivre au jour le jour la « crise sanitaire » — voir mon article Coronavirus — discussion. Ce sujet est plus vaste, plus technique, plus étendu historiquement, et potentiellement porteur d’enjeux sur le très long terme. Malheureusement, trop de journalistes se contentent de surfer sur l’immédiat, empruntant les éléments de langage aux porte-voix de « La Science », à l’occasion d’événements météorologiques extrêmes annoncés presque chaque jour depuis l’été 2023…
Le discours sur le climat a envahi le champ du politique sous une forme qui ne tient compte, ni de la complexité des données, ni des incertitudes des « modèles climatiques ». On pourrait le résumer, au mieux, en trois mots : « objectif zéro carbone »… Les adversaires de ce camp « climato-alarmiste », qui brandissent surtout des arguments économiques (voir plus bas), ont tendance à rejeter en bloc toute mesure environnementale. Cette polarisation du débat fait passer au second plan — si ce n’est aux oubliettes — les risques avérés et quantifiables de l’activité humaine. Pour en citer quelques-uns, en vrac : production de substances toxiques, mauvais recyclage des déchets, dégradation des sols agricoles, pollution de l’eau, perte de biodiversité, disparition des pollinisateurs et de la faune marine, bétonisation des espaces urbains…
Les articles et ouvrages qui ont retenu mon attention ne sont pas de simples « billets d’humeur ». Les opinions des experts — que leurs détracteurs accusent d’être « autoproclamés » — ne m’intéressent pas. Pour la plupart, ce sont de médiocres extraits, interprétés et extrapolés de manière invérifiable, de Résumés pour les décideurs (SPM) des rapports du GIEC (Gervais F, 2022A94 p. 145).
L’absence de sources scientifiques, dans les articles de presse, exclut toute analyse critique : après tout, aux yeux de Gabrielle Maréchaux, le « climatoscepticisme » n’est rien d’autre qu’un banal jeu de séduction (2024A166) ! Quant à la lecture intégrale d’un rapport du GIEC — 2408 pages pour l’AR6 du Groupe 1 (2021N3) —, elle exigerait beaucoup de temps, et surtout de solides compétences dans l’intégralité des domaines couverts par la littérature scientifique dont il présente une synthèse. Mes informateurs, pour la plupart issus des « sciences dures », n’ont pas peur de manipuler des équations différentielles… Je n’irai pas aussi loin !
Je me suis intéressé à des ouvrages ou des articles dont les contenus sont étayés par des liens vers des sources primaires — autrement dit, des publications de revues scientifiques à comité de lecture. Exit Wikipedia et son culte des données secondaires, comme expliqué dans ma présentation…
Surprise agréable : les pages de nombreux sites climato-réalistes sont ouvertes aux commentaires. On apprend parfois plus en les lisant que dans les articles qui les ont motivés… Après tout, « faire de la science » c’est, entre autres, dialoguer avec celles et ceux qui expriment des avis divergents, pourvu qu’ils s’appuient sur des données vérifiables.
J’invite les lecteurs de cette page à faire de même : suivre les liens, consulter les articles, dialoguer avec leurs auteurs, lire (en entier) quelques-uns des ouvrages cités, pour revenir s’exprimer en public dans les commentaires.
Greta Thunberg nous supplie : « Écoutez les scientifiques ! » (2019A286). Eh bien, c’est précisément ce que nous allons faire…
La suite de cet article n’est pas transcrite oralement. Il n’est pas possible d’aborder ce sujet sans avoir sous les yeux le texte, les images, et les liens vers les sources !
Sommaire
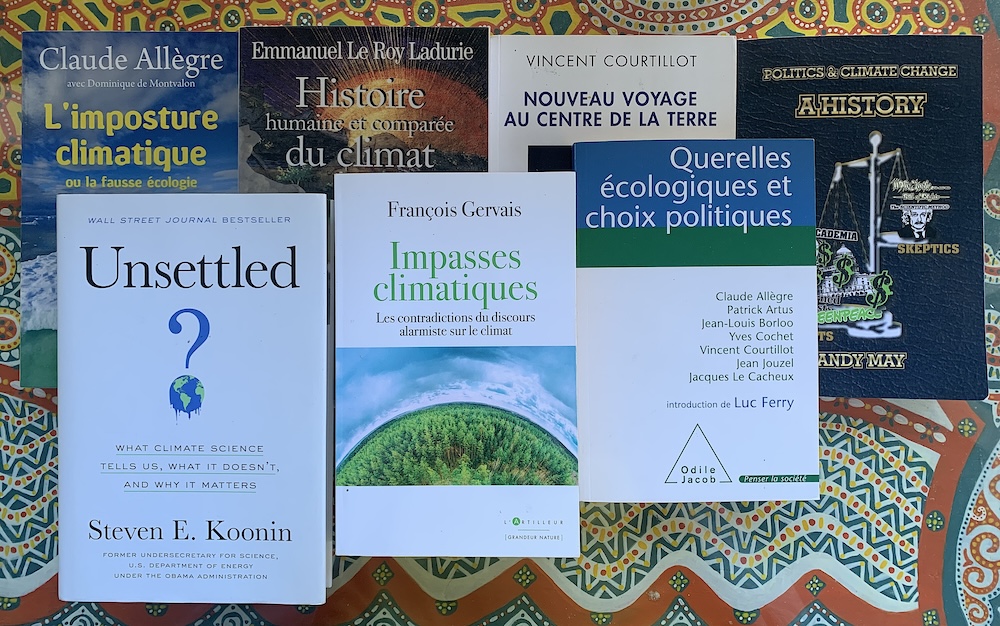
Ajouter (Moranne JM, 2024bA185 ; Curry JA, 2024A52 ; May A, 2020A173) et plus de 300 références citées au bas de cette page…
Malgré mon aversion pour les vidéos, j’ai placé dans ce texte de nombreux liens positionnés vers des passages de films de Martin Durkin (2007A67 ; 2024A68). Ceci afin de montrer quelques images des auteurs cités — par exemple John Clauser (2024A68 06:03). Toutefois, j’en ai détesté les premières minutes qui invitent à une lecture troublée par les émotions, et pour finir une critique caricaturale du militantisme écologique (voir ci-dessous).
Autres vidéos intéressantes, les émissions « complotistes » Corruption Climatique (Citizen Light, 2025aA41 ; 2025bA42) où se sont exprimés Jean-Marc Bonnamy, Drieu Godefridi, Daniel Husson, Rémy Prud’homme, Camille Veyres et Michel Vieillefosse. Toutefois, la diversité des opinions insuffisamment étayées — en raison du format « table ronde » — nuit un peu à la cohérence du discours.
⇪ Le GIEC et Al Gore, Prix Nobel 2007
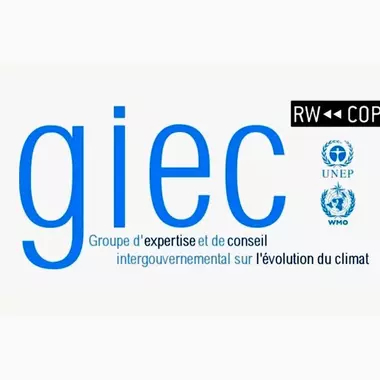
En 1988 a été fondé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le contexte historique et politique de cette fondation est exposé plus bas.
Le terme anglais Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ne contient pas le mot « expert », qui en français peut prêter à confusion. En effet, cet organisme ne dirige pas des travaux scientifiques. Il est chargé de documenter et synthétiser toute la littérature ayant trait au changement climatique.
À l’origine, le document “Principles Governing IPCC Work” précisait que le GIEC (IPCC) avait pour mission d’étudier le risque du changement climatique causé par l’activité humaine. La mention de ce lien de causalité a disparu par la suite, une fois établi « par consensus » que l’activité humaine — comprenez, les « gaz à effet de serre » — était la principale cause du réchauffement de la Planète. Nous verrons plus bas quelle est la réalité de ce consensus.
Le lien de causalité est clairement énoncé dans l’article premier de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992A201 p. 5) :
On entend par « changements climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
Autrement dit, sans l’activité humaine, il n’y aurait pas de changement climatique. Guillaume de Rouville commente de manière imagée (2024A57 p. 31, 34) :
Avant l’homme, il y avait le climat, sans changement(s). Un climat sage et obéissant aux constantes de l’univers, se balançant comme le pendule d’une horloge bien rythmée entre des bornes naturelles acceptables pour les Dieux, les plantes et les animaux de la Terre. Un équilibre primordial. Puis vint l’homme, et le climat sortit de ses limites naturelles pour entraîner avec lui le balancier (originellement) tempéré dans une course folle le précipitant vers les enfers anthropiques d’un dérèglement sans fin. […]
En quelques phrases et deux articles, des juristes et technocrates internationaux ont ainsi réussi à tuer définitivement la science climatique et à imposer une théorie axiomatique du climat qui ne laisse guère de place à la recherche, à la controverse et au débat contradictoire. Les « experts » et « scientifiques » du climat du monde entier ont été mis (ou se sont mis volontairement) au service d’une norme juridique dont l’aspect normatif l’emporte sur les frontières ouvertes de la science.
La thèse alarmiste du « CO2 qui réchauffe la planète par effet de serre » a été postulée, à la fin des années 1960, par des personnes en vue comme comme Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome, dans la lignée du rédacteur en chef du journal Science, Philip Hauge Abelson (1967A2). Ils reconnaissaient Svante August Arrhenius (1896A11), prix Nobel de Chimie en 1903, comme un précurseur de cette théorie, bien que l’inexactitude de ses propositions ait été démontrée par ses pairs (Poyet P, 2022A221 p. 32–34). Le terme (inapproprié) « effet de serre » a été utilisé en premier par Nils Gustaf Ekholm (1901A73).
Sur cette page, on utilise « CO2 » pour désigner le gaz carbonique que les chimistes écrivent « CO2 ». Cette simplification est passée dans l’usage.
À la même époque que Peccei, des auteurs comme Carroll E Wilson et William Matthews avaient attribué la variation du climat à des causes naturelles, ou à l’influence humaine, avec une réserve pour ce qui est du rôle du gaz carbonique (1971A315 p. 112) :
Pour déterminer l’effet d’une augmentation de la concentration de CO2 sur la température de surface, il faut d’abord démontrer que les changements de CO2 affecteront le bilan radiatif dans le système terre-atmosphère. Ensuite, s’il n’y a pas d’autres ajustements simultanés ou couplés dans d’autres variables que celles de l’équilibre (telles que la teneur en eau de l’atmosphère, la nébulosité ou la couverture neigeuse) en raison du changement de l’équilibre radiatif qui pourrait être causé par l’augmentation du CO2, l’effet des changements de CO2 sur la température atmosphérique moyenne globale à l’équilibre pourrait être prédit par ce modèle.
Lire The Birth of the Environmental Movement (Poyet P, 2022A221 p. 402–412) pour plus de détails historiques sur la mise en place des politiques environnementales. Dans son ouvrage Politics and Climate Change, a History (2020A173), Andy May donne une quantité d’informations cruciales sur les acteurs institutionnels dans le monde anglophone.
En 2010, les gouvernements sont tombés d’accord sur la nécessité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin que le réchauffement planétaire soit inférieur à 2 °C à la fin du siècle. Ce seuil a été réévalué à 1.5 °C selon l’Accord de Paris à la COP 21 (2015).
La climatologue Judith A Curry a écrit à ce sujet (2024A52 p. 39–40, 461–462 ; 2023A51 p. 10–11, 297) :
La validité scientifique de cet objectif de 2 °C a été contestée. Carlo Jaeger, spécialiste du développement durable, a décrit la façon dont cette limite a été définie de façon ad hoc et contradictoire — les décideurs politiques la considérant comme une découverte scientifique et les scientifiques comme une approche politique. Elle a été présentée comme un seuil séparant le domaine de la sécurité de celui de la catastrophe, et une stratégie optimale du juste équilibre entre les coûts et les bénéfices [Jaeger C & J Jaeger, 2010A123]. […]
Aucun seuil (ou point de basculement) à grande échelle du climat n’a été clairement lié à un réchauffement planétaire de 2 °C. Le réchauffement planétaire moyen n’est pas le seul changement climatique potentiellement dangereux, et les gaz à effet de serre comme le CO2 ne sont pas la seule cause d’un changement climatique dangereux. Certains seuils potentiels ne peuvent être liés significativement au changement de température planétaire, étant d’une nature plus régionale, d’autres sont surtout sensibles aux gradients spatiaux du changement de température. […]
Il y a encore quelques années, une trajectoire d’émissions conforme au RCP 4.5, avec un réchauffement de 2 à 3 °C, était considéré comme une réussite de la politique climatique. Comme limiter le réchauffement à 2 °C semble faisable (maintenant présenté comme le « seuil de la catastrophe »), l’objectif a été revu en 2018 — il s’agit désormais de limiter le réchauffement à 1.5 °C [Masson-Delmotte V, 2018A168].
Un récit incisif a fait l’objet du chapitre 6 de L’imposture climatique (Allègre C, 2010A9 p. 163–218). Ouvrage de 294 pages, grand prix de la Société de géographie en 2010, mais qui, selon certains commentateurs — sans plus de précisions — contiendrait « plus d’une centaine d’erreurs scientifiques graves » ! Merci de me les signaler… ?
Le GIEC regroupe (en 2023) 195 États dont les représentants ont un droit de vote identique. Son mode de fonctionnement fait apparaître les décisions comme autant de consensus dans l’interprétation d’articles scientifiques sélectionnés par des groupes d’experts.
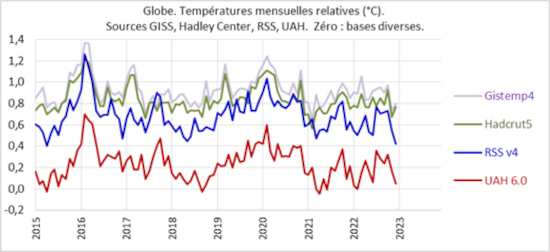
Le terme « consensus » s’est imposé dans le discours sur ce qui a été appelé, successivement, « réchauffement climatique », « changement climatique », puis « dérèglement climatique », « crise climatique », enfin « urgence climatique » et même « effondrement climatique »… Cette dérive du vocabulaire est le reflet d’une croyance de plus en plus infaillible en l’effet sur le climat des activités humaines : industrie, agriculture, transports, chauffage urbain, nutrition, etc. Une issue apocalyptique que les humains ont le pouvoir (et le devoir) de contrecarrer en luttant avec acharnement contre le réchauffement climatique.
Aux yeux du public — et des décideurs politiques, appuyés par les médias — le consensus est un gage de vérité, bien qu’il se situe aux antipodes d’une démarche scientifique, laquelle consiste à soumettre toute hypothèse à l’épreuve du réel. Cet examen procède d’une réflexion critique, examinant avec une attention particulière les faits qui paraissent contredire l’hypothèse.
Le mythe d’un consensus de « 97.1 % de scientifiques » (Cook et al., 2013A47) a été clairement démonté par David R Legates et ses collègues (2015A149). Il est fréquemment recyclé, avec la même comptabilité puérile, par exemple par Mark Lynas et al. (2021A161) qui parviennent à 99 % : les auteurs ont mis dans le consensus en faveur de l’origine humaine du réchauffement climatique les 70 à 80 % d’articles qui pourtant ne parlaient pas d’une origine humaine du réchauffement climatique, ou qui ne parlaient même pas de réchauffement climatique. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas « contre » sont nécessairement « pour » ! Sans surprise, le même pseudo-raisonnement appliqué avec le biais inverse — « contre » par défaut — aboutit au résultat inverse…
Cette recherche de consensus a poussé le GIEC à privilégier les « scénarios de climat » produits par les modèles mathématiques des climatologues, balayant du revers du coude leurs détracteurs et ses propres contradictions (Masson H, 2019A169) :
En inférence statistique, quand après un calcul de courbe de régression, les résidus ne sont pas constants et négligeables, on conclut que le modèle est imparfait et l’on change de modèle. Le GIEC, lui, interprète la non-constance des anomalies de température en clamant que c’est le système climatique qui dérive, tout en gardant une confiance aveugle dans ses modèles.
Claude Allègre écrivait (2010A9 p. 182) :
[…] à partir de là, les choses vont s’accélérer. Avec une méthode qui ne va jamais se modifier et fera ses preuves : le consensus entre les membres d’un petit groupe d’initiés, d’un côté ; la disqualification, l’opprobre, puis l’exclusion de ceux qui sont tenus pour des déviants parce qu’ils émettent — osent émettre ! — une opinion divergente. C’est la pratique de l’ostracisme grec, celle qui a poussé Thémistocle à devenir l’allié des Perses. Ce qui veut dire que, hors du groupe restreint, le débat est interdit.
L’ouvrage Impasses Climatiques (Gervais F, 2022A94) expose clairement les dysfonctionnements du GIEC qui révèlent une approche pseudoscientifique du sujet. L’auteur, physicien, avait été accrédité par le GIEC comme expert reviewer des deux plus récents rapports AR5 (en 2013) et AR6 (en 2021) dont il avait signalé — sans être entendu — les erreurs et contradictions (2022A94 p. 145–158). Depuis cette « mutinerie », François Gervais est catalogué « climatodénialiste » et « complotiste » (cf. Wikipedia) alors que ce professeur émérite à l’Université de Tours a dirigé un laboratoire du CNRS (UMR 6157). Ancien conseiller scientifique du Pôle de compétitivité Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique, il est médaillé du CNRS en thermodynamique et lauréat du prix Ivan Peyches de l’Académie de sciences. Excusez du peu !
Un autre personnage dérangeant, récemment mis sur la touche, est l’un des trois lauréats du Prix Nobel de physique en 2022, John Clauser. Il préside la CO2 coalitionN4. Lire à son sujet un article de Mattias Desmet, ainsi que la traduction d’une conférence à L’Irish Climate Science Forum, le 8 mai 2024, titrée : Le thermostat des nuages est le mécanisme dominant de contrôle du climat qui stabilise le climat de la Terre ; le récit catastrophique du GIEC est un mythe (Clauser J, 2024A45, voir vidéo).
En 2007, le prix Nobel de la paix avait été conjointement attribué au GIEC et à l’ancien vice-président des États-Unis d’Amérique, Al Gore (Albert Arnold Gore), suite à la diffusion de son film An Inconvenient Truth (2007A4) (Une vérité qui dérange). Ce documentaire alertait de manière spectaculaire sur les effets dramatiques du réchauffement de la Planète causé par l’activité humaine. Selon cette « vérité », le changement climatique serait attribué principalement à l’effet de gaz à effet de serre, savamment décrit comme un forçage radiatifN5.
Le film d’Al Gore était construit sur, au minimum, neuf affirmations mensongères (Moranne JM, 2024bA185 p. 33–35) dont il sera question plus bas dans cet article. Par exemple, des images montraient Manhattan submergé sous six mètres d’eau… Les films de Martin Durkin (2007A67 18:40) et de Simon Clark (2023A44) peuvent être vus comme des réponses à celui d’Al Gore.
Claude Allègre rappelle la suite (2010A9 p. 74) :
Pour le reste, il n’est pas sans intérêt de savoir qu’Al Gore a été condamné par la Haute Cour de Londres et le juge Burton pour diffusion de fausses preuves scientifiques, et qu’en conséquence le film d’Al Gore n’a pas pu être projeté en Grande-Bretagne dans les écoles sans un avertissement préalable identifiant neuf erreurs (décision de janvier 2007). La presse française n’a pas fait état, sur le coup, de cette mise en garde, ce qui en dit long. De nombreux journaux n’ont appris la nouvelle, semble-t-il, que beaucoup plus tard, la relayant lorsqu’Al Gore et son film avaient disparu de l’actualité.
Q : Pour le commun des mortels, n’est-il pas singulier qu’on donne un prix Nobel — certes pas un prix Nobel scientifique — à un homme qui a fait un film en utilisant, à vous suivre, des arguments faux ?
C’est le sentiment de beaucoup de scientifiques, consternés par le choix des Nobel. M. Jouzel a, en revanche, affirmé, lui, que le film était excellent et que ce qu’il montrait était vrai.
On peut rire des prédictions farfelues d’Al Gore — qui a récidivé en 2017 avec Une suite qui dérange (2017A5) — et de la naïveté de son public, mais la France aussi a eu, au sommet de l’État, des clowns tristes de l’alarmisme climatique : le 28 septembre 2015, le Président François Hollande avait osé dire, à la 70e session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, que les tsunamis et les tremblements de terre étaient un effet du réchauffement climatique (Hollande F, 2015A116) !
L’année 2007 était aussi celle du rapport AR4N6 du GIEC, dont les erreurs ont par la suite été reconnues publiquement (Gervais F, 2022A94 page 146) :
Répété à l’envi par le président du GIEC et par le secrétaire général des Nations Unies, l’AR4 a affirmé que le réchauffement climatique pourrait réduire la production agricole africaine de 50 % d’ici 2020. Le problème est qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Le GIEC avait simplement réitéré une affirmation douteuse issue, non d’un article publié dans une revue internationale à comité de lecture, mais d’une brochure publiée par une ONG. Le responsable du groupe de travail du GIEC a été contraint d’admettre en 2010 que l’affirmation n’était nullement étayée.
Le dioxyde de carbone (CO2) était seul dans le viseur. Par chance (pour les technocrates), le bilan carboneN7 de toute activité humaine peut être calculé, puis inscrit dans le circuit économique sous la forme de taxes carboneN8 et de quotas d’émissionN9. Ce n’est pas le cas, par contre, du protoxyde d’azote N2ON10 jugé 298 fois plus « polluant » que le CO2, et dont une source importante, bien que non mesurable en quantité, serait la culture du riz sous inondations intermittentesN11 (Kritee K et al., 2018A143).
⇪ Histoire d’eau

Enfin et surtout, les calculs cités par le GIEC faisaient abstraction de l’eau, sous forme de vapeur et de nuages, principal gaz à effet de serre (Lindzen R, 2018A153 p. 5). François Gervais écrit à ce sujet (2022A94 p. 79–80) :
Après une nuit sous une couverture nuageuse, la température matinale reste proche de celle de la veille au soir. En revanche, après une nuit sans nuages, elle est généralement beaucoup plus fraîche que celle de la veille au soir. L’écart d’énergie associé à ces changements de température est considérable, beaucoup plus que la contribution raisonnablement attribuable aux émissions de CO2. C’est le cycle de l’eau et ses composantes vapeur et nuages qui régulent le climat de la Terre. Un changement de la couverture nuageuse ou de la distribution de types de nuages, ou de la proportion de vapeur d’eau, est capable de contrebalancer l’effet du CO2 comme l’ont montré Dübal et Vahrenholt (2021A70).
Ces mécanismes ont été exposés en détail par Henrik Svensmark et Eigil Friis-Christensen (1997A278), ainsi que Patrice Poyet (2022A221 p. 124–127) qui écrit :
On pourrait même dire que le climat est déterminé par la quantité de pluie reçue, mois après mois, par n’importe quelle région de la Terre, et ni la théorie CAGW [catastrophic anthropogenic global warming] ni les modèles de circulation généraleN12 (GCM) associés ne sont bons pour faire des prévisions à cet égard (Koutsoyiannis, 2008A139). Le régime spatial et temporel des précipitations est une conséquence de l’organisation de la circulation atmosphérique, dont le « but » est le transfert de la vapeur d’eau des zones tropicales vers les hautes latitudes où elle se condense et alimente le rayonnement de l’air vers le cosmos dans l’infrarouge thermique (OLR, Outgoing Long-wave Radiation), de manière à compenser exactement, « en moyenne » sur l’ensemble du globe et sur quelques semaines, le flux solaire absorbé par le globe.
La vapeur d’eau, qui se précipite sous forme de pluie ou de neige, ne provient souvent pas de l’endroit où il pleut ; elle provient du balayage par les alizés de milliers de kilomètres vers le nord et vers le sud : ces alizés convergent dans la « cheminée équatoriale » ; pour les averses des fronts froids de nos latitudes, la vapeur d’eau vient de milliers de kilomètres au sud-ouest, et elle est transférée vers le nord-est dans le couloir dépressionnaire qui précède les Anticyclones Mobiles Polaires (AMPA297) qui se déplacent, eux, vers le sud-est.
Veyres (2020a p. 157, 62) conclut « que les histoires de “forçage radiatif par les gaz-à-effet-de-serre” sont des inepties et que c’est la teneur en vapeur d’eau de la haute troposphèreN13, et non pas un réchauffement de cette haute troposphère qui détermine et régule le flux infrarouge thermique émis par le globe vers le cosmos. […] Rappelons une fois encore que c’est la quantité de vapeur d’eau autour de 9 km qui assure en quelques heures et quelques jours la régulation du rayonnement du globe vers le cosmos, et qu’il est absurde et contraire aux observations de poser a priori qu’elle va croissant. » Par ailleurs, l’effet régulateur de la vapeur d’eau n’a été correctement évalué par aucun des modèles. La plupart de ses effets sont dus à son opacité dans les régions spectrales des ondes longues. Les contributions relatives de H2O, CO2 et O3 à la réduction du flux sortant d’ondes longues sont très différentes, et l’effet de H2O sur les ondes longues est tellement plus important que les effets de CO2 et O3 qu’il ne laisse aucune chance à d’autres gaz de jouer un rôle réel.
Les mesures de l’humidité atmosphérique dans les régions arides ou semi-arides sont aussi en contradiction avec ce que prédisent les modèles de climat (Simpson IR et al., 2024A264) :
La vapeur d’eau dans l’atmosphère devrait augmenter avec le réchauffement, car une atmosphère plus chaude peut contenir plus d’humidité. Cependant, au cours des quatre dernières décennies, la vapeur d’eau près de la surface n’a pas augmenté dans les régions arides et semi-arides. Cela va à l’encontre de toutes les simulations de modèles climatiques dans lesquelles elle augmente à un rythme proche des attentes théoriques, même dans les régions sèches. Cela pourrait indiquer que les modèles représentent mal les processus liés à l’hydroclimat ; les modèles augmentent la vapeur d’eau pour satisfaire la demande atmosphérique accrue, alors que cela ne s’est pas produit dans la réalité. Étant donné les liens étroits entre la vapeur d’eau et les incendies de forêt, le fonctionnement des écosystèmes et les températures extrêmes, cette question doit être résolue afin de fournir des projections climatiques plus fiables pour les régions arides et semi-arides du monde.
Dans un atelier Nouveaux outils statistiques en hydrologie, lors d’un symposium sur la gestion des ressources en eau, Demetris Koutsoyiannis déclarait (2008A139) :
La recherche hydrologique a apporté des contributions décisives en matière de stochastique (Hurst, Mandelbrot, Hosking), alors que les climatologues utilisent encore des représentations stochastiques simplistes et irréalistes. […]
Traditionnellement, les hydrologues possèdent des compétences qui sont peut-être moins répandues dans la communauté climatologique :
• Le pragmatisme, lié à la formation d’ingénieur ;
• L’expertise dans l’aide à la prise de décision en situation d’incertitude ;
• Une familiarité avec les prévisions à long terme (pour la conception de grands travaux), et en particulier l’impossibilité d’utiliser des approches déterministes pour les réaliser. […]
Un changement de paradigme est nécessaire dans le domaine du climat :
• Des termes et définitions ambigus aux concepts clairs ;
• Des certitudes fallacieuses à la reconnaissance de l’incertitude ;
• Des approches déterministes aux approches stochastiques.
Deux articles de Brigitte Van Vliet-Lanoë et Jean Van Vliet (2022aA296 ; 2022bA297) dressent un bilan de l’influence sur la météo et le climat de phénomènes très importants — pour la plupart non modélisables sur le long terme et sans lien significatif avec l’activité humaine : circulation thermohalineN14 des océans (thermal conveyor belt), irradiance solaire, jet streamsN15, vent solaire, etc. Conclusion en quelques mots :
L’évolution météorologique est une image à très court terme du système climatique : elle n’a de valeur que si on l’intègre dans un contexte au minimum décennal. Madame Soleil (F) et Monsieur Météo (B) ne peuvent pas prédire l’évolution du climat. Encore moins les médias.
Un séminaire de travail sur l’évolution du climat, à l’Académie des sciences, avait accueilli l’intervention de Marcel Leroux sur le thème Les échanges méridiens commandent les changements climatiques (2007A151).
Les perturbations dans la circulation atmosphérique El NiñoN16 et La NiñaN17 échappent aux modèles prédictifs, bien qu’elles aient une influence considérable sur les variations saisonnières de température. El Niño provoque un échauffement, alors que La Niña provoque un refroidissement, mais avec des effets qui peuvent être radicalement différents selon les parties du globe, par exemple une sécheresse au Sahel en même temps que des pluies diluviennes au Brésil (Troude M, 2024A291). Il est courant d’entendre les climatologues admettre qu’ils sont un des principaux vecteurs du changement climatique, tout en ajoutant (sans l’ombre d’une preuve) que ces phénomènes sont « aggravés » par la production de gaz à effet de serre…
⇪ Représentation des données
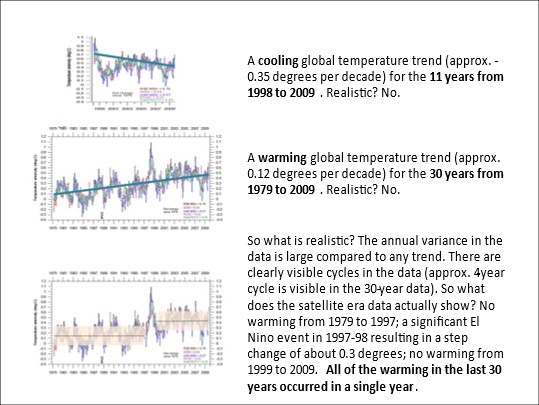
Une première faiblesse du discours alarmiste sur le climat réside dans l’interprétation arbitraire, voire tendancieuse, de données statistiques, s’appuyant sur des modes de représentation simplistes.
Henri Masson (2023A170), par exemple, critique la méthode qui consiste à réduire une série temporelle de mesures à des droites de régression. Le simple choix de l’intervalle temporel permet d’en modifier la pente, et donc la signification en termes d’augmentation ou de diminution. Sur l’image ci-dessus, la régression linéaire des températures de 1979 à 2009 fait apparaître un réchauffement global alors que, de 1998 à 2009, on assisterait à un refroidissement. En divisant l’intervalle en deux sections, on peut faire apparaître une absence de variation entre 1979 et 1997, ainsi qu’entre 1999 et 2009, avec un saut de 0.3 degrés en 1997–1998, résultat d’un événement El NiñoN16. Aucune de ces trois représentations n’est réaliste…
Une méthode plus saine d’analyse d’une série temporelle consiste à rechercher en premier lieu des composantes périodiques en faisant appel à la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation (Masson H, 2023A170 figure 28). Dans l’exemple considéré, quatre composantes présentent une magnitude supérieure à la composante continue (fréquence zéro) qui est de 0.15° C. On peut donc réduire la série à une somme de quatre sinusoïdes et une composante continue : la courbe en rouge ci-dessous. La prolongation de cette courbe suggère un passage par un maximum proche de 0.8°C, qui serait suivi d’un refroidissement.
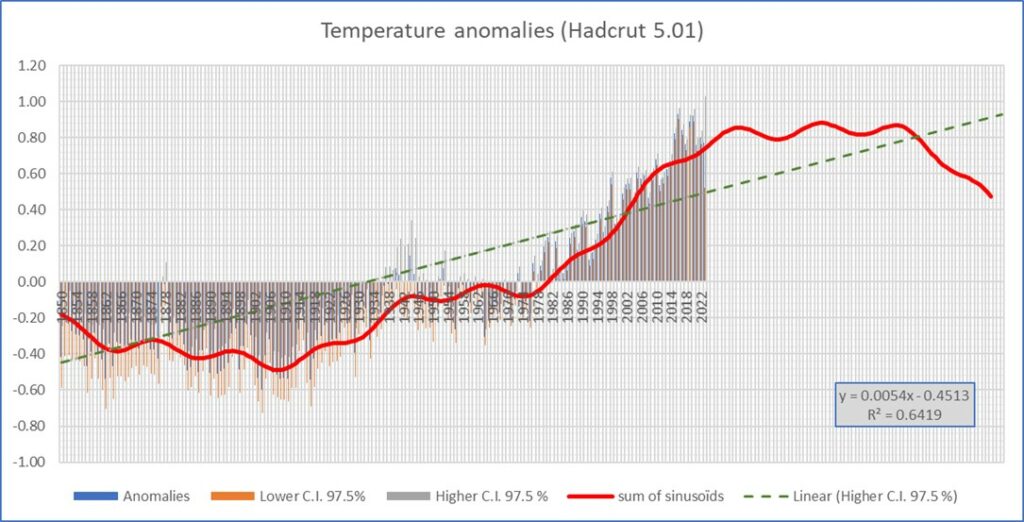
Une mauvaise farce pour ceux qui affirment qu’il suffit de prolonger (linéairement) les observations pour prédire la continuation, ou même une accélération du réchauffement ! Voir à ce sujet le graphique en crosse de hockey de Michael E Mann (1998N18) dont la méthodologie erronée a été signalée par la suite (McIntyre S & R McKitrick, 2003A175, 2005A176 ; Duran J, 2013A66 ; Deheuvels P, 2024A59). Un récit détaillé des procès qui ont eu lieu à la suite et autour de la publication de Mann est donné dans le chapitre 5 (Lawsuits and Climate Change) de l’ouvrage d’Andy May (2020A173 p. 164–198).
Michael Mann s’était entre autres appuyé sur un historique des températures basé sur la mesure des épaisseurs des anneaux de croissance des arbres. Håkan Grudd (2008A102), de son côté, a révélé que l’augmentation d’épaisseur des jeunes anneaux des arbres était un effet de la compaction des anneaux plus anciens, et non la trace d’un réchauffement que Mann aurait donc surévalué. D’autres critiques portent sur le fait que l’article de Gordon Jacoby et Rosanne d’Arrigo (1989A122) ne portait que sur une sélection de dix sites fournissant « le meilleur enregistrement dans le temps et dans l’espace de la croissance des arbres influencée par la température pour cette région de l’Amérique du Nord » (p. 44) alors que 36 avaient été échantillonnés. Les relevés des 26 sites écartés de l’étude n’ont pas été archivés, malgré la demande insistante des éditeurs (McIntyre S, 2023A178).
En l’absence de modèle, l’hypothèse empirique proposée par Masson (courbe en rouge ci-dessus) serait envisageable, et certainement plus que celle d’une droite de régression (en pointillés verts), car le coefficient de déterminationN19 est de 0.907 pour les sinusoïdes et seulement 0.647 pour la droite.
La courbe rouge est en réalité proche de celle de l’Oscillation atlantique multidécennale (AMON20), une variation de la température de surface de la mer sur un cycle d’environ 65 à 70 ans (Schlesinger ME & N Ramankutty, 1994A252). François Gervais écrit à ce sujet (2022A94 p. 109) :
Le refroidissement de la Terre observé de 1945 à 1975 […] a principalement concerné l’hémisphère nord, comme le montrent de nombreuses études […]. L’AMO est justement observée dans l’Atlantique Nord, et l’oscillation était en phase de refroidissement durant cette période. Elle n’est pas la seule. La comparaison avec l’Oscillation [multidécennale du] Pacifique (PDON21) est confondante, dans la mesure où une phase froide est également observée de 1947 à 1976 (figure 2.10).
Plus globalement, les indices AMO et PDO apparaissent synchrones avec la série de températures HadCRUT4N22. Tous trois confirment une phase montante récente. Si ces cycles se poursuivent, ils devraient être suivis par une phase descendante dans les quelque trente ans à venir.
Judith Curry écrit (2024A52 p. 192–193 ; 2023A51 p. 116) :
La plupart des analyses ont identifié l’Oscillation atlantique multidécennale (AMO) comme jouant un rôle déterminant sur la température de la planète. On a estimé son impact sur les températures moyennes de surface de 0.3 à 0.4 °C [Chylek P et al., 2016A40]. Le climat est dans la phase chaude de l’AMO depuis 1995 ; en 2021, vingt-six ans s’étaient donc écoulés depuis le dernier basculement. L’analyse des données historiques et paléoclimatiques suggère que le retour à la phase froide devrait se produire dans les douze prochaines années (vers 2032), avec une probabilité de 50 % qu’il survienne dès les cinq prochaines années (vers 2026 [Enfield DB, 2006A75]).
François Gervais (2022A94 p. 110–111) :
Scafetta (2021aA247) [voir traduction 2021bA248] identifie plusieurs cycles supplémentaires d’amplitudes toutefois moindres. Il montre surtout, par une analyse de Fourier, que le cycle d’environ 60 ans et les autres sont remarquablement corrélés à la vitesse du soleil par rapport au centre de masse du système solaire (Scafetta N, 2009A244). Le cycle principal d’environ 60 ans implique les deux planètes les plus massives, Jupiter et Saturne, selon que leurs orbites respectives autour du soleil les amènent ou non proches, avec des conséquences gravitationnelles sur la boule de gaz déformable qu’est notre étoile, qui s’ajoutent si elles sont proches, ou non. Scafetta et al. (2020A251) considèrent toutefois d’autres explications possibles à ces observations, toutes plus naturelles les unes que les autres, du moins sans aucun lien avec les émissions de CO2.
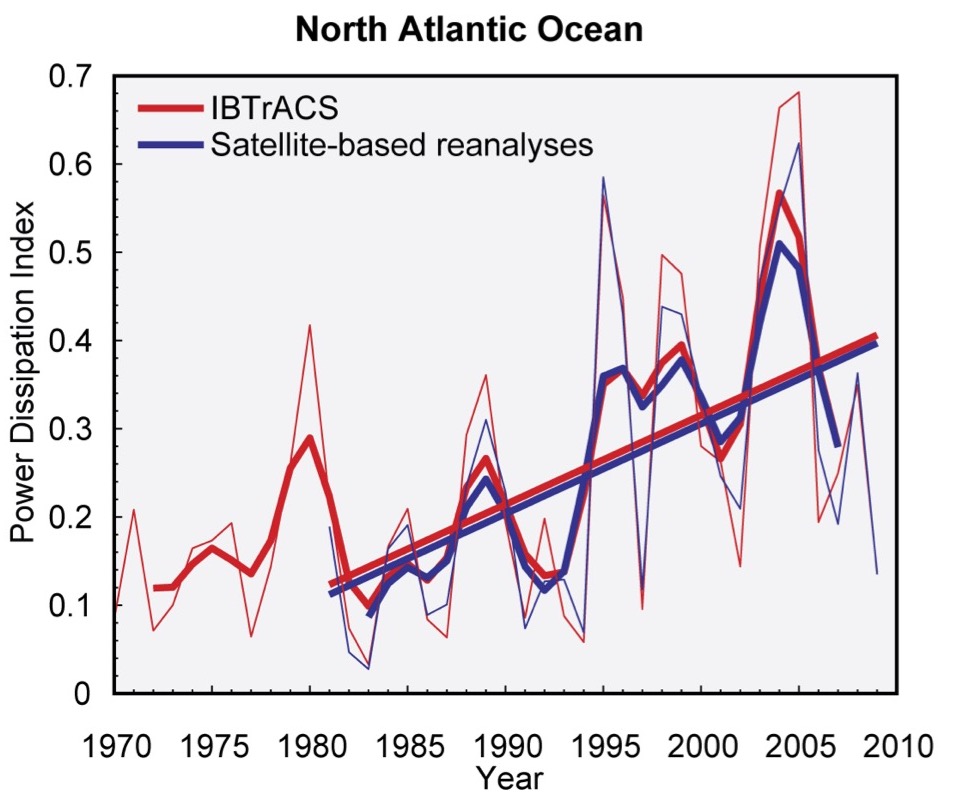
La réduction d’une série temporelle à une droite de régression dans le sens souhaité — en choisissant pour cela les dates de début et de fin — révèle un tel amateurisme qu’on est en droit de douter que des « experts du climat » y aient recours. Or cette manipulation des données a été utilisée pour représenter l’indice de puissance dissipée par les ouragans dans l’Atlantique Nord, de 1981 à 2005. Ceci afin d’étayer, dans les rapports de la science du climat aux États-Unis (CSSR, 2014N23 p. 20), la prédiction d’un accroissement du nombre et l’intensité des ouragans en Atlantique Nord (Koonin SE, 2021A135 p. 116–121). Cette prédiction n’était pas celle, entre autres, de James B Eisner et collègues (2006A74 page 92).
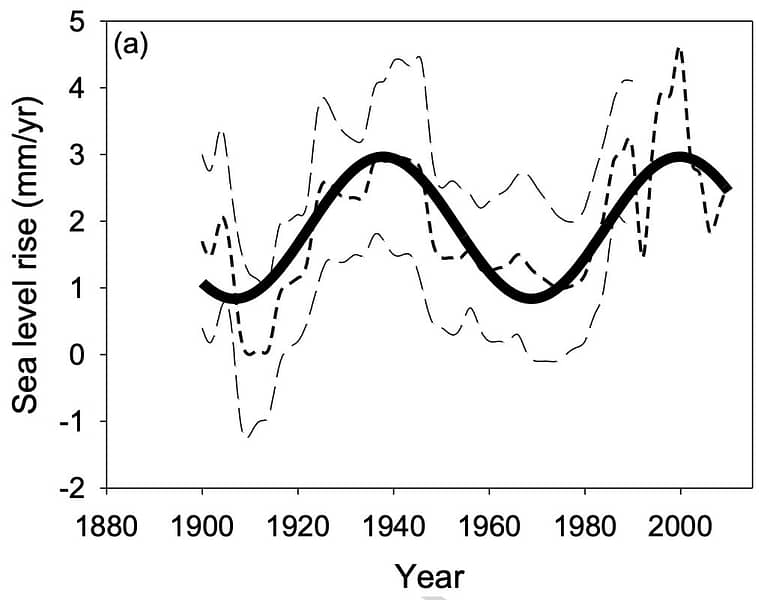
Un autre exemple de régression sinusoïdale faisant apparaître une périodicité a été présenté par François Gervais (2016A91). La figure ci-contre représente l’évolution de l’incertitude sur les valeurs supérieures et inférieures de la hausse du niveau des océans rapportées par les marégraphes, selon la figure 3.14 du rapport AR5 (2013) du GIEC. La courbe en trait gras est une régression par une sinusoïde de période 62 ans. Elle fait apparaître, sur la période 1900 à 2000, une hausse annuelle moyenne variant entre 1 et 3 millimètres.
Cette oscillation a été confirmée par Thomas Frederikse et al. (2020A85), rapportant toutefois une hausse moyenne de 1.52 ± 0.33 mm par an de 1900 à 2018, donc plus faible que la moyenne de la figure de Gervais qui était basée sur seulement 240 marégraphes (2022A94 p. 118).
Un exemple d’interprétation tendancieuse des données — pour parler vrai, une fraude scientifique — était la « reconstruction » des températures du deuxième millénaire dans le troisième rapport du GIEC (2001). L’explication suivante a été fournie par Christopher Walter (2013A308 p. 8) :
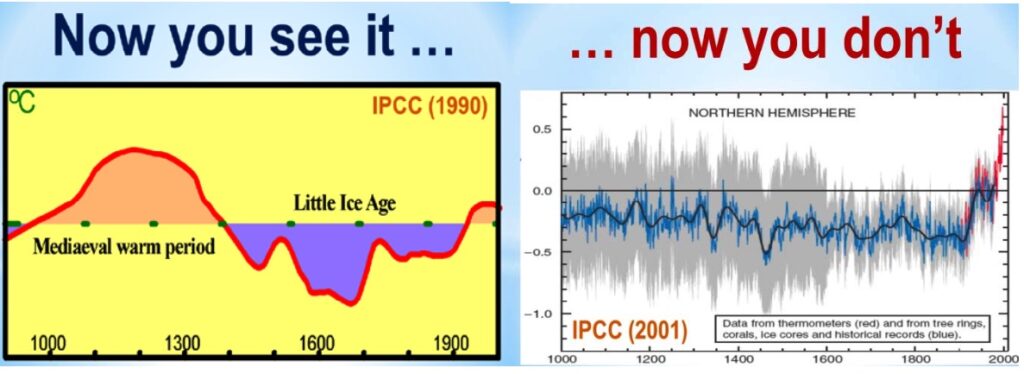
Source : Christopher Walter, Viscount Monckton of Brenchley (2013A308 p. 8)
L’article The Frozen Climate Views of the IPCC . An analysis of AR6 révèle comment les mentions de la période chaude médiévale et du petit âge glaciaire ont de nouveau été effacées lors des révisions du manuscrit de l’AR6N3 (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 35–37). Cette dissimulation était nécessaire pour ressusciter (p. 37–39) le terrifiant graphique en crosse de hockeyN18 ! Patrice Poyet écrit à ce sujet (2022A221 p. 143) :
Il convient de noter que l’étude de Huang et al. (2008A119), basée sur des centaines de forages réalisés sur tous les continents (à l’exception de l’Antarctique), qui comptent parmi les moyens les plus fiables d’établir des paléo-températures reconstituées, est en accord avec Christiansen et Ljungqvist (2011A35) et fournit des preuves solides d’une différence de température de 1.0 à 1.5 K entre la période de réchauffement médiéval (MWP) et le petit âge glaciaire (LIA), conformément à Mayewski et al. (1993A174). Il s’agit d’un sujet controversé depuis la reconstruction erronée de la « crosse de hockey » et l’utilisation trompeuse massive qui en est faite par le GIEC depuis des années. En outre, comme l’ont démontré deMenocal et al. (2000A56), le LIA n’est pas un événement régional limité à l’hémisphère nord, puisque « les SST [températures de surface maritimes] subtropicales ont été réduites de 3 à 4°C. Ces événements étaient synchrones avec les changements holocènes des SST de l’Atlantique Nord subpolaire, documentant un lien fort et en phase entre les variations à l’échelle millénaire du climat des hautes et basses latitudes au cours de l’Holocène. »
⇪ Précision des mesures

Elle est rarement discutée sur les plateaux des médias, en dépit des fortes marges d’incertitudes affichées sur les graphiques des météorologues. Le public a tendance à croire que les mesures par satellite de températures de la surface terrestre sont les plus précises. Or il n’en est rien (SCM, 2015A239 p. 9) :
La température ne peut pas être mesurée directement par les satellites. Dans le cas d’un satellite géostationnaire et d’un temps dégagé, la température est obtenue par application de la loi de Planck, qui lie le rayonnement d’un corps noir (en surface — terre et océans) à la température.
Pour déterminer la température en altitude, les satellites à défilement (en orbite plus basse) utilisent la bande d’absorption du gaz carbonique, ou celle de l’oxygène dans le cas d’un temps nuageux. Dans les deux cas, il s’agit de mesures indirectes.
Les mesures par satellites sont imprécises : des paramètres comme la pression ou la vitesse des vents sont difficiles à estimer par satellite, et l’interaction des nuages avec le rayonnement est encore mal comprise. Les radars infrarouges détectent les nuages les plus élevés, mais pas ceux situés en-dessous. Les capteurs micro-ondes voient à travers les nuages, mais évaluent mal les distances.
Ainsi, les mesures par satellites ne sont fiables qu’en temps dégagé, et la température ainsi estimée doit prendre en compte les incertitudes liées aux autres paramètres, qui sont mal évalués.
Il est certes discutable de citer un document datant de 2015, sachant que les données et les connaissances ont évolué. Mais la qualité pédagogique de ce texte de la Société de Calcul Mathématique m’oblige à le faire, en attendant une mise à jour de son contenu et de ses arguments.
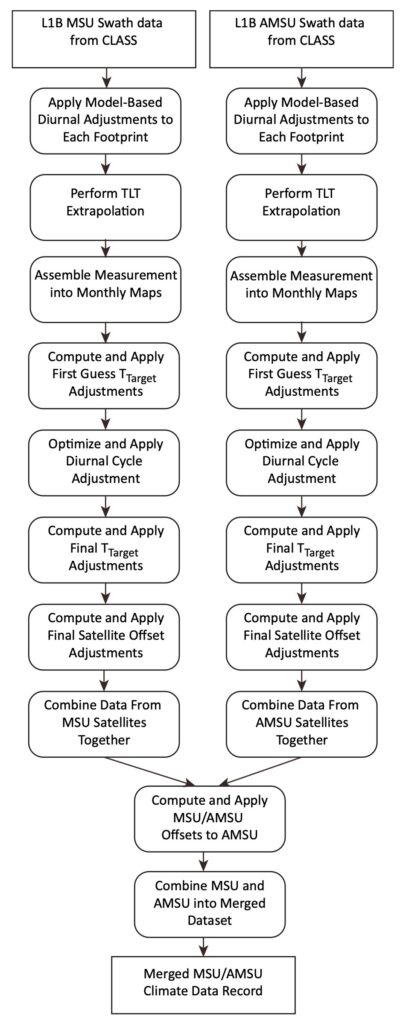
Les données satellitaires font donc l’objet d’ajustements. Patrice Poyet écrit (2022A221 p. 389) :
Par exemple, les données de température (T) sur le graphique de la figure 45 [Poyet P, 2022A221 p. 118] ont été révisées par Mears et Wentz (2017A181) à la suite d’un nombre déconcertant d’opérations, comme le montre la figure 1, p. 7697 de leur article [voir ci-contre]. Après une augmentation de 30 % des ajustements à la hausse, le dernier paragraphe de leur article fournit une longue liste d’excuses pour les futurs ajustements à la hausse. Avec chaque étude, la liste des excuses pour procéder à de nouveaux ajustements à la hausse ne cesse de s’allonger. Et par pure coïncidence, il se trouve que tous les ajustements sont à la hausse. Cela clôture dix années de recherche financée par le contribuable, dont le seul but est de trouver des excuses qui paraissent légitimes, pour procéder à des ajustements à la hausse des données de température satellitaires afin de les rendre compatibles avec la théorie du réchauffement climatique causé par l’Homme.
En mer, les bouées météorologiques les plus utilisées (depuis 1970) étaient dérivantes et transmettaient leurs mesures par radio. Elles suivaient les courants marins et ne mesuraient donc jamais deux fois la température en un même point (SCM, 2015A239 p. 9). D’autres bouées ont été fixées par une ancre au fond de l’océan, mesurant la température à une profondeur. de 3 mètres, et permettent d’étalonner et valider les données satellitaires. En raison de leur coût, ces dernières ne sont pas réparties sur un réseau mondial — voir figure 4 (SCM, 2015A239 p. 14).
Les navires de recherche ont également été utilisés pour des mesures de températures, toutefois avec des erreurs de l’ordre de 0.6 degrés, du fait que le capteur était situé à proximité de la salle des machines (SCM, 2015A239 p. 10).
À partir de 1990, la NOAA a introduit un ajustement appliqué aux données des bouées, ajoutant environ +0.12°C aux relevés des bouées lors de la construction de la série ERSSTv4. John R Christy commente (2016A37 p. 7, 8) :
En 1980, seuls 10 % environ des rapports de données provenaient de bouées, alors qu’en 2000, 90 % environ étaient des données de bouées. Ainsi, étant donné que l’influence des données des bouées s’est considérablement accrue au fil du temps, le simple ajout d’un biais à toutes les bouées depuis le début a créé une tendance au réchauffement à mesure qu’elles devenaient la principale source d’information. […]
La NOAA a utilisé une curieuse variable de référence pour étalonner les températures de l’eau mesurées à partir des prises d’eau des navires : la température de l’air marin nocturne (NMAT). Cette curiosité s’explique par le fait que des ajustements considérables sont nécessaires pour les NMAT elles-mêmes, c’est-à-dire des corrections pour la hauteur du pont du navire, etc. Quoi qu’il en soit, les données des bouées ont ensuite été ajustées pour correspondre aux données des navires. Il semble donc que le processus d’ajustement fondamental dépende des NMAT pour ajuster les données des navires afin d’ajuster ensuite les données des bouées.
Une discussion des données de températures océaniques dans le rapport AR6N3 du GIEC (2021) est présentée dans l’article The Frozen Climate Views of the IPCC (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 47–49).
Les stations de mesure de la température terrestre sont très irrégulièrement réparties sur le globe. De plus, la NOAA n’utilisait (en 2015) qu’environ un quart des 6000 stations, ce qui rendait encore plus problématique le sous-échantillonnage. À cela s’ajoute le fait que les stations de météo sont de plus en plus souvent situées en zone urbaine, ou près des aéroports, ce qui donne des mesures nettement plus élevées que celles autrefois prélevées dans des zones rurales (Gervais F, 2022A94 p. 67 ; Soon W et al., 2023A267 ; Durkin M, 2024A68 15:22). Ce décalage rend problématique la construction de séries temporelles cohérentes.
Patrice Poyet écrit (2022A221 p. 388) :
Spencer (2016A269) a calculé l’effet moyen de l’Îlot de chaleur urbain (ICUN24) dans les données météorologiques quotidiennes de surface qu’il a calculées à partir des stations météorologiques du monde entier au cours de l’année 2000, sur la base des différences de température quotidiennes entre les stations de température voisines, et en déduit que « comme on peut le voir, même à des densités de population aussi faibles que 10 personnes par kilomètre carré, il y a un réchauffement moyen de 0,6 C (1° F), qui est presque aussi important que le signal de réchauffement global au cours du siècle dernier » et peut aller jusqu’à 2.2°C pour des densités de population allant jusqu’à 7000 personnes par km2.
Roy W Spencer ajoute (2016A269 p. 10) :
Dans le cas des mesures effectuées à l’aide de thermomètres, ces changements n’ont pas eu d’incidence sur les prévisions météorologiques, car ils sont minimes (généralement un degré ou moins) par rapport à l’ampleur des changements météorologiques quotidiens. En revanche, ils sont conséquents et préjudiciables pour la surveillance de la température à long terme.
Mototaka Nakamura écrit (2018A199 p. 14, cité par Jean-Claude Pont, 2020A218) :
Pour les périodes antérieures les données de température recueillies ne valent que pour de très petites surfaces (par rapport à la surface totale de la Terre) et présentent donc un biais spatial important. Nous ne disposons pas d’une quantité suffisante de données pour calculer la tendance de la température moyenne globale de surface pour la période présatellite. En réalité, ce biais spatial important fait planer une grande incertitude sur la signification (ou l’absence de signification) de la « tendance de la température moyenne globale de surface » avant 1980.
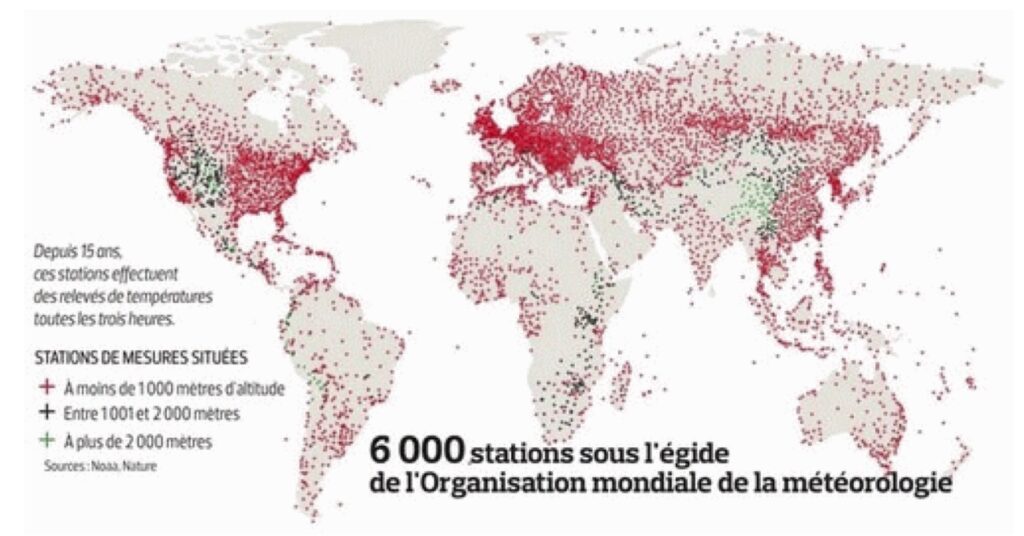
Les méthodes de calcul des moyennes sont expliquées en détail sur le document de la SCM (2015A239 p. 19–23). La moyenne arithmétique, la plus souvent utilisée, n’aurait aucun sens pour la Terre entière, du fait de l’inégalité de répartition des capteurs. Elle est donc réservée à des territoires homogènes comme les États-Unis.
Des corrections de températures ont été effectuées sur des données anciennes, comme celles induites en 2001 par les changements des analyses du GISS (Goddard Institute for Space Studies) et du USHCN (United States Historical Climatology Network). Les mathématiciens protestent (SCM, 2015A239 p. 27, 29) :
Notons encore une fois qu’apporter des corrections à une série de données n’est légitime que si l’on apporte ces corrections à toutes les données ; si on ne le fait qu’à partir d’une certaine date, cela fausse les comparaisons. […]
L’ensemble de l’information relative aux températures mondiales est entièrement dépourvu de valeur scientifique, et ne devrait servir de base à aucune décision politique. On constate, de manière parfaitement claire, que :
• Les capteurs de température sont en nombre beaucoup trop faible pour donner une idée de la température du globe ;
• On ne sait pas, par principe, ce qu’une telle température pourrait signifier. On ne parvient pas à lui donner un sens physique précis ;
• On constate de nombreuses dissimulations et manipulations dans les données ; il y a une volonté affichée de passer sous silence ce qui pourrait passer pour rassurant, et de mettre en évidence ce qui est présenté comme inquiétant ;
• Malgré cela, l’utilisation la plus directe des chiffres disponibles ne montre pas de vraie tendance au réchauffement !
Dans la pratique, ce ne sont pas des « températures » qui sont moyennées, mais les « anomalies de températures » (Poyet P, 2022A221 p. 385) :
La première chose à comprendre est qu’il ne s’agit pas de températures. Comme l’explique Hausfather (2014A110) : « La façon dont le NCDC, le GISS, Hadley, calculent les soi-disant températures consiste à prendre les données des stations, à les traduire en anomalies en soustrayant la moyenne à long terme pour chaque mois de chaque station (par exemple la moyenne 1961–1990), à assigner chaque station à une cellule de la grille, à faire la moyenne des anomalies de toutes les stations dans chaque cellule de la grille pour chaque mois, et à faire la moyenne de toutes les cellules de la grille chaque mois, pondérée par leur superficie respective. » Les détails diffèrent légèrement d’un groupe à l’autre, mais c’est ainsi qu’ils produisent des données, appelées anomalies et présentées sous forme de températures. Non seulement cette méthode “Gridded Anomalies” refroidit le passé et augmente la tendance, et toutes les personnes honnêtes impliquées dans un tel processus l’admettront, mais elle conduit également à remettre en question l’intégrité, l’homogénéité et la stabilité à long terme du processus, étant donné que de nombreux changements se produisent au fil du temps, comme nous le verrons. […]
[…] les changements apportés au GHCN [Global Historical Climatology Network] au fil du temps et les méthodologies utilisées introduisent certains biais qui sont encore aggravés par le fait que le réseau mondial d’observation du NCDC, le cœur et l’âme de la mesure des conditions météorologiques de surface, est confronté à de sérieux défis. L’urbanisation a placé de nombreux sites dans des endroits inappropriés, sur de l’asphalte noir et chaud, à côté de barils d’ordures ménagères, à côté de conduits d’évacuation de la chaleur, et même attachés à des cheminées chaudes et au-dessus de grils extérieurs ! Les données et l’approche adoptées par de nombreux alarmistes du réchauffement climatique sont gravement erronées. Si les données mondiales étaient correctement ajustées pour tenir compte de l’urbanisation et de l’emplacement des stations, et si les questions liées aux changements d’utilisation des sols étaient abordées, il en ressortirait un schéma cyclique de hausses et de baisses, avec une tendance de fond beaucoup moins marquée. […]
Ces séries temporelles sont construites par certains processus — et non simplement mesurées — et […] leur qualité dépend de la confiance que l’on place en elles et dans les processus qui les ont générées.
Une discussion des données de températures de l’air en surface (GSAT) — incluant la surface des océans — dans le rapport AR6N3 du GIEC (2021) est présentée dans l’article The Frozen Climate Views of the IPCC (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 50–52).
Le site UAH Global Temperature ReportN25 de Roy Spencer fournit tous les mois une mise à jour des relevés satellitaires de l’anomalie de température (par rapport à la moyenne entre 1991 et 2020).
⇪ Artéfacts, erreurs, fraudes ?
Steven E Koonin a montré (2021A135 p. 100–110) comment le Climate Science Special Report (CSSR), aux USA, affichait les données de températures extrêmes sous un format conciliable avec une conclusion alarmiste (CSSR, 2017N26 p. 19) :
Les températures extrêmes ont connu des changements marqués dans l’ensemble des États-Unis continentaux. Le nombre de records de températures élevées établis au cours des deux dernières décennies dépasse de loin celui des records de températures basses.
La figure suivante sert de justificatif :
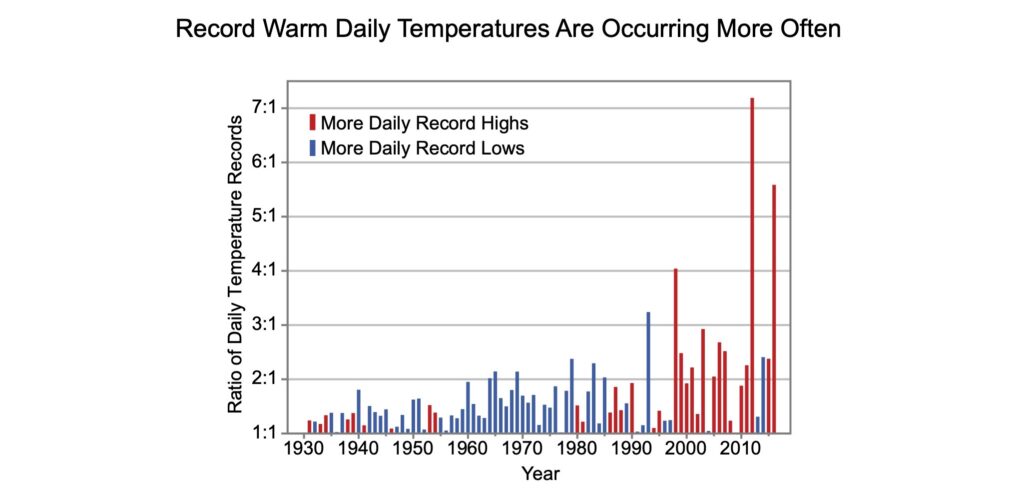
Steven Koonin commente (2021A135 p. 102) :
J’ai été troublé par une incohérence apparente entre ce graphique et d’autres, plus bas dans le rapport, en particulier [la figure 6.3]. Elle montre que la température moyenne la plus froide de chaque année a clairement augmenté depuis 1900, alors que la température moyenne la plus chaude n’a pratiquement pas changé au cours des soixante dernières années, étant à peu près la même aujourd’hui qu’en 1900.

[…] il me semblait possible que le rapport entre les records de chaleur et les records de froid illustré par [la figure 6.5] augmente, non pas parce que les records de chaleur deviennent plus fréquents, mais parce que, à mesure que les températures les plus froides se réchauffent, le dénominateur du rapport (nombre de records quotidiens de froid) diminue, tandis que son numérateur (nombre de records quotidiens de chaleur) n’a pratiquement pas changé au cours des dernières décennies.
Koonin explique ensuite (2021A135 p. 103–105) que les records de températures comptabilisés par le CSSR sont des running records (records en continu), autrement dit lorsque la température maximale d’un jour de l’année, pour une station météo, excède celles de toutes les années précédentes. Pour la période étudiée (1930–2017), le nombre de running records était logiquement au plus haut les premières années — démarrant à 365 la première année — puis il diminuait les années suivantes pour atteindre quelques unités au final. Au début de la période, le rapport entre maxima et minima était proche de 1, puis il prenait une valeur de plus en plus incertaine à mesure que le numérateur et le dénominateur diminuaient. C’est pour ces raisons (un simple artéfact mathématique) que les hauteurs des barres de la figure 6.5 apparaissent, au cours du temps, de plus en plus chaotiques — et dénuées de signification. Et non en raison d’un sous-entendu « dérèglement du climat ». Steven Koonin ajoute (2021A135 p. 106) :
Ayant compris que la présentation par le CSSR des températures quotidiennes enregistrées aux États-Unis était très trompeuse, j’ai naturellement voulu savoir ce qu’une analyse correcte — utilisant des records absolus — montrerait. J’ai également voulu savoir ce qu’il en était des températures extrêmes avant 1930…
L’analyse a donc été refaite par le professeur John Christy, de l’Université de l’Alabama, avec le résultat suivant (Koonin SE, 2021A135 p. 107) :
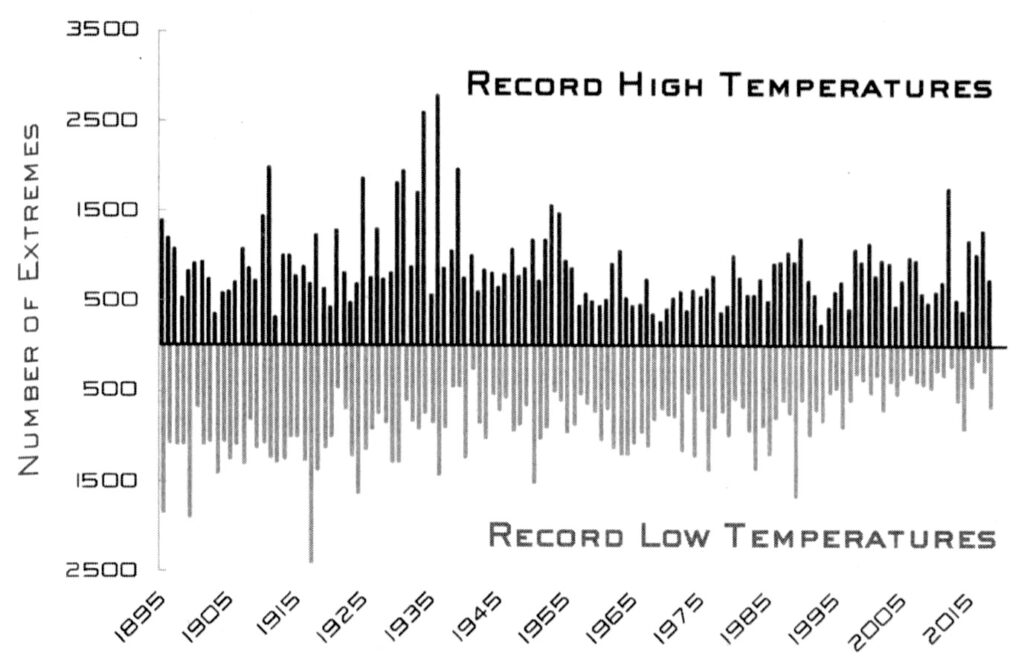
Présentées ainsi, les données sont nettement moins inquiétantes… Steven Koonin ajoute (2021A135 p. 106–110) :
Les records de température montrent clairement que les années 1930 ont été chaudes, mais il n’y a pas de tendance significative sur les 120 années d’observation, ni même depuis 1980, lorsque l’influence humaine sur le climat s’est fortement accrue. En revanche, le nombre de records absolus quotidiens de froid diminue sur plus d’un siècle, cette tendance s’accélérant après 1985. Ces deux graphiques montrent une chose qui va totalement à l’encontre de la perception commune, à savoir que les températures extrêmes dans la zone continentale des États-Unis sont devenues moins fréquentes et un peu plus douces depuis la fin du 19e siècle.
Malgré cela, le résumé de la CSSR met en exergue le graphique de rapports erronés [figure 6.5] avec la légende : « Les records de chaleur journalière sont plus fréquents. » […]
Voilà donc les raisons pour lesquelles j’ai une “Very High Confidence” (confiance très élevée) à identifier et corriger une fausse représentation de la science climatique dans un rapport officiel du gouvernement. Il ne s’agit pas d’un pinaillage, c’est vraiment important. La notion erronée d’une augmentation de la fréquence des records de température aux États-Unis est susceptible de se répercuter dans les rapports d’évaluation ultérieurs, qui citent immanquablement les rapports précédents. […] Il en est de même pour les représentations médiatiques de la science du climat, qui donnent voix à de telles « conclusions » trompeuses. […]
Il se trouve que les preuves d’une augmentation des températures les plus froides sont parfaitement cohérentes avec un réchauffement du globe — mais pas une « planète en feu » qui donne à voir des graphiques d’explosion des températures.
Steven Koonin parle ici de « réchauffement du globe ». Certes, son analyse des données s’écarte du discours d’urgence climatique, mais dans son ouvrage (2021A135 ; version française 2022A136), il fait l’économie d’un examen méthodique du lien de causalité affirmé entre ce réchauffement et la production humaine de gaz à effet de serre. Est-ce par prudence ?
La deuxième partie de son livre (p. 207–255) désamorce les critiques, étant consacrée à des « réponses » dans l’air du temps : diminuer les productions de CO2, de méthane et de CFC, développer les technologies de production d’énergie « décarbonée », les petites centrales nucléaires, la fusion… ainsi que s’adapter au changement climatique et lutter directement contre le réchauffement par des techniques de géo-ingénierie. Il écrit (p. 249) :
Le climat est en train de changer, les humains y jouent un rôle, et pourtant notre besoin global d’énergie augmente en même temps ; nous devons prendre conscience de ce que cela pourrait impliquer dans l’avenir.
Un autre exemple d’artéfact signalé par Koonin (2021A135 p. 121–126) est le décompte des tornades aux USA. Il apparaît comme croissant sur le site du NCEI (2022N27), laissant supposer que cette augmentation du nombre de tornades serait un effet du réchauffement climatique :
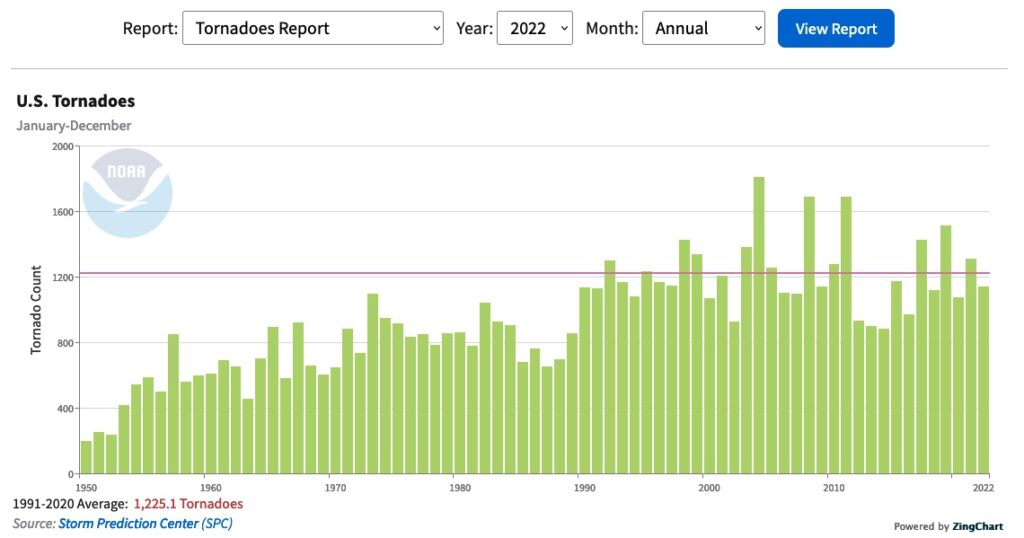
Toutefois, Steven Koonin précise (2021A135 p. 123) :
La violence des tornades est mesurée selon l’échelle Fujita améliorée […] Les catégories de violence vont de EF0, pour des tempêtes très faibles, à EF5, pour des tempêtes dont les vents dépassent les 260 mph [420 km/h]. Aujourd’hui, aux États-Unis, 60 % des tornades enregistrées sont de catégorie EF0, alors qu’en 1950, ces tempêtes ne représentaient qu’environ 20 % du total enregistré. Cela suggère que l’augmentation du nombre de tornades enregistrées est due à la prise en compte d’un plus grand nombre de tempêtes faibles au cours des dernières décennies, ce qui, selon la NOAA, est effectivement le cas.
Nous pouvons corriger le biais d’observation ancien qui empêche de recenser les tempêtes faibles en ne prenant en compte que celles de catégories EF1 et plus — les plus susceptibles de causer des destructions.
Le graphe obtenu sur cette base ne montre aucune augmentation du nombre de tornades dans la période 1954–2014 (2021A135 p. 124) :
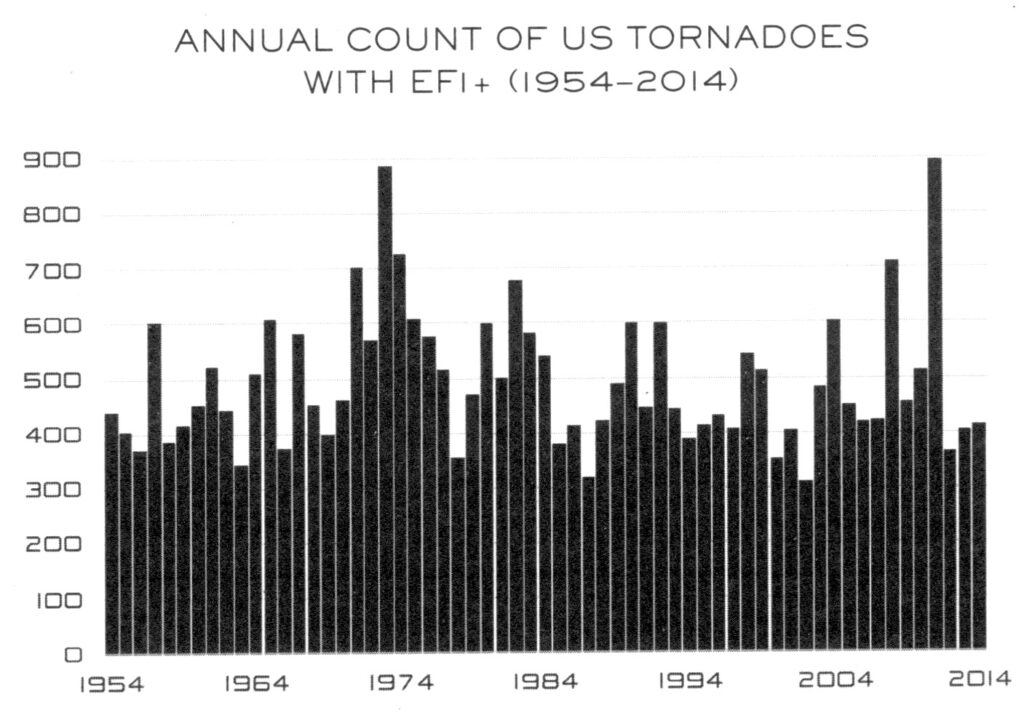
Un autre graphe (Koonin SE, 2021A135 p. 124) montre que le nombre de tornades de catégorie égale ou supérieure à EF3 a diminué pendant la même période, alors que l’influence humaine sur le climat allait croissante.
Il est regrettable que dans le film Climate : The Cold Truth (Durkin M, 2024A68 40:23) on affirme directement que « les ouragans ne sont pas plus fréquents », alors que les statistiques en affichent un nombre croissant. Il aurait fallu préciser que c’est la prise en compte de leur intensité qui a montré que cette « croissance » était une fiction. Exemple typique d’un argument que des climato-alarmistes (en partie avertis) soulèveront pour accuser le film d’être construit sur des données falsifiées !
Le vice-président du groupe scientifique du GIEC, Jean Jouzel, déclarait dans son intervention « Le réchauffement est sans équivoque » en 2011 (Ferry L ed., 2011A79 p. 34, 35–36) :
[…] si vous considérez la séquence 2003–2010, elle marque un plateau par rapport à la tendance au réchauffement qui caractérisait les années précédentes. […]
J’estime pour ma part que pour que la conclusion du GIEC soit remise en cause, il faudrait que le « plateau » dont nous venons de parler dure une bonne vingtaine d’années, soit encore dix à quinze ans, ce qui selon moi ne se produira pas.
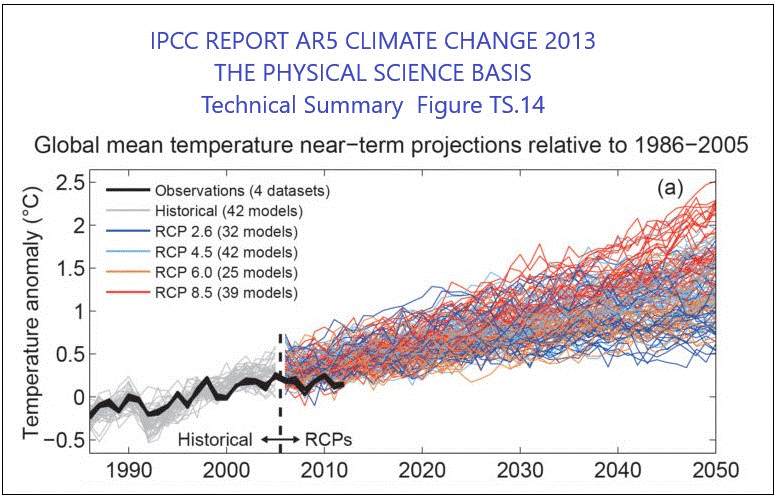
Source : site La question climatique
Alors que le « plateau » s’était maintenu (depuis 1995), Jouzel annonce triomphalement (Kokabi AR, 2023A132) :
Le climatoscepticisme a muté, parce qu’il était dos au mur. Plus personne ne peut décemment dire que « le Giec exagère », et même le député RN Thomas Ménagé est revenu sur sa déclaration. On les entend moins sur le déni de la réalité scientifique du changement climatique ou de la responsabilité humaine, où ils ont perdu la bataille.
La posture « droit dans ses bottes » est vitale pour un Jean Jouzel bénéficiaire de la médaille d’or du CNRS, en 2002, « pour avoir fait la preuve de l’influence humaine sur le climat ». Comme l’a dit Claude Allègre — lui aussi médaille d’or du CNRS (2010A9 p. 63) : « Jouzel se croit donc lié à la théorie dominante, et il la défendra désormais contre vents et marées. »
⇪ Fiabilité des modèles prédictifs
Parler de « dérèglement » du climat présuppose qu’il ait pu exister, dans un Eden pré-industriel, une régularité des événements météorologiques. La lecture de l’Histoire humaine et comparée du climat (Le Roy Ladurie E, 2004A147) permet de prendre conscience de l’extrême variabilité du climat, même à brève échéance. Par exemple, en France, l’incidence (apériodique) d’étés caniculaires, tantôt trop secs tantôt « pourris », au cours d’une période de quelques siècles — le petit âge glaciaire — résumée comme « froide ». Jacques-Marie Moranne écrit (2024bA185 p. 134) :
[…] implicitement, le GIEC considère (arbitrairement) que les variations « naturelles » sont toujours courtes et faibles alors que les variations liées à l’homme sont (les seules) lourdes et longues : il est vrai que cet arbitraire est déjà inclus dans la charte du GIEC qui pose comme principe que les changements climatiques sont d’origine humaine.
Les événements météorologiques sont en fait le produit de l’évolution de systèmes dynamiques complexes non linéaires, théorisés en 1963 par le mathématicien (et météorologue) Edward Lorenz (Masson H, 2019A169).
Les modèles mathématiques servant à simuler de tels systèmes, dans l’espoir de prédire certains aspects de leur évolution, sont sensibles à d’infimes variations des paramètres à l’état initial. Une telle sensibilité — signature d’un comportement chaotique — était déjà visible sur le premier modèle de Lorenz qui dépendait seulement de trois variables.
Imaginé aussi par Lorenz, le moulin à eau chaotique est une illustration graphique de l’extrême sensibilité aux conditions initiales d’un système dynamique complexe non-linéaire. Alors que son mouvement est parfaitement déterministe — régi par les lois de la physique appliquées à un mécanisme absolument régulier — il apparaît imprédictible aux yeux d’un physicien qui n’est pas en mesure de mesurer chaque paramètre, ni de calculer ses variations, avec une précision absolue. Étienne Ghys (2009A104) a illustré sa « dépendance sensible aux conditions initiales » en programmant une simulation de deux moulins en tous points identiques et recevant le même débit d’eau, mais dont la roue, au départ, est tournée de 2 degrés sur celui de gauche, contre 1.9996 degrés sur celui de droite. Cette infime différence (de 2 pour mille) sur un seul paramètre suffit à faire diverger les trajectoires des moulins malgré leur apparente synchronisation juste après leur démarrage.
Si les modèles de systèmes dynamiques complexes non-linéaires ne permettent pas de faire des prédictions à long terme — la thèse avancée par Edward Lorenz pour ce qui concerne la météorologie — ils peuvent afficher certaines « régularités ». Par exemple, ici, la distribution statistique de la vitesse de rotation est indépendante de la position initiale de la roue (Ghys E, 2009A104). Mais cela ne vaut ici que pour une variable — dont l’étude statistique n’est pas forcément intéressante — et de manière générale que lorsqu’un seul paramètre initial a été modifié. L’invariabilité de la distribution statistique des vitesses de rotation par rapport à la position angulaire initiale est même un résultat trivial…
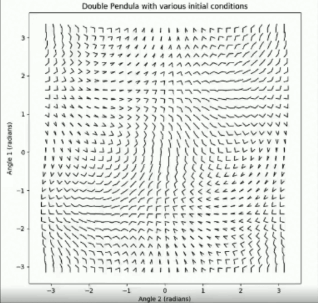
Un autre exemple de système chaotique (plus facile à réaliser) est le pendule à deux branches — voir vidéo et image ci-contre.
Peut-on observer une évolution régulière de variables (jugées pertinentes) avec des conditions initiales qui dépendent d’une multitude de paramètres ? C’est le cas des « modèles de climat » dont les paramètres se comptent par centaines ou par milliers.
La prévision d’événements climatiques est aujourd’hui possible sur une durée d’une quinzaine de jours — la « frontière du chaos » — au prix du traitement d’une grande masse de données : c’est le travail des météorologues. Les prédictions saisonnières (à six mois), surtout dans l’hémisphère nord, restent par contre très incertaines (Poyet P, 2022A221 p. 347–349). En Chine, des prédictions saisonnières de précipitations sont proposées à partir de l’analyse statistique de variations de la température du sol à 3.20 mètres de profondeur, elles-mêmes corrélées aux secousses sismiques (Liu Y & R Avissar, 1999A155 ; Guo WD et al., 2013A103 ; Zhou Y et al., 2023A321).
Dans ces conditions, comment peut-on envisager sérieusement — à partir du même bagage théorique — une modélisation réaliste couvrant plusieurs décennies ?
Sans surprise, les prévisions des modèles de climat s’écartent des observations chaque fois que le calcul est lancé à partir d’une date antérieure pour vérifier la qualité prédictive du modèle. Certes, on peut bricoler jusqu’à ce que cette « prévision rétrospective » (sic) reproduise au mieux les données réelles, mais aucun « réglage » (tuning ou fudge) ayant satisfait cette condition ne garantit que l’extrapolation aux années futures restera réaliste.
Pratiquement tous les premiers modèles ont été calibrés de façon à reproduire les températures de surface moyenne observées au XXe siècle (Voosen P, 2016A305). Judith Curry ajoute (2024A52 p. 138 ; 2023A51 p. 82) :
En outre, régler les modèles climatiques sur les observations réalisées sur la période 1975–2000, c’est les régler sur une phase de réchauffement de la variabilité naturelle interne, et cela se traduit par une sensibilité exagérée des modèles au CO2, puisque le réchauffement dû à la variabilité naturelle est [alors] étalonné sur le réchauffement dû au CO2.
Dans leur article Are general circulation models obsolete ? (les modèles de circulation généraleN12 [GCM] sont-ils obsolètes ?), Venkatramani Balaji et ses collègues écrivent (2022A13) :
Une deuxième critique à l’égard des GCM porte sur la question de la « mise au point » ou de l’étalonnage des modèles climatiques. Comme indiqué ci-dessus, la physique non résolue (U + P) est représentée à l’aide d’équations dont les paramètres sont contraints dans une certaine fourchette par les observations ou la théorie. Le système couplé est ensuite soumis à des contraintes globales, telles que le bilan énergétique au sommet de l’atmosphère (Hourdin F et al., 2017A117). Le fait que les modèles soient réglés pour reproduire certaines caractéristiques de la planète observée est considéré par certains comme rendant les résultats suspects.
Les auteurs de l’article The Art and Science of Climate Model Tuning (L’art et la science du réglage des modèles climatiques) reconnaissent (Hourdin F et al., 2017A117) :
Les choix et les compromis effectués au cours de l’exercice de réglage peuvent affecter de manière significative les résultats du modèle et influencer les évaluations qui mesurent une distance statistique entre le climat simulé et le climat observé. Bien que le besoin de réglage des paramètres ait été reconnu dans des travaux de modélisation… Il est souvent ignoré lors de l’examen des performances des modèles climatiques… En fait, la stratégie de réglage ne faisait même pas partie de la documentation requise des simulations CMIP phase 5… Pourquoi un tel manque de transparence ? Cela peut être dû au fait que le réglage est souvent considéré comme une partie inévitable mais sale de la modélisation du climat, plus d’ingénierie que de science, un acte de bricolage qui ne mérite pas d’être enregistré dans la littérature scientifique… Le réglage peut en effet être considéré comme un moyen indescriptible de compenser les erreurs de modèle…
Pascal Blamet ajoute (2021A23) :
Ces pratiques traduisent une grande faiblesse face à la complexité du sujet, car les numériciens le savent bien : on peut toujours parvenir à des ajustements numériques, mais si les fonctions ou paramètres ne sont pas représentatifs de la phénoménologie modélisée, les calculs ne valent rien ; de la même façon que les corrélations statistiques sans causalité sont de purs sophismes. […]
Ces points ne sont pas non plus discutés publiquement par la communauté scientifique climatique, pour une raison simple : elle n’est globalement pas compétente en matière de modélisation numérique.
Le mathématicien John Von Neumann disait : « Si vous me laissez quatre paramètres au choix, je peux construire un modèle mathématique qui décrit exactement tout ce qu’un éléphant peut faire. Si vous m’accordez un cinquième paramètre, le modèle que je construis prévoira que l’éléphant peut voler. » (Gerlich G & RD Tscheuschner, 2009A89 p. 352)
Comme le disait un commentateur de la revue Science, cité par Pierre-Gilles de Gennes : « Dans la modélisation du climat, presque tout le monde triche (un peu)… »
Judith Curry écrit (2024A52 p. 152, 181 ; 2023A51 p. 89, 107) :
Les chercheurs reconnaissent la nécessité de réglages du modèle nécessaires pour « prouver » un phénomène décidé à l’avance, comme la sensibilité climatique à l’équilibreN28 (Mauritsen T & Roeckner E, 2020A172 p. 1, 8) :
La capacité d’un modèle climatique à reproduire le réchauffement historique observé est parfois considérée comme une mesure de qualité. Pourtant, pour des raisons pratiques, elle ne peut pas être considérée comme un résultat purement empirique des efforts de modélisation, car le résultat souhaité est connu à l’avance et constitue donc une cible potentielle de réglage. […]
Nous avons documenté la façon dont nous avons réglé le modèle climatique global MPI-ESM 1.2 pour qu’il corresponde à l’enregistrement instrumental du réchauffement ; un effort couronné de succès. Pour respecter le déroulement historique des événements, le choix pratique a été de viser une sensibilité climatique de 3° K en utilisant la rétroaction des nuages, plutôt qu’un réglage du forçage associé aux aérosols.
Il s’agissait ici de rétroactions négatives. Des rétroactions positives sont postulées, au besoin, dans d’autres contextes, voir ci-dessous (Moranne JM, 2024bA185 p. 120-ff).
La modélisation consiste à mettre en équations des modèles du système Terre (Earth System Models, ESM) capables de décrire de manière réaliste les phénomènes atmosphériques récurrents et d’anticiper leur évolution sur de longues périodes. Un des premiers ESM a été proposé par Phillips (1956A215). Les modèles de circulation générale ont vu le jour à la même époque. Le travail des physiciens reposait dur une base conceptuelle simple et solide (Poyet P, 2022A221 p. 331, citant Goosse et al., 2010A100) :
Les équations fondamentales qui régissent l’atmosphère peuvent être formulées comme un ensemble de sept équations à sept inconnues : les trois composantes de la vitesse, la pression, la température, le pourcentage d’humidité et la densité. […]
Malheureusement, ces sept équations ne forment pas un système fermé. Tout d’abord, la force de frottement et le taux de dissipation thermique doivent être spécifiés. Le calcul du taux de dissipation, en particulier, nécessite une analyse détaillée du transfert radiatif dans l’atmosphère, prenant en compte à la fois les ondes longues et les ondes courtes dans les colonnes atmosphériques, ainsi que les transferts de chaleur associés à l’évaporation, à la condensation et à la sublimation. L’influence des nuages sur ces processus est généralement une source d’incertitude considérable.
Et plus loin (Poyet P, 2022 p. 378) :
Coupler de manière convaincante les cases de circulation océan-atmosphère a été, et reste un défi permanent, mais ajouter les composants de glace, l’utilisation des terres, la végétation, les stocks d’eau douce et tous les processus géochimiques requiert beaucoup de foi pour penser que cela nous donnera une idée de la manière dont la planète Terre se comportera réellement. Le passage de l’échelle temporelle de prédiction des systèmes météorologiques, essentiellement une semaine, à un mois ou un peu plus est démontré comme un défi majeur par la prévision d’événements exceptionnels tels que les vagues de chaleur, par exemple (Weisheimer et al., 2011A312 ; Stéfanon, 2012A275).
François Gervais écrit (2022A94 p. 92) :
Le consortium UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) regroupe une centaine d’universités et écoles en sciences de l’atmosphère. Ils ont fait « tourner » un même modèle de climat de l’Amérique du Nord sur 50 ans, avec la même évolution de la concentration de CO2, en ne changeant que d’un millième de milliardième les conditions initiales [Kay JE et al., 2015A126]. Le millième de milliardième est suffisant pour provoquer 30 évolutions différentes. Il s’avère qu’il était impossible de prévoir à l’avance lequel des 30 essais se rapprocherait le plus du climat observé, et lequel s’en est éloigné le plus. Cette expérience conduite sur ordinateur illustre à merveille l’extrême sensibilité d’un système chaotique aux conditions initiales, et la vanité d’espérer une quelconque prédiction fiable.
Le troisième rapport (TAR) du GIEC le reconnaissait explicitement : « Dans la modélisation du climat, nous devons reconnaître que nous avons affaire à un système chaotique non linéaire couplé, et donc que la prédiction à long terme des futurs états climatiques n’est pas possible. » Même si l’on moyenne des comportements chaotiques, on obtient un comportement chaotique moyen, pas une meilleure prédiction.
Une présentation pédagogique des modèles prédictifs de climat a été proposée par Steven Koonin (2021A135 p. 77–96) puis Judith Curry (2024A52 p. 129–177 ; 2023A51 p. 77–94). En observant les incertitudes des modèles comparatifs CMIP3 (2007) et CMIP5 (2013), Koonin constate (p. 87) que les plus récents sont entachés de plus d’incertitude que les plus anciens, alors qu’on s’attendait à l’inverse, compte tenu des progrès en termes de modélisation et de collection de données. François Gervais (2022A94 p. 54) confirme cette augmentation de l’incertitude entre les modèles du CMIP5 (2013) et ceux du CMIP6 (2021). Judith Curry écrit (2024A52 p. 118 ; 2023A51 p. 69) :
Mais mieux nous comprenons le problème, plus il acquiert de nouvelles dimensions, accroissant du même coup l’incertitude.
Une importante source d’incertitude en modélisation climatique relève du traitement des nuages, dont les dimensions sont nettement plus petites que la trame servant à partitionner l’atmosphère (Schneider T et al., 2017A256 p. 4) :
Actuellement, nous utilisons des modèles climatiques qui ne sont pas adaptés à cette tâche : leurs modèles atmosphériques ont un espacement de grille horizontal d’environ 50–100 km et un espacement de grille vertical d’environ 200 mètres dans la basse atmosphère. Ceci est beaucoup trop grossier pour résoudre les courants ascendants turbulents de 10 à 100 mètres de large, qui prennent naissance dans la couche limite planétaire et génèrent des nuages bas.
Les physiciens Gerhard Gerlich et Ralph D Tscheuschner ont depuis longtemps souligné radicalement les incohérences de cette modélisation (2009A89 p. 350, 351, 353) :
Les équations de Navier-Stokes sont en quelque sorte le Saint-Graal de la physique théorique, et une discrétisation brute à l’aide de grilles à mailles très larges conduit à des modèles qui n’ont rien à voir avec le problème original et n’ont donc aucune valeur prédictive.
Dans les problèmes impliquant des équations différentielles partielles, les conditions aux limites déterminent les solutions bien plus que les équations différentielles elles-mêmes. L’introduction d’une discrétisation équivaut à l’introduction de conditions aux limites artificielles, une procédure qui est caractérisée par la déclaration de von Storch : « La discrétisation est le modèle. » Dans ce contexte, une déclaration correcte d’un mathématicien ou d’un physicien théorique serait la suivante : « Une discrétisation est un modèle dont les conditions aux limites ne sont pas physiques. » Les discrétisations de problèmes de continuums seront autorisées s’il existe une stratégie permettant de calculer des raffinements progressifs. […] Au mieux, ces modèles informatiques peuvent être considérés comme un jeu heuristique.
En général, il est impossible de dériver des équations différentielles pour les fonctions moyennées et, par conséquent, pour les dynamiques non linéaires moyennées. Il n’y a donc tout simplement pas de fondement physique aux modèles informatiques du climat global, pour lesquels le paradigme du chaos est toujours d’actualité. […]
La climatologie globale moderne a confondu et continue de confondre les faits et la fiction en substituant le concept de scénario à celui de modèle. […] En conclusion, les déclarations sur le réchauffement climatique anthropique induit par le CO2 qui sont déduites des simulations informatiques ne relèvent d’aucune science.
La fiabilité des modèles de climat est étudiée depuis une vingtaine d’années par le World Climate Research Programme (WCRP), à l’origine des Coupled Model Intercomparison Projects (CMIP). Elle a été exposé notamment par Nicola Scafetta (2021cA249). Chaque modèle de circulation généraleN12 (GCM) possède une valeur spécifique de l’Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) ou sensibilité climatique à l’équilibreN28. Il s’agit du réchauffement de la surface du globe (à l’équilibre thermique) induit par le doublement de la concentration atmosphérique de CO2 par rapport à la valeur préindustrielle, autrement dit de 280 à 560 ppm.
Le GIEC cite souvent la formule logarithmique empirique de Myhre (1998A192) qui donne le forçage radiatifN5 en fonction de l’évolution relative de concentration du CO2 (Moranne JM, 2024bA185 p. 120-ff) :
En fait, les rapports du GIEC ne montrent pas ce calcul, car cette valeur de la sensibilité climatique est encore insuffisante pour alarmer vraiment, puisque la température a déjà augmenté de plus de 1° C alors que nous sommes encore loin d’un doublement. […] Le GIEC fait donc état d’un certain nombre de « rétroactions positives », c’est-à-dire amplificatrices du réchauffement ; on peut citer en particulier :
• l’augmentation de la concentration en méthane, du fait de la fonte du pergélisol […] ;
• la diminution de l’albédoN29, du fait de la fonte et de la diminution des surfaces des glaces, mais les glaces ont peu d’influence sur l’albédo pour deux raisons : elles sont elles-mêmes très souvent recouvertes par les nuages (déjà comptés dans l’albédo), et la lumière qu’elles reçoivent est essentiellement rasante (au niveau des pôles) ;
• l’augmentation de la concentration atmosphérique de vapeur d’eau, du fait d’une augmentation de l’évaporation […] autrement dit une amplification de l’effet de serre […]
La sensibilité climatique à l’équilibre (ECS) des modèles de circulation générale du CMIP5 variait de 2.1 à 4.5°C, mais elle a été réduite à 1.5 à 4.5°C en 2013 par le GIEC. Paradoxalement, les ECS des nouveaux modèles du CMIP6 affichent une fourchette plus large : de 1.83 à 5.67 °C. Cette question est préoccupante, car l’ECS de bon nombre de ces nouveaux modèles dépasse même 4.5°C, qui était la valeur limite supérieure précédemment acceptée (Scafetta N, 2021cA249 p. 2). Scafetta ajoute :
Le problème de l’ECS est à la fois difficile et crucial, car plusieurs études empiriques ont conclu que sa valeur devrait être généralement inférieure aux estimations du modèle de circulation générale, c’est-à-dire entre 0.5 et 2.5 °C. […]
Dans cet article, nous testons 38 modèles de CMIP6 dans la simulation des changements de température de surface observés entre les périodes 1980–1990 et 2011–2021, en utilisant les distributions de surface pour mieux identifier les régions où les modèles échouent le plus. Cette période a été choisie parce qu’elle est couverte par les enregistrements de températures terrestres et satellitaires, et qu’elle est suffisamment longue (plus de 30 ans) pour permettre l’évaluation des modèles. […]
La figure [ci-dessous] montre plusieurs simulations de température de surface de modèles de CMIP6 (courbes rouges, modèles avec ECS > 3 ; courbes bleues, modèles avec ECS ≤ 3) par rapport aux observations de température (vertes) (ERA5-T2m, ERA5-850mb, et UAH MSU v6.0 Tlt) en utilisant comme référence la période 1980–1990. Le point 2021 pour ERA5-T2m et ERA5-850mb est calculé en utilisant les mois de janvier à juin ; le point 2021 pour UAH MSU v6.0 Tlt est calculé en utilisant les mois de janvier à août. Les modèles à forte ECS (courbes rouges) prévoient un réchauffement nettement plus rapide que ceux à faible ECS (courbes bleues).
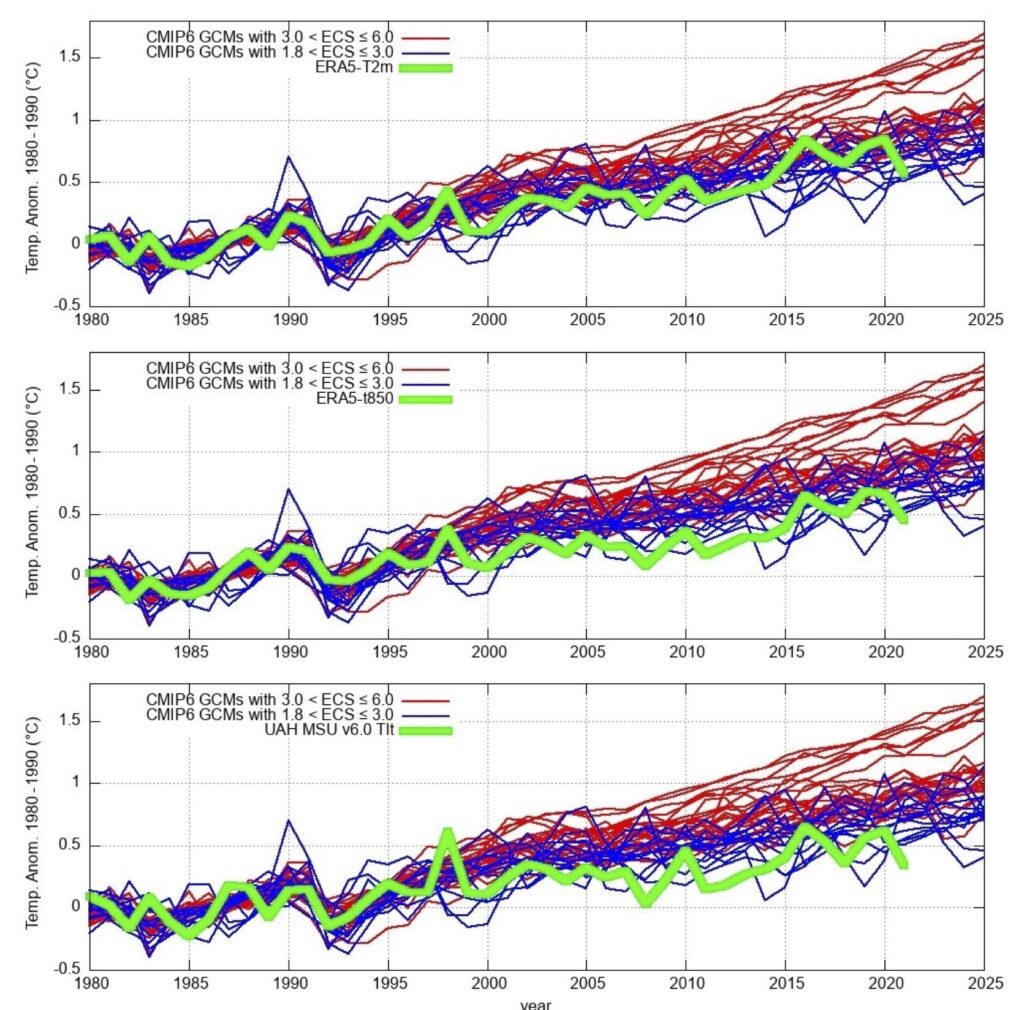
De 1980 à 2021, on constate une meilleure concordance avec l’enregistrement ERA5-T2m ; les enregistrements ERA5-850mb et UAH MSU v6.0 Tlt montrent une tendance au réchauffement encore plus faible, qui ne concorde guère qu’avec les simulations les moins chaudes. Ainsi, l’impression générale est que la plupart des modèles CMIP6, et en particulier ceux qui ont des valeurs d’ECS élevées, surestiment la tendance au réchauffement, comme cela a déjà été constaté pour les modèles CMIP3 (Scafetta N, 2012A245) et CMIP5 (Scafetta N, 2013A246).
Nicola Scafetta estime, données et citations à l’appui, que le meilleur scénario de trajectoires socio-économiques partagées (SSPN30) — d’évolutions socio-économiques mondiales projetés jusqu’en 2100 — devrait être établi sur la base du SSP2‑4.5 « milieu de route », et non les SSP3‑7.0 et SSP5‑8.5, jugés trop incertains par l’International Energy Agency, ce dernier ayant servi de base aux prédictions alarmistes du rapport AR6N3 du GIEC (2021). Scafetta écrit (2023A250) :
Il s’agit d’une déclaration importante, car le GIEC et de nombreux travaux ont considéré le scénario extrême SSP5‑8.5 comme représentant le cas “business as usual” […], alors qu’il n’était censé être qu’un scénario excessif [basé sur l’hypothèse invraisemblable d’une augmentation massive de l’utilisation du charbon censée remplacer toutes les autres formes de production d’énergie] […]
Les projections climatiques obtenues montrent que le réchauffement de la surface du globe prévu pour le 21e siècle sera probablement faible, c’est-à-dire qu’il ne dépassera pas 2.5 à 3.0 °C et qu’il sera en moyenne inférieur au seuil de 2.0 °C. Cela devrait permettre d’atténuer et de gérer les risques les plus dangereux liés au changement climatique, grâce à des politiques d’adaptation appropriées et peu coûteuses. En conclusion, il n’est pas nécessaire d’appliquer des scénarios coûteux de décarbonation et d’émissions nettes nulles, tels que les scénarios SSP1‑2.6, car l’objectif de température de l’Accord de Paris consistant à maintenir le réchauffement de la planète à moins de 2 °C tout au long du 21e siècle devrait être compatible avec des voies socio-économiques partagées, modérées et pragmatiques telles que les scénarios SSP2‑4.5.
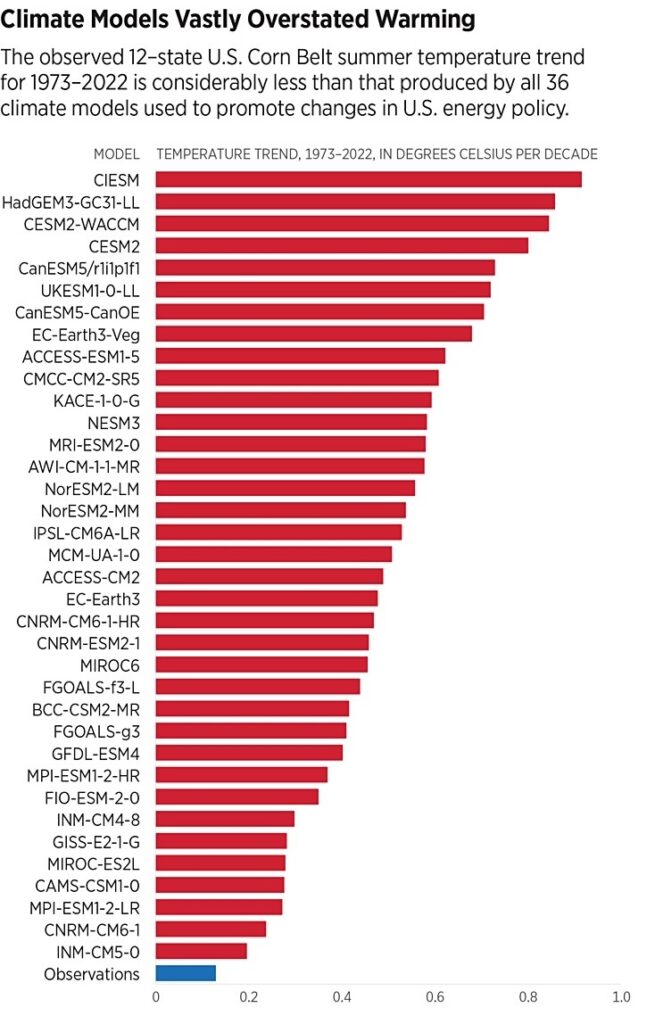
Cette surestimation systématique a été une fois de plus signalée dans l’article de Roy W Spencer, Global Warming : Observations vs. Climate Models (2024A270) — voir image ci-contre. L’auteur essaie d’expliquer pourquoi les modèles climatiques produisent un réchauffement trop important, en donnant des indications sur d’autres causes que l’activité humaine pour expliquer les signaux de température observés. Il écrit entre autres : « Les modèles doivent être “réglés” pour ne produire aucun changement climatique, puis une influence humaine est ajoutée sous la forme d’un très petit changement, d’environ 1 %, dans l’équilibre énergétique mondial. » Ce type de réglage sur un signal aussi faible rendrait n’importe quel modèle hyper-sensible au réglage, ce qui est effectivement le cas. Il ajoute (p. 6, 8) :
L’écart entre les modèles et les observations est rarement mentionné alors que c’est, grosso modo, la moyenne des modèles (voire les modèles les plus extrêmes) qui est utilisée pour promouvoir des changements de politique aux États-Unis et à l’étranger. […]
Ces divergences entre les modèles et les observations ne sont jamais évoquées lorsque les chercheurs en climatologie préconisent des modèles climatiques pour la politique énergétique. Au contraire, ils exploitent les prévisions exagérées des modèles de changement climatique pour concocter des affirmations exagérées sur une crise climatique.
François Gervais écrit à ce sujet (2022A94 p. 55) :
McKitrick & Christy (2020A179) se sont penchés sur la question du pourquoi certains modèles CMIP6 « chauffent » trop […] — voir aussi Pascal Blamet (2021A23). Par ailleurs, Zhu et al. (2020A322 ; 2021A323) montrent que les valeurs de sensibilité climatiqueN31 les plus élevées sont en désaccord avec les séries de température paléoclimatiques. Ils mettent en cause le traitement douteux des nuages dans les modèles. […]
L’Annexe en fin de chapitre [p. 74] montre qu’en cas de doublement du CO2, le déficit de flux thermique émis au sommet de l’atmosphère n’excèderait pas 2.6 W/m2. Au rythme moyen d’accroissement d’environ 2 ppm par an observé depuis le début de ce siècle, […] sa contribution par décennie resterait de l’ordre de (20 ppm / 414 ppm) x 2.6 W/m2 = 0.13 W/m2. C’est 100 fois moins que les ordres de grandeur des écarts entre modèles, illustrant à quel point ces derniers peinent à convaincre.
Pascal Blamet (2021A23) écrit :
Dans les cas complexes, et en particulier dans le cas de la modélisation de la géosphère, les équations sont pour partie des approximations, et surtout les paramètres directeurs ne sont pas mesurables. On tente de les ajuster comme on peut : c’est le « réglage » du modèle, passage obligé, très loin d’être simple. C’est ce qui a fait défaut dans le cas du Covid car cet ajustement des paramètres directeurs est d’autant plus incertain que l’objet modélisé est complexe.
Or c’est bien le cas de l’atmosphère qui est un milieu très volatil avec de la convection horizontale et verticale, des échanges avec d’autres milieux (terre, eau, glace), de la thermodynamique complexe, des changements de phase, du rayonnement et des interactions de toutes natures !
Sans compter des éléments spécifiques, comme par exemple les nuages, qui jouent un rôle majeur sur l’équilibre thermique de l’atmosphère, et dont il est très difficile de rendre compte numériquement.
Voici un exemple souvent cité des incohérences des modèles climatiques, en ce qui concerne leurs prévisions de la fonte de glace de mer dans l’Arctique jusqu’en 2100 (Eisenman I & T Schneider, 2011A72 p. 5328) :
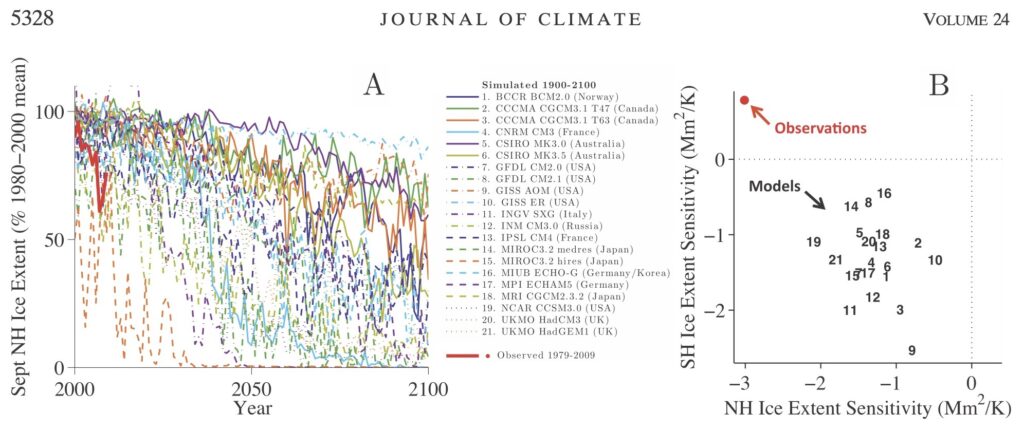
Différences entre les projections des MCG (modèles de circulation généraleN12) sur le taux de perte de glace de mer dans l'Arctique
(a) Chronologie des conditions saisonnières d'absence de glace dans l'océan Arctique, indiquée par l'étendue de la glace de mer de septembre dans l'hémisphère Nord au cours du 21e siècle, mise à l'échelle par la valeur moyenne de septembre 1980-2000 pour chaque modèle. Dans la moyenne de l'ensemble, 32 % de la couverture de glace de mer de septembre subsistera à la fin du siècle, mais les projections varient considérablement d'un MCG à l'autre, un modèle conservant plus de 85 % de la couverture de glace et quatre modèles en conservant moins de 1 %.
(b) Sensibilité de l'étendue de la glace de mer, définie comme le changement annuel moyen de l'étendue de la glace hémisphérique par changement de la température moyenne mondiale (Winton 2011A316), dans les deux hémisphères, dans les modèles et dans les observations — voir Appendix C.
Dans l’Appendix C il est précisé (Eisenman I & T Schneider, 2011A72 p. 5334) :
La sensibilité de l’étendue de la glace de mer pour chaque modèle est calculée en utilisant une régression totale des moindres carrés de l’étendue hémisphérique moyenne annuelle de la glace de mer sur la température moyenne mondiale annuelle, suivant la méthodologie de Winton (2011A316). Les températures observées proviennent de l’ensemble de données combinées terre-océan de la température de surface du GISS (GISTEMP).
Le météorologue Richard Lindzen commente cette image (2018A153 p. 8) :
Comme vous pouvez le constater, il existe un modèle pour chaque résultat. C’est un peu comme la formule pour devenir un tireur d’élite : tirez en premier et déclarez que ce que vous touchez est la cible.
Steven Koonin montre par ailleurs que les prédictions dépendent fortement du réglage des paramètres mettant en concurrence le réchauffement causé par les gaz à effet de serre, et le refroidissement dû aux aérosols — eux aussi partiellement liés à l’activité humaine (2021A135 p. 93) :
En d’autres termes, les chercheurs ont ajusté leur modèle pour que sa sensibilité aux gaz à effet de serre corresponde à ce qu’ils pensaient qu’elle devrait être. C’est ce que l’on appelle faire de la comptabilité.
Patrice Poyet commente (2022A221 p. 336) :
Lorsque ces phénomènes de sous-échelle sont traités avec des paramétrages qui n’ont rien à voir avec la physique et les lois fondamentales que l’on nous rappelle constamment pour justifier la crédibilité que nous devrions accorder au modèle, nous saisissons soudain le sens de cette simple citation de Freeman Dyson : « Ces gens-là ne regardent pas les observations. Ils sont dans un monde à eux. »
Pierre Morel, physicien théoriste en mécanique quantique statistique, a fondé en 1968 le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD, CNRS), puis il a dirigé l’Agence Spatiale Française en charge de la science et de la technologie (1975–1982) et le Programme mondial de recherche sur le climat (1982–1994). Il déclarait en conférence au Bureau des Longitudes (2009A187) :
En matière d’interprétation des signaux climatiques, l’examen intensif (et passionnel) des données globales s’apparente au test de Rorschach : on y trouve ce que l’on veut. Il est impossible de parvenir à une conclusion scientifiquement indiscutable sur la seule considération de quantités moyennes globales déduites d’observations archivées (a fortiori de reconstitutions historiques ou paléoclimatiques).
Syukuro Manabe, un des trois lauréats du Prix Nobel 2021, récompensé pour ses travaux de pionnier dans la modélisation du changement climatique, confiait en 2016 à Freeman Dyson, lui aussi Prix Nobel de physique : « Un modèle de climat est un très bon outil pour la compréhension du climat, mais c’est un très mauvais outil pour le prévoir. » Dans un entretien dont l’enregistrement a été partiellement censuré, Freeman Dyson déclarait à propos des modèles de climat (Poyet P, 2022A221 p. 353) :
C’est bien là le problème ! Il s’agit d’une vérité subventionnée, pour les gens qui croient les modèles. Je ne dis pas qu’ils sont malhonnêtes, mais je crois qu’ils sont inévitablement influencés par le fait qu’ils vivent de la peur du public. S’ils n’effrayaient pas le public, ils n’obtiendraient pas le soutien du gouvernement. Les militaires font la même chose. Je pense qu’ils ressemblent beaucoup aux militaires.
La modélisation (informatisée) du climat est une histoire sans fin, à la fois créatrice d’emplois et consommatrice de ressources financières (Poyet P, 2022A221 p. 318) :
Mais la vérité sur les capacités de ces logiciels n’est jamais aussi claire que lorsque leurs développeurs ont besoin d’énormes sommes d’argent pour prétendre mettre au point une nouvelle génération qui corrigera tous les défauts des outils précédents. Apparaissent alors à la lumière crue toutes les limitations, les hypothèses irréalistes, les reconstructions défectueuses du passé, et les affirmations factices de leurs prédictions pour l’avenir. L’inventaire effrayant de leurs limites réelles apparaît au fur et à mesure que la liste des nouveaux fonds nécessaires s’allonge pour rafistoler toutes les capacités soi-disant existantes, ou plutôt les anciennes tentatives ratées, afin de pouvoir prétendument les transformer cette fois-ci en boules de cristal bien nettes qui révèleront enfin le terrible avenir que le réchauffement anthropique nous promet. On rince et on recommence avec une nouvelle génération, deux milliards de plus dépensés, et un ancrage dans la réalité et un respect de la rigueur scientifique qui ne sont pas meilleurs.
Le réquisitoire des physiciens Gerlich et Tscheuschner était, quant à lui, sans appel (2009A89 p. 351) :
Il s’agit manifestement d’une description d’une méthode pseudo-scientifique (c’est-à-dire non scientifique) utilisée par les experts du GIEC. Le prochain niveau méta au-delà de la physique serait un questionnaire auprès des scientifiques comme celui déjà réalisé par von Storch (2007A28) ou, finalement, un vote démocratique sur la validité d’une loi physique. La science exacte va être remplacée par une méthodologie sociologique impliquant une analyse statistique de terrain, et par des règles « démocratiques » de fonctionnement. Cette démarche est en phase avec la définition de la science prônée par le site « scientifique » RealClimate.org qui a fait entrer les déclarations incendiaires, le recours aux attaques personnelles et les mises en cause d’auteurs dans son processus de travail « scientifique ».
Une analyse statistique, aussi sophistiquée soit-elle, repose fortement sur des modèles sous-jacents, et, si ces derniers sont manifestement erronés, l’analyse ne mène à rien. On ne peut pas détecter et attribuer quelque chose qui n’existe pas pour des raisons de principe, comme l’effet de serre du CO2. Il y a tant de problèmes non résolus et insolubles dans la non-linéarité, que les climatologues croient les surmonter tous en travaillant avec des approximations grossières conduisant à des résultats non physiques corrigés par la suite par des procédés mystérieux, le contrôle des flux dans le passé, d’obscures moyennes globales couvrant les instituts climatiques d’aujourd’hui, en excluant manuellement des résultats accidentels de refroidissement global (Stainforth DA et al, 2005A273) perpétuant une tradition de climatologie globale fondée sur l’effet de serre, de moyennes sans signification physique, et de recours à des statistiques mathématiques dénuées de sens du point de vue des sciences physiques.
Claude Allègre disait à la même époque (2010A9 p. 122) :
Nous avons trop de jeunes scientifiques qui sont fascinés par l’ordinateur. Ils négligent l’observation, le raisonnement, le bon sens. Ils préfèrent les spéculations et le virtuel plutôt que l’observation du réel. On sait pourtant ce que cette attitude intellectuelle nous a coûté dans le domaine bancaire ! Mais à voir ce qui s’est passé à Copenhague, on peut se demander si le virus du virtuel n’a pas atteint aussi le monde politique. Plutôt qu’agir, ne préfère-t-il pas spéculer, s’agiter et promettre ?
Aux lecteurs et lectrices sensibles à l’argument d’autorité, je rappelle que le géochimiste, géologue et géophysicien auteur de ce commentaire, était récipiendaire entre autres distinctions du prix Crafoord — équivalent du Nobel pour les Sciences de la Terre — et de la médaille d’or du CNRS. Il était par ailleurs membre de l’Académie des sciences de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Inde, du Portugal, et docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères. Claude Allègre a été vilipendé pour avoir osé exprimer des doutes sur la pertinence scientifique des conclusions du GIEC. Sans prendre de gants…
Cité par Judith Curry (2024A52 p. 129 ; 2023A51 p. 77), l’écrivain et financier Emanuel Derman écrivait (2012A60) :
Les modèles s’efforcent de comprimer une confusion jaillissante et bourdonnante dans un coffret minuscule à la Joseph Cornell, et ensuite, s’ils y parviennent plus ou moins, ils partent du principe que leur petite boîte, c’est le monde lui-même.
⇪ Autres approches méthodologiques
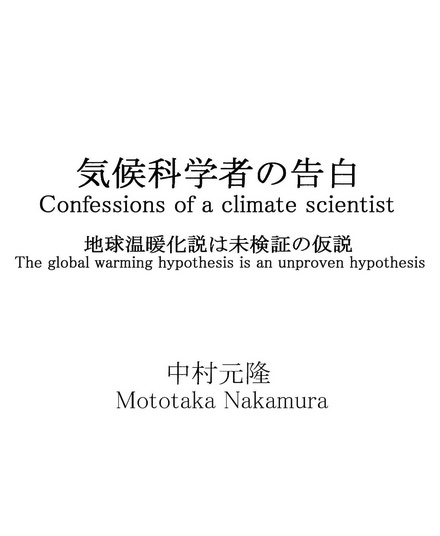
Certains artisans des modèles climatiques prédictifs ont rué dans les brancards. Par exemple, le spécialiste de la dynamique climatique et docteur en sciences de météorologie au MIT Mototaka Nakamura, qui a publié (en japonais) Confessions of a climate scientist : The global warming hypothesis is an unproven hypothesis (2018A199), dont des extraits sont commentés par Tony Thomas dans son article A Climate Modeller Spills the Beans (2019A282), ainsi que par Patrice Poyet (2022A221 p. 378–380).
Jean-Claude Pont écrit à son sujet (2020A218) :
Dans son ouvrage, Nakamura passe en revue les éléments qui constituent la colonne vertébrale de l’ensemble de la démarche conduite en vue de prédictions relatives à l’évolution du climat : température du globe, nuages de basse altitude, niveau des mers et des océans, mouvement des glaciers, etc. Dans chaque cas il montre que les particularités et les complexités du système climatique empêchent toute prédiction sérieuse quant à son évolution.
Pont cite et commente Nakamura, notamment (2020A218) :
Je tiens à souligner un fait simple : il est impossible de prédire correctement même le sens ou la direction du changement d’un système lorsque l’outil de prédiction n’a pas de représentation de processus non-linéaires importants et/ou les déforme grossièrement, les rétroactions en particulier, qui sont présentes dans le système réel. […]
On pourrait se demander : « Pourquoi faut-il tant se soucier des océans quand on parle de la température de l’atmosphère ? » Les flux océaniques jouent un rôle extrêmement important dans le climat. Ils sont beaucoup plus lents que les flux atmosphériques, mais transportent une très grande quantité de chaleur en raison de la grande capacité de stockage de chaleur de l’eau. La capacité de stockage de la chaleur océanique est tellement plus grande que celle de l’atmosphère qu’on peut dire que l’atmosphère n’emmagasine pas du tout de chaleur par rapport à l’océan. (…) Sans les flux océaniques, les variations climatiques seraient beaucoup plus simples.
Mototaka Nakamura est cité par Tony Thomas (2020A282) :
Pour le meilleur ou pour le pire, je me suis plus ou moins désintéressé de la science du climat et je ne suis pas ravi de consacrer autant de temps et d’énergie à ce genre d’écrits, au-delà du point qui satisfait mon propre sens de l’obligation envers les contribuables américains et japonais qui ont soutenu financièrement mes études supérieures et mes activités de recherche spontanées et gratuites. Je vous prie donc de vous attendre à ce que ce soit le seul écrit de ce type que je produise.
Je suis persuadé que certains scientifiques honnêtes et courageux continueront à dénoncer publiquement les affirmations frauduleuses de la communauté scientifique anglophone. Je regrette de devoir le dire, mais je suis également convaincu que les chercheurs japonais dociles et/ou incompétents resteront silencieux jusqu’à ce que le « courant dominant de la science du climat » change de ton, si tant est qu’il le fasse un jour.
Un autre grand climatologue du MIT qui a « viré de bord », faisant de lui la cible d’attaques ad hominem — à défaut d’un débat sur le contenu de ses interventions — est Richard Lindzen, qui sera présenté plus bas.
Ce qui précède ne devrait toutefois pas mener à la conclusion que toute étude formelle du système climatique de la Terre (Earth Climate System) est condamnée à l’échec ! Nous n’avons évoqué, jusqu’ici, qu’une méthodologie visant à produire des scénarios (annonciateurs du pire) pour inciter à « lutter contre le réchauffement climatique »…
D’autres voies de recherche sont explorées, comme par exemple l’identification de systèmeN32, une technique de l’automatique consistant à obtenir un modèle mathématique d’un système à partir de mesures. Voir par exemple G Bastin (2013A15), Nina Golyandina & Anatoly Zhigljavsky (2013A99), et Philippe de Larminat (2016A55) au sujet duquel Patrice Poyet écrit (2022A221 p. 376) :
De Larminat (2014A54) démontre très clairement que pour un système aussi complexe que le climat de la Terre, les techniques d’identification des systèmes fournissent des résultats objectifs et convaincants tels que :
• la période de réchauffement qui a conduit à l’optimum contemporain est essentiellement due à l’effet combiné de l’activité solaire et de la variabilité naturelle (qui se retrouve dans les résidus, comme les cycles de 60 ans qui résultent de paramètres qui ne sont pas pris en compte dans ce modèle de boîte noire) ;
• la contribution anthropique, si elle existe, ne se distingue pas suffisamment des effets précédents pour qu’on puisse prétendre la voir, et certainement pas avec le haut degré de certitude affiché par le GIEC.
Il est clair que les conclusions de ces scientifiques ne trouvent pas leur place dans les messages alarmistes dont se nourrit le discours sur le climat. Les politiciens, les médias et le public sont à l’affût de “breaking news”, ces informations « de dernière minute » qui réactivent des peurs anciennes et les « poussent à l’action »… L’incertitude pathétique des modèles prédictifs permet de recycler le même message sous une forme toujours changeante.
À propos des techniques d’identification des systèmes, Patrice Poyet poursuit (2022A221 p. 377) :
Les calculs de marge d’erreur et d’incertitude et les tests d’hypothèse fournissent toutes les validations nécessaires d’un point de vue scientifique. En outre, comme le rapporte Veyres [communication personnelle] : « Une démonstration plus visuelle de la précision des résultats trouvés est l’accord entre les résultats des calculs et les observations, et la capacité prédictive du modèle ; les simulations à l’aveugle sans aucune information sur les températures après l’année 2000 montrent avec une précision surprenante le “plateau” observé dans le réchauffement climatique depuis 2000. Pour ces prédictions à court terme, des estimations d’état par filtres de KalmanN33 sont utilisées, où l’état reflète l’accumulation de chaleur dans les océans. En plus des sensitivités, la méthode fournit une évaluation rigoureuse de la probabilité qu’un paramètre se trouve dans un certain intervalle, sans toutes ces déclarations très subjectives de “confiance” ou de “vraisemblance” ou de « probabilité subjective » qui ornent chaque paragraphe du rapport du GT1 du GIEC et dont Rittaud (2010A233 ; 2015A234) a souligné le caractère non scientifique. » […]
La vérité est que les meilleurs modèles météorologiques et les logiciels de simulation correspondants doivent être rappelés à la réalité en les confrontant aux données d’observation réelles toutes les six heures environ, sinon ils se perdent dans le fossé. Et, par une ironie du sort, pendant l’épidémie de COVID-19, du fait que la fréquence des vols internationaux a considérablement diminué, les observations faites par les vols commerciaux n’étaient plus disponibles comme d’habitude, et la qualité des prévisions météorologiques a considérablement baissé.
Un éventail de méthodes alternatives pour générer des scénarios de changement climatique est présenté par Judith Curry (2024A52 p. 185–220 ; 2023A51 p. 113–136). Trois modèles tiennent compte (1) de la variabilité naturelle interne — notamment l’oscillation atlantique multidécennale (AMON20) —, (2) de l’activité volcanique, et (3) des effets directs et indirects de l’activité solaire (qui font l’objet de débats). « Tous les scénarios de variabilité naturelle envisagés ici pointent dans la direction d’un refroidissement jusqu’en 2050 » (p. 204).
En ajoutant les 3 scénarios d’émissions SSP2‑4.5, qui recouvrent la zone du très probable du rapport AR6 du GIEC (+1.6 °C, +2.0 °C, +2.5 °C par rapport à la période de référence 1851–1900), on obtient quatre variables, et trois scénarios pour chacune d’entre elles, qui se déclinent donc en 34 = 81 scénarios associés à la juxtaposition des modèles. Judith Curry publie (2024A52 p. 206 ; 2023A51 p. 123) un histogramme des résultats de ces 81 scénarios, sur des bandes de largeur 0.2 °C, dont le pic se situe entre +1.1 °C et 1.5 °C. Elle écrit (2024A52 p. 205, 208 ; 2023A51 p. 123, 124) :
En choisissant le scénario intermédiaire pour chacune de ces variables, on arrive à un scénario de +1.43 °C, indiquant que nous ne devrions pas franchir le seuil des 1.5 °C avant 2050 (contre 2030 si l’on utilise la méthode de la meilleure estimation du SSP2‑4.5). […]
La convergence de contributions au refroidissement dues au soleil, aux volcans et à la variabilité naturelle interne durant la période 2020–2050 pourrait reculer de plusieurs décennies l’horizon temporel où la température de surface moyenne resterait inférieure aux seuils de 1.5 °C et 2.0 °C. Bien que le refroidissement solaire et volcanique puisse s’étendre sur l’ensemble du XXIe siècle, on peut s’attendre à ce que la variabilité interne naturelle bascule vers un réchauffement plus tard dans le XXIe siècle.
⇪ Quelles sont les causes du changement climatique ?

On s’intéresse ici à la relation possible — corrélation ou causalité — entre la teneur globale (d’origine naturelle et anthropique) en dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère terrestre et la température moyenne de la Planète. Autrement dit, ce qu’on appelle — de manière inappropriée (Gerlich G & RD Tscheuschner, 2009A89 p. 303–309) — « l’effet de serre » ou plus techniquement le forçage radiatifN5 induit par le CO2. C’est la pierre angulaire du discours sur le climat dans lequel se sont engagés inflexiblement (de nombreux) gouvernements, partis politiques, ONG et médias au début du 21e siècle.
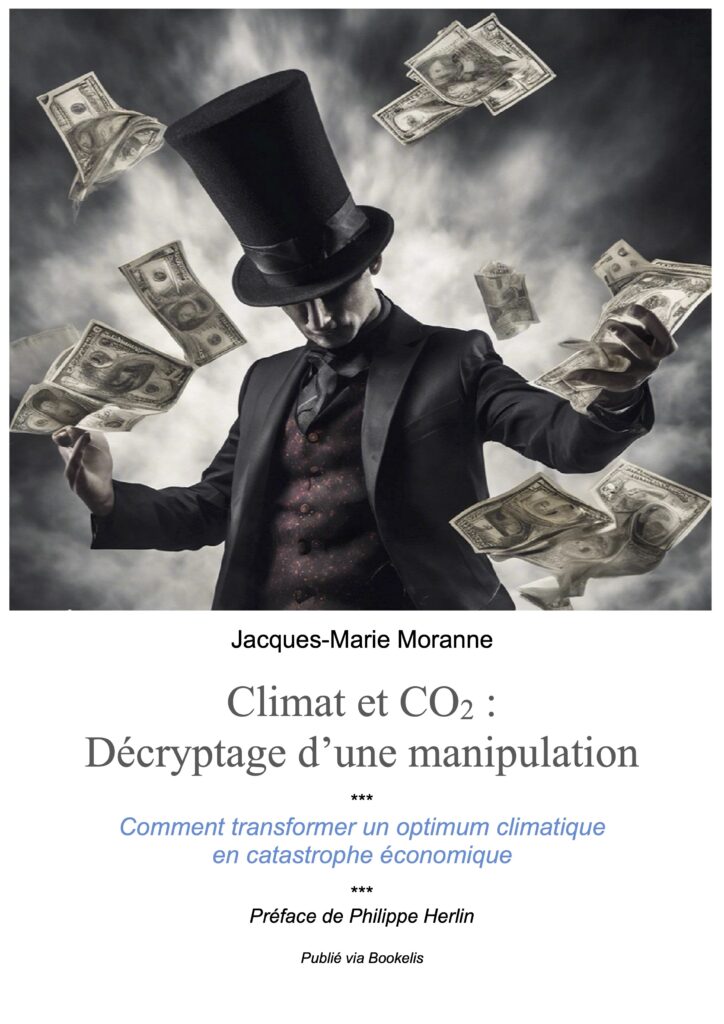
Aux personnes rebutées par les mots et concepts scientifiques du présent article, je recommande la lecture de l’ouvrage de Jacques-Marie Moranne (2024bA185). La qualité pédagogique de son exposé le rend accessible à un très large lectorat.
Les données sur les carottages de glace à Vostok, dans l’Antarctique, ont été présentées au public comme la preuve irréfutable d’un lien causal entre la concentration atmosphérique de gaz carbonique (CO2) et la température globale de l’atmosphère terrestre. La validité des mesures de taux de CO2, méthane (CH4) et autres gaz prisonniers des bulles des carottes glaciaires fait débat (Poyet P, 2022A221 p. 244–254 ; Dagsvik JK & SH Moen, 2023A53) mais un résumé de ces échanges techniques prendrait trop de place.
Les données sur les carottages ont été publiées par JR Petit et collègues (1999A214). Leur interprétation en termes de causalité CO2/température reste au cœur de controverses. Patrice Poyet écrit à ce sujet (2022A221 p. 456) :
L’article de Caillon et al. (2003A33), que Jean Jouzel a signé, et qui a été considéré à juste titre comme une découverte importante, montre simplement le contraire du postulat de base de la théorie CAGW [catastrophic anthropogenic global warming] en révélant que le CO2 suit la température d’environ 800 ans.
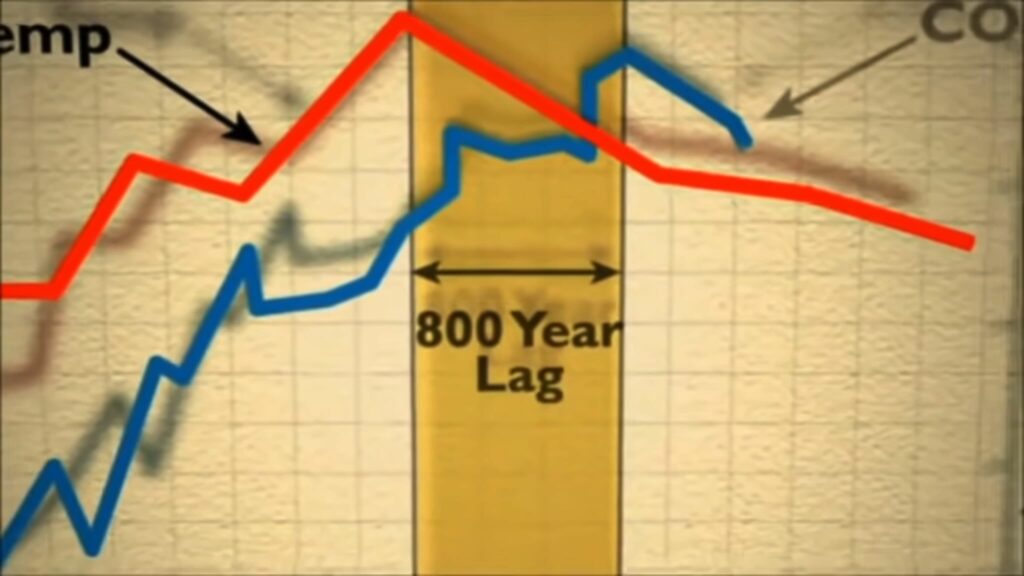
On peut voir, dans le film de Martin Durkin (2007A67 18:30), Al Gore postuler le lien causal en affichant les courbes parfaitement alignées des variations de CO2 et de température globale. Il en profite pour tourner en ridicule les sceptiques… Mais c’est l’arroseur arrosé, car le géologue Ian D Clark montre que les courbes sont en décalage temporel dans l’ordre inverse de ce qui était attendu (Durkin M, 2007A67 20:43 ; Clark I, 2023A43) !
À la question « Qu’a dit alors Jouzel ? », Claude Allègre répond (2010A9 p. 64) :
Il a signé le papier en faisant ajouter que le résultat ne prouvait pas que le CO2 n’avait pas d’influence (ce qui est, bien sûr, évident). Il a cherché des explications tarabiscotées. Et le malheureux chercheur qui avait fait cette découverte essentielle a été versé dans le corps des techniciens. Jouzel, lui, continue aujourd’hui encore, sur tous les plateaux de télévision, à proclamer la coïncidence entre les fluctuations du CO2 et de la température, le tout présenté comme la preuve que le CO2 est bien la cause première de la variation du climat.
François Gervais explique par ailleurs (2022A94 p. 124–125) :
[Les données] sont reproduites [figure ci-dessous] dans la version publiée par Richet (2021A232), censurée par la suite par l’éditeur sous la pression de l’antenne française du GIEC, comme relaté au Chapitre premier [2022A94 p. 40]. La température de la Terre a varié selon son ensoleillement, en suivant les cycles de MilankovitchN34 dus à l’excentricité, l’obliquité et la précession des équinoxes de notre Planète dans son mouvement autour du soleil. Pour chaque température, les carottages renseignent sur les concentrations atmosphériques de gaz carbonique et de méthane. Alors qu’une synchronicité est observée entre méthane et température, elle est discutable et discutée en ce qui concerne le CO2.
La synchronicité a été affirmée par Parrenin et al. (2013A211). Caillon et al. (2003A33) en revanche notaient un retard d’environ 800 ans du CO2 sur la température. Pour sa part, reprenant une méthode usuelle en spectroscopie, Pascal Richet (2021A232) s’est intéressé à la largeur à mi-hauteur des descentes de température et de concentration de CO2. Dans la figure [ci-dessous], les traits épais horizontaux soulignent des intervalles de temps différents pour la chute des deux grandeurs. Et c’est toujours le CO2 qui est en retard sur la température. Le retard peut atteindre 7000 ans. L’absence de synchronicité souligne l’absence de corrélation, et donc a fortiori l’absence de causalité. Richet (2021A232) conclut : « Interpréter les séries de CO2 et de température des carottes de glace à la lumière des modèles climatiques s’avère méthodologiquement erroné. » […]
Pascal Richet ajoute : « Cela n’a aucun sens de mettre autant l’accent sur les effets du CO2 dans les modèles climatiques ou sur les réductions d’émissions dans les politiques gouvernementales. » On comprend que cela n’ait pas plu aux gardiens du temple, d’où leur acharnement à censurer.
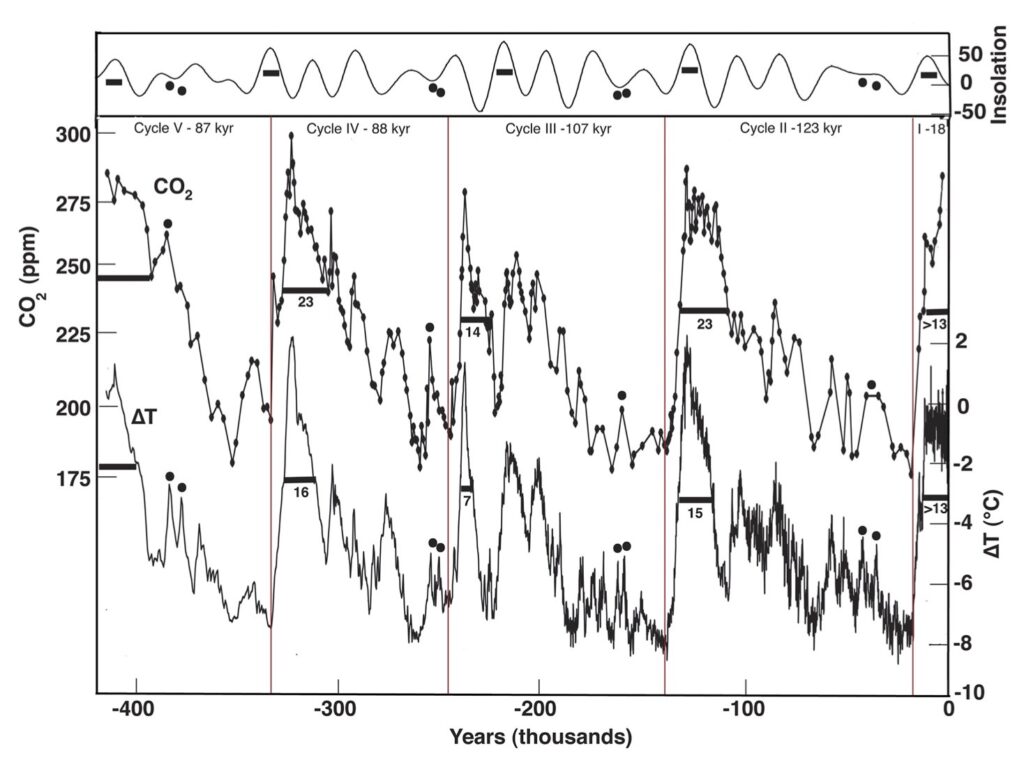
L’analyse des carottes de glace correspondant à l’ère géologique du Cénozoïque — qui a débuté il y a 66 millions d’années — confirme l’absence de lien de causalité entre les taux de CO2 et la température terrestre. Au terme d’un article très technique, Patrick Frank conclut (2024A84 p. 17) :
Enfin, la correspondance entre les estimations de l’hypothèse nulle, le P(CO2) de substitution et la reproduction de la loi de Henry de l’enregistrement VOSTOK implique que la température de surface de la mer [SST] a été le principal déterminant du P(CO2) atmosphérique de base pendant tout le Cénozoïque. L’influence de la SST signifie que le CO2 ambiant n’est libéré ou dissous qu’après un changement positif ou négatif de la température globale de l’océan. La corrélation entre la P(CO2) et la température de surface à travers les temps géologiques provient alors de la solubilité changeante du CO2 en réponse à la variation indépendante de la SST. Les prélèvements de carbonate à l’échelle géologique ou les rejets de CO2 ont considérablement modifié les données, mais ces changements ne sont pas nécessaires pour expliquer la P(CO2) ou la température de surface. En d’autres termes, l’interprétation la plus parcimonieuse des données du Cénozoïque est que la température de l’océan a augmenté avec l’activité magmatique à grande échelle et qu’elle a diminué en son absence. La P(CO2) a suivi.
Dans cette optique, le CO2 atmosphérique a été un spectateur moléculaire de l’évolution du climat. L’interposition du forçage radiatif d’une augmentation ou d’une diminution exogène du CO2, qui déclenche et maintient un changement de la SST, est superflue pour une explication simple du climat et de la P(CO2) : plus chaude/élevée pendant les périodes magmatiques vigoureuses, et plus froide/abaissée en leur absence. La notion de forçage exogène du CO2 n’apporte aucune valeur explicative supplémentaire. En dehors des événements bio- et/ou géophysiques à l’échelle géologique, la SST semble avoir entièrement régi la teneur en CO2 de l’atmosphère au cours des 66 années de vie du Cénozoïque. Une conclusion générale est que le dogme du CO2 atmosphérique comme moteur prédominant de la température à la surface du globe devrait être mis de côté.
Ce phénomène est-il observable à plus petite échelle ? François Gervais cite des auteurs qui répondent par l’affirmative (2022A94 p. 138) :
La corrélation et le retard du CO2 sur la température, l’inverse de ce à quoi on s’attendrait selon le théorie de l’effet de serre atmosphérique, ont été confirmés et discutés par de nombreux auteurs : Kuo et al. (1990A144), Park (2009A209), Quirk (2009A224), Essenhigh (2009A76), Beenstock et al. (2012A17), Salby (2012A240), Gervais (2014A90), Harde (2017A108 ; 2019A109), Berry (2019A20), Stallinga (2020A274), Koutsoyiannis & Kundzewicz (2020A138).
Demetris Koutsoyiannis et al. (2023A142) ont exploré les liens de causalité en termes de « l’œuf ou la poule » :
L’étude a examiné si la chaîne de causalité généralement supposée est étayée par des données ou, au contraire, si une relation de causalité de type poule ou œuf (HOE) est plus plausible. […]
Ces développements incluent un cadre théorique avancé pour tester la causalité basée sur l’évolution stochastique d’un lien potentiellement causal entre deux processus via la notion de fonction de réponse impulsionnelle. Toutes les preuves résultant des analyses suggèrent un lien de causalité potentiel unidirectionnel avec T comme cause et [CO2] comme effet.
Dans un article sous-titré « Est-ce la queue qui fait remuer le chien ? », l’auteur écrit (Koutsoyiannis D, 2024A141 p. 68) :
Selon les calculs présentés ici et la représentation des résultats dans la figure 24, la contribution du CO₂ à l’effet de serre est de 4 à 5 %. Les émissions humaines de CO₂ représentent 4 % du total, ce qui signifie que la contribution humaine totale à l’augmentation de l’effet de serre est de 0,16 % à 0,20 % — un effet négligeable. Quelle que soit l’origine de l’augmentation du [CO₂] au cours du siècle dernier, sa contribution à l’effet de serre est d’environ 0,5 %, ce qui est inférieur à tout seuil permettant de l’observer. En revanche, l’eau (y compris les nuages) contribue à l’effet de serre atmosphérique à hauteur de 87 % à 95 %.
Patrice Poyet défend la même conclusion : « Le CO2 suit la température » (Poyet P, 2022A221 p. 51–56). Il cite notamment Ole Humlum et al. qui concluaient (2013A120 p. 51, 67) :
La corrélation positive maximale entre le CO2 et la température est observée lorsque le CO2 accuse un retard de 11 à 12 mois par rapport à la température de surface de la mer, de 9.5 à 10 mois par rapport à la température de l’air de surface, et d’environ 9 mois par rapport à la température de la troposphèreN13 inférieure. […]
En résumé, les données mensuelles depuis janvier 1980 [jusqu’à décembre 2011] sur le CO2 atmosphérique et les températures de l’air et de la mer démontrent sans ambiguïté que la séquence des événements de changement de la température globale est 1) la surface de l’océan, 2) l’air de surface, 3) la troposphère inférieure, et que les changements du CO2 atmosphérique sont toujours en retard par rapport aux changements de l’un ou l’autre de ces différents enregistrements de la température.
François Gervais cite, comme exemple sur une période très courte, la comparaison de l’évolution de la température de la Terre mesurée par satellite pendant le pic El Niño de début 2016 à l’évolution du taux de CO2 dans l’atmosphère (2022A94 p. 134) :
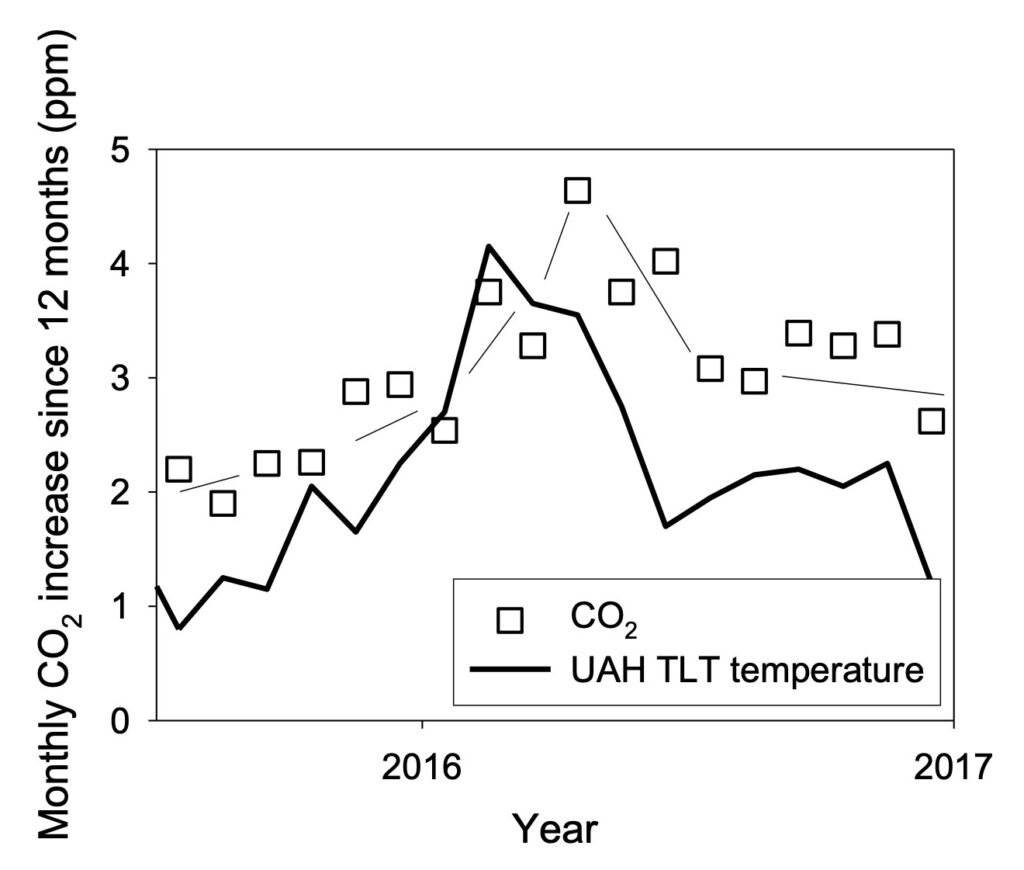
Il s’interroge par ailleurs sur ce qui influence les variations des taux de CO2 et des températures (Gervais F, 2022A94 p. 134–135, 138) :
L’année 1992 a été froide. L’éruption du volcan Pinatubo en 1991 a envoyé quantité d’aérosols dans la haute atmosphère qui ont momentanément voilé le rayonnement solaire, provoquant une baisse de température, et ce en dépit d’un épisode El Niño cette année-là et le la bouffée de CO2 crachée par le volcan. Une évolution d’un facteur 10 du CO2 annuel ne saurait traduire des différences d’émissions anthropiques, car elles restent assez similaires d’une année à l’autre. […] Le lien et le retard du CO2 sur la température nous amènent à envisager une composante naturelle de son augmentation dans l’atmosphère. D’où viendrait-il ? Des continents ou des océans ? La figure [ci-dessous] compare l’oscillation saisonnière du CO2 en 1992, année froide donc, à celle de 1998, année chaude due à un pic El Niño, recalée sur la première. Les deux courbes sont quasiment superposées. La composante continentale de la variation du CO2, ainsi mesurée à partir de son interaction avec la végétation, ne semble pas affectée par la température de l’année. […]
[…] contrairement à ce que suggèrent Zeng et al. (2005A319), les fluctuations El Niño/La Niña ne sont pas le seul facteur, puisque l’épisode El Niño de 1992 a été contrecarré par le refroidissement dû aux aérosols envoyés dans l’atmosphère par le volcan Pinatubo, et la chute de température qui a suivi, y compris celle des océans.
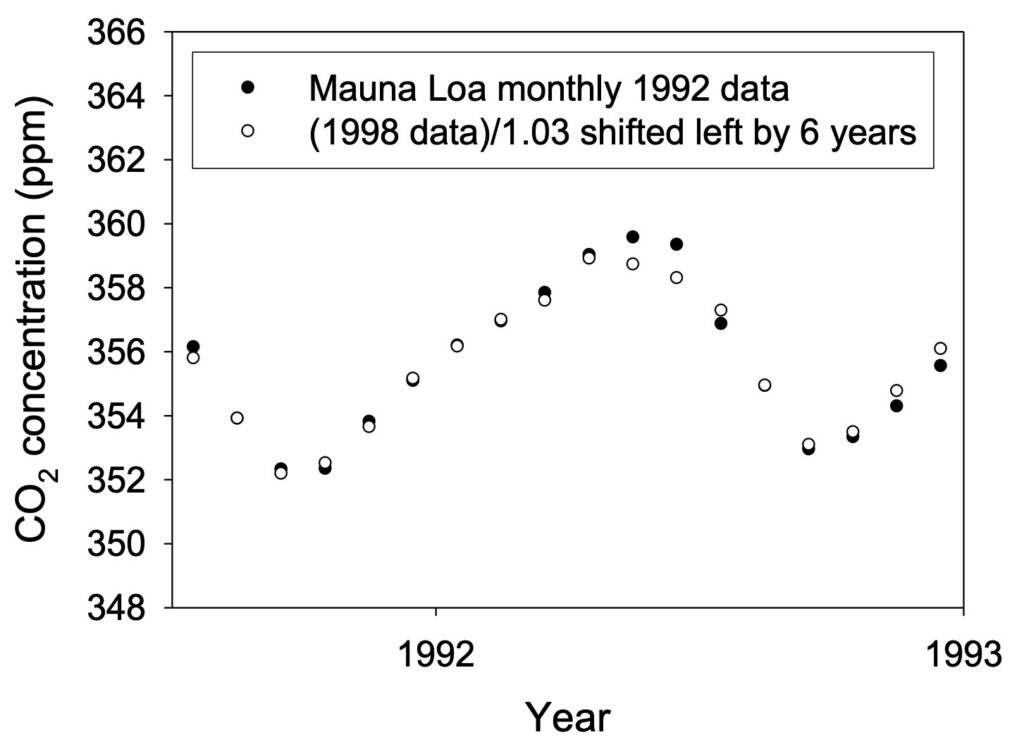
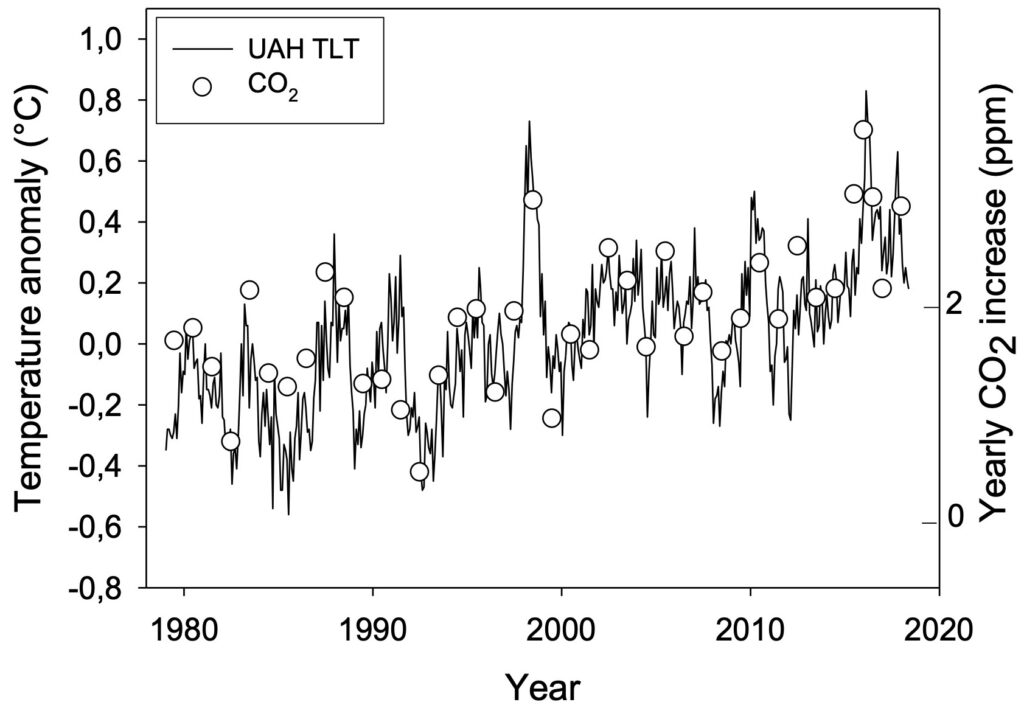
Patrice Poyet s’attaque à d’autres mythes (2022A221 p. 55) :
L’étape suivante de cette logique défectueuse [du couplage entre CO2 et température] consiste à élaborer des notions physiques telles que les « forçages » (Myhre G et al., 2013A193), les « rétroactions » et autres qui sont inconnues de la physique, comme nous le rappellent Gerlich et Tscheuschner (2009A89) : « La principale stratégie des défenseurs de l’effet de serre du CO2 semble se cacher derrière de plus en plus de pseudo-explications tirant parti de principes qui ne sont généralement pas enseignés en physique. Un exemple est celui des calculs de transfert radiatif que probablement peu de gens connaissent. Un autre exemple est celui des rétroactions utilisées pour amplifier un effet qui n’est même pas marginal puisqu’il n’existe pas du tout. Manifestement, les défenseurs de la thèse du “CO2-effet de serre” refusent d’accepter des calculs reproductibles pour s’expliquer et ont recours à des calculs non reproductibles.«
Severinghaus (2004A261) ne fait pas exception à la règle en déclarant : « Ce processus entraîne également une augmentation du CO2, environ 800 ans plus tard. Le CO2 réchauffe alors davantage la planète entière, en raison de ses propriétés de piégeage de la chaleur. Cela conduit à une libération encore plus importante de CO2. Il faut donc considérer le CO2 pendant les périodes glaciaires comme une “rétroaction”, un peu comme celle qui se produit lorsqu’on place un microphone trop près d’un haut-parleur. » Ainsi, le troisième auteur d’un article majeur publié dans la principale revue à comité de lecture, à savoir Science, déclare honnêtement et presque candidement, un an après sa publication, qu’il n’a aucune idée de ce qui commence à réchauffer notre monde à partir d’une période glaciaire, mais qu’il sait avec certitude ce qui a causé le réchauffement des trois dernières décennies, invoquant la pseudo-physique des « rétroactions ». Ce n’est plus une discussion géochimique qui prévaut ici, c’est le domaine de la psychologie cognitive rempli de dissonances cognitives et de biais de confirmation qui empêchent même les gens intelligents de s’écarter de l’assurance dogmatique et des croyances sécurisantes.
Le résumé de l’article de Gerlich et Tscheuschner est explicite de leur approche critique en tant que physiciens (2009A89) :
L’effet de serre atmosphérique, une idée que de nombreux auteurs font remonter aux travaux traditionnels de Fourier (1824A83), Tyndall (1861A292) et Arrhenius (1896A11), et qui est toujours soutenue dans la climatologie mondiale, décrit essentiellement un mécanisme fictif dans lequel une atmosphère planétaire agit comme une pompe à chaleur actionnée par un environnement qui interagit radiativement avec le système atmosphérique, mais qui est équilibré radiativement par rapport à lui. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, une telle machine planétaire ne peut jamais exister. Néanmoins, dans presque tous les textes sur la climatologie mondiale et dans une littérature secondaire très répandue, on tient pour acquis qu’un tel mécanisme existe et qu’il repose sur une base scientifique solide.
Dans cet article, la conjecture populaire est analysée et les principes physiques sous-jacents sont clarifiés. En montrant que (a) il n’y a pas de lois physiques communes entre le phénomène de réchauffement dans les serres et les effets de serre atmosphériques fictifs, (b) il n’y a pas de calculs pour évaluer une température moyenne à la surface d’une planète, (c) la différence de 33° souvent mentionnée est un nombre sans signification calculé de manière erronée, (d) les formules du rayonnement de cavité sont utilisées de manière inappropriée, (e) l’hypothèse d’un équilibre radiatif est contraire à la physique, (f) la conductivité thermique et le frottement ne doivent pas être négligés, la conjecture de l’effet de serre atmosphérique est falsifiée.
Et plus loin (op.cit. page 280) :
Les climatologues mondiaux affirment que l’effet de serre naturel de la Terre maintient la Terre à 33° C de plus qu’elle ne le serait sans les gaz à l’état de traces présents dans l’atmosphère. Environ 80 % de ce réchauffement est attribué à la vapeur d’eau et 20 % aux 0.03 % de volume de CO2. Si un tel effet extrême existait, il se manifesterait même dans une expérience de laboratoire impliquant du CO2 concentré, sous la forme d’une anomalie de conductivité thermique. Il se manifesterait sous la forme d’un nouveau type de « super-isolation » violant l’équation conventionnelle de conduction de la chaleur. Mais de telles anomalies de transport de chaleur n’ont jamais été observées dans le cas du CO2. C’est pourquoi, dans cet article, les idées populaires sur les effets de serre entretenues par la communauté climatologique mondiale sont réexaminées dans le cadre de la physique théorique et expérimentale.
Les auteurs examinent, une par une, quatorze définitions d’un (hypothétique) « effet de serre radiatif » du CO2 dans l’atmosphère terrestre, dont ils démontrent la vacuité (Gerlich G & RD Tscheuschner, 2009A89 p. 303–309). Une source d’erreurs est liée à la confusion entre absorption/émission et réflexion (op.cit. p. 312–315). La réflexion sur une couche gazeuse n’est possible que pour des ondes radio de relativement faibles fréquences, ce qui est loin d’être le cas de radiations situées dans l’infrarouge.
Georges Geuskens expliquait l’impossibilité d’un effet de serre radiatif causé par le CO2, résumée ainsi (2019A97) :
1° L’effet de serre, qui résulterait de la désactivation radiative (fluorescence) de molécules ayant absorbé une fraction du rayonnement thermique de la Terre, ne peut exister au niveau des basses couches atmosphériques.
2° Au niveau des basses couches atmosphériques, les molécules ayant absorbé une fraction du rayonnement thermique de la Terre se désactivent par collisions avec les molécules environnantes, principalement N2 et O2.
Ce sujet a été traité plus récemment dans un exposé de Jean Van Vliet : Pourquoi l’effet du CO2 sur le climat est exclu par la physique (2023A295). Parmi les objectifs (p. 4) :
[…] examiner à la lumière de la physique trois phénomènes naturels impactant les températures terrestres :
• le transfert de chaleur vertical dans l’atmosphère ;
• l’énergie corpusculaire en provenance du Soleil ou vent solaire ;
• l’inertie thermique des océans et des glaces permanentes.
Jean Van Vliet rappelle avec justesse (p. 20) :
La physique est une science exacte avec des règles strictes, et difficilement accessible aux médias ; la climatologie est au contraire une science humaine, ouverte à l’appréciation et aux pressions politiques.
Dans les commentaires (2023A295), Jacques-Marie Moranne remarque que Vliet n’a pas évoqué « l’évaporation, et l’évacuation de chaleur latente qui en résulte ». Jean Van Vliet répond :
Suivant une pratique courante en astrophysique, j’ai voulu axer la présentation sur les modes de transfert thermique vertical plutôt que, comme les rapports successifs du GIEC, sur un « Earth Heat Budget » dont beaucoup d’éléments sont discutables. L’objet de mon article est notamment de montrer l’importance écrasante du mode de transfert convectif dans la troposphère : la convection atmosphérique est un phénomène général, elle est présente aussi bien en milieu tropical qu’en milieu désertique. Elle n’est pas influencée par les GES. La seule exception à la convection dans la troposphère est locale : c’est l’inversion de température.
L’évaporation amplifie considérablement le mouvement convectif de l’air comme le montrent les orages et autres tornades et ouragans, mais elle ne fait qu’encore renforcer le caractère déjà prédominant de la convection dans la troposphère.
En résumé (Moranne JM, 2024bA185 p. 116) :
Au niveau du sol : la présence des « gaz à effet de serre » (CO2 et vapeur d’eau) dans l’atmosphère empêche la surface du sol et des océans de renvoyer la chaleur qu’elle reçoit du soleil : c’est ce qui la réchauffe.
Ce réchauffement est limité lorsque la température est suffisante pour que l’évaporation et la convection renvoient en altitude l’excédent de chaleur ainsi produit, c’est-à-dire, en moyenne, à 15°C.
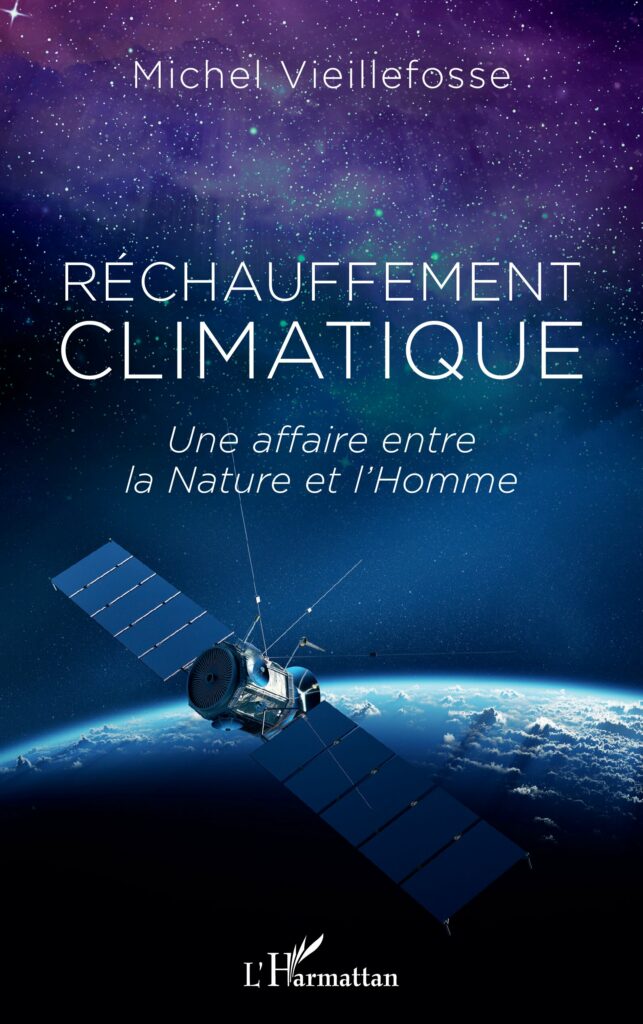
Michel Vieillefosse, un des pionniers de l’auscultation de la Terre par satellite, longtemps associé aux programmes de la NASA et de l’agence spatiale russe, a cherché à évaluer la part des phénomènes naturels et celle de l’Homme dans l’évolution du climat : « Le CO2 s’efface devant d’autres facteurs anthropiques plus importants : la déforestation, l’imperméabilisation des sols » ainsi que les îlots de chaleur urbains et les fuites de méthane (2022A304 — voir résumé).
À partir de données satellitaires et terrestres, Ned Nikolov et Karl F Zeller ont montré que le réchauffement des 55 dernières années résulte principalement d’une diminution de l’albédoN29 de la Terre, principalement due à une raréfaction de la couche nuageuse basse au-dessus des océans (2024A203 p. 311) :
Notre analyse a révélé que la diminution observée de l’albédo planétaire ainsi que les variations signalées de l’irradiation solaire totale (TSI) expliquent 100 % de la tendance au réchauffement climatique et 83 % de la variabilité interannuelle de la température de l’air à la surface de la Terre, comme l’ont montré six systèmes de surveillance par satellite et au sol au cours des 24 dernières années. Les modifications de l’albédo des nuages terrestres sont apparues comme le principal moteur de la température globale de l’air à la surface de la Terre (GSAT), tandis que l’irradiation solaire totale (TSI) n’a joué qu’un rôle marginal. Le nouveau modèle de sensibilité climatique nous a également aidés à analyser la nature physique du déséquilibre énergétique de la Terre (EEI), calculé comme la différence entre les ondes courtes absorbées et les ondes longues émises au sommet de l’atmosphère. Les observations et les calculs du modèle ont révélé que le déséquilibre énergétique de la Terre résulte d’une atténuation quasi-adiabatique des flux d’énergie de surface qui traversent un champ de pression atmosphérique décroissant avec l’altitude. En d’autres termes, la dissipation adiabatique de l’énergie cinétique thermique dans les parcelles d’air ascendantes donne lieu à un IEE apparent, qui ne représente pas un « piégeage de la chaleur » par l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, comme on le suppose actuellement. Nous fournissons des preuves numériques que l’IEE observé a été interprété à tort comme une source de gain d’énergie par le système terrestre sur des échelles de temps multidécennales.
⇪ Durée de vie du CO2 d’origine anthropique
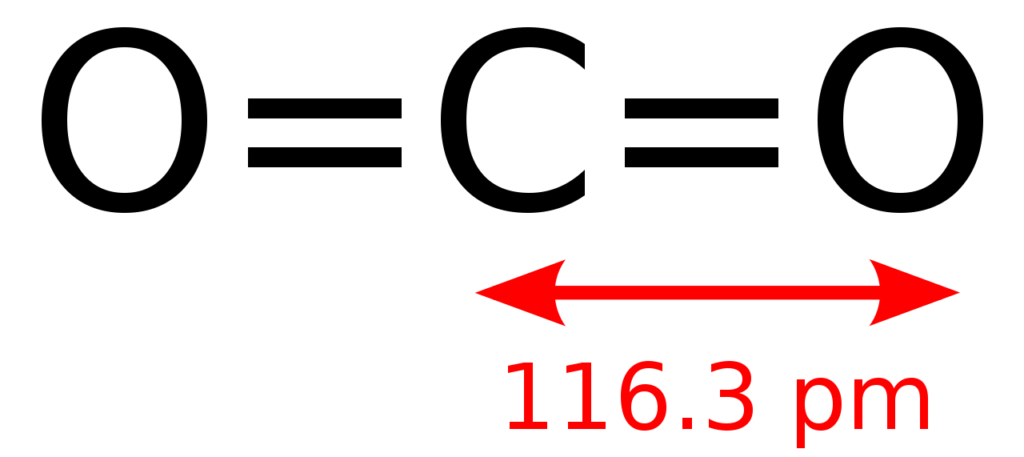
Examinons maintenant l’affirmation (du GIEC) selon laquelle le CO2 d’origine anthropique — produit par les activités humaines — aurait un temps de résidence dans l’atmosphère d’une centaine d’années, contrairement au CO2 émis naturellement dont le temps de résidence est de l’ordre d’une dizaine d’années. L’expression « temps de résidence » est un terme technique qui s’apparente à la « durée de vie ».
Selon cette thèse « réchauffiste », l’accroissement du taux de CO2 depuis le début de l’ère industrielle (1750) serait intégralement causé par les émissions anthropiques. Quelle que soit la vérité du couplage entre CO2 global et température, une telle augmentation finirait par devenir problématique pour la biosphère et la survie de l’espèce humaine. Les auteurs de romans et films de science fiction sont friands de ce scénario…
Par contre, si — comme plaidé dans la section précédente — l’accroissement du taux de CO2 dans l’atmosphère est une conséquence, et non la cause, du réchauffement, on peut montrer que le temps de résidence du CO2 d’origine anthropique n’est pas différent de celui du CO2 d’origine naturelle. Dans ce cas, le taux de CO2 global serait simplement corrélé aux cycles de variation de la température, comme observé dans les millénaires précédents. Tout projet de « décarbonation » serait aussi inefficace qu’inutile.
La parole est aux physiciens… Seules leurs conclusions ont été reprises ici. Il faut suivre les liens pour naviguer dans les équations et saisir toutes les étapes de leurs raisonnements !
Patrice Poyet (voir sa présentation et sa liste de publications) débute ainsi son exposé Anthropic CO2 is 6 % of Tropospheric [CO2] (2022A221 p. 35) :
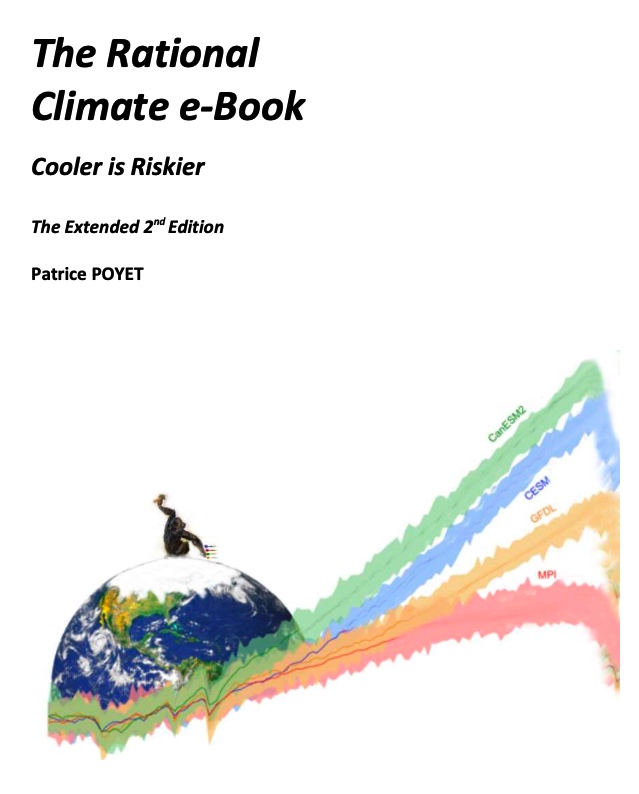
L’un des principaux arguments brandis par les alarmistes est que la majeure partie du CO2 émis par l’utilisation de combustibles fossiles est restée dans l’atmosphère, qu’elle continuera à le faire pendant plus d’un siècle, et que ses effets néfastes seront différés et ressentis par les générations futures. Essayant ainsi de nous faire porter le chapeau, dès maintenant, pour que des mesures immédiates soient prises afin de réduire les émissions au plus vite, quelles que soient les conséquences économiques désastreuses que cela pourrait entraîner. Cela ne résiste même pas à une vérification rapide des faits.
En effet, le flux dégazé par les océans chauds entre les tropiques et par les sols où se décompose la matière organique est du même ordre de grandeur que le flux absorbé par les océans froids des hautes latitudes et par la végétation, mais jamais tout à fait égal, car ces flux absorbés et dégazés dépendent des températures, des précipitations et des vents dans les zones correspondantes, ainsi que du volume de végétation qui augmente en fonction de la teneur de l’air en dioxyde de carbone. Le rapport (quantité annuelle / flux) entre la quantité de carbone atmosphérique (dans le CO2 de l’air) et le flux absorbé chaque année par la végétation et par les océans aux hautes latitudes est de l’ordre de quatre à cinq, d’où une durée de séjour moyenne dans l’air d’une molécule de CO2 de 4 à 5 ans.
Un cinquième du CO2 de l’air est absorbé chaque année, environ la moitié par la végétation et l’autre moitié par les océans froids des hautes latitudes à leur surface ; presque autant est dégazé par les sols, où la végétation se décompose, et par les océans chauds à leur surface. Il apparaît que les combustibles fossiles ne constituent que 6 % du CO2 de l’air (contre 2 % en 1958), les 94 % restants provenant du dégazage naturel des océans et des sols, en milliards de tonnes de carbone, Gt‑C ou gigatonnes de carbone : 10 Gt‑C/an de « fossiles » contre quelque 170 Gt‑C/an de « dégazage naturel » (Moranne JM, 2024aA184).
L’auteur continue avec un calcul justificatif, suivi d’un exposé technique sur le rapport isotopique du carbone (pages 35–50)…
François Gervais affiche le même résultat en résumant ainsi (2022A94 p. 139) :
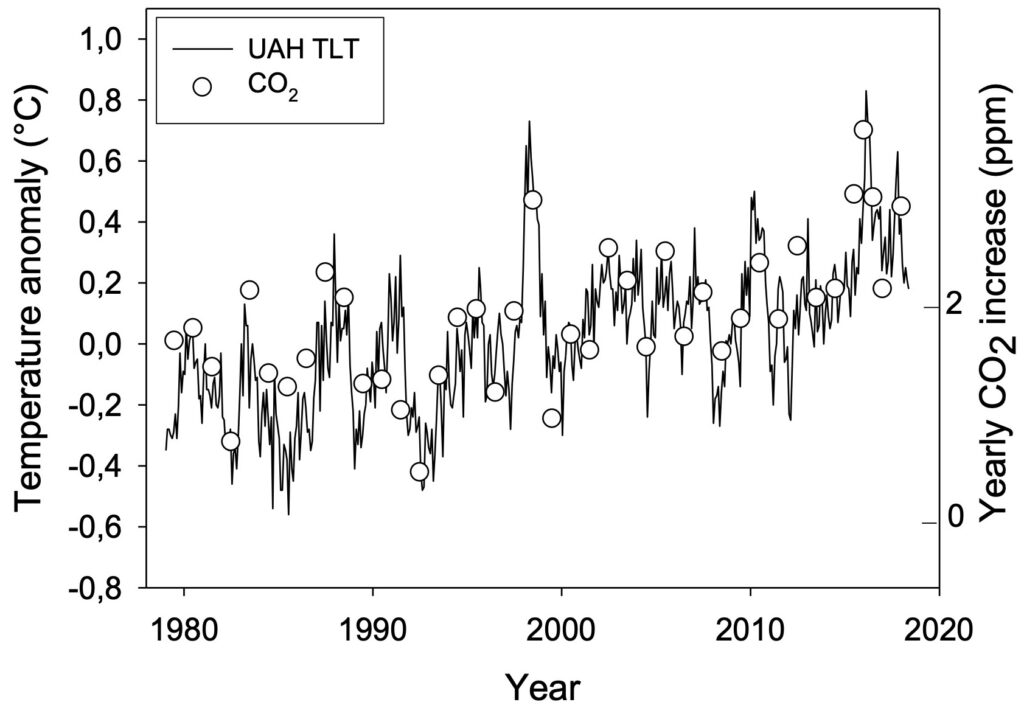
Un autre sujet de controverse concerne le temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère. Un élément de réponse a trait au rapport isotopique 13C/12C (Segalstad 1998A260). Le carbone provenant des ressources fossiles affiche un rapport entre les isotopes 12 et 13, 13C/12C de ~ 2.1 % alors que le rapport est de seulement ~ 0.7 % pour le CO2 naturel. Le. rapport a évolué de ~ 0.76 % mesuré en 1982 dans l’atmosphère à ~ 0.85 % en 2017, suggérant une fraction de seulement 6 % de résidu anthropique. Ce résultat correspond à une durée de vie de la perturbation des émissions anthropiques d’à peu près 5 ans : Essenhigh (2009A76), Gervais (2014A90), Harde (2019A109), Poyet (2022A221), Harde et Salby (2021A107). La fraction résiduelle du CO2 anthropique se situerait ainsi au niveau du plus faible ajout observé en 1992 [figure ci-contre].
Demetris Koutsoyiannis arrive à la même conclusion par d’autres moyens (2024A140):
Le cadre proposé [modélisation non-linéaire du routage de réservoir] peut également être utile pour des tâches climatiques, telles que la description du bilan de masse du dioxyde de carbone atmosphérique et la détermination des temps de résidence caractéristiques, qui ont fait l’objet de controverses. L’application du cadre théorique donne d’excellents résultats avec les données du monde réel. Ainsi, nous quantifions facilement les échanges de carbone atmosphérique et obtenons des résultats fiables et intuitifs, sans devoir recourir à des modèles climatiques complexes. Le temps de résidence moyen du dioxyde de carbone atmosphérique s’avère être d’environ quatre ans, et le temps de réponse est inférieur à cette durée, ce qui va à l’encontre des estimations courantes beaucoup plus longues.
Cité par Gervais, Robert H Essenhigh exposait déjà (2009A76 p. 2273) :
Si les résultats du [temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère] court (5–15 ans) ont été montrés en quasi-équilibre, cela confirme la conclusion (fondée sur des données indépendantes) selon laquelle l’augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 à long terme (environ 100 ans) ne provient pas de sources anthropogéniques mais, conformément aux conclusions d’autres études, très probablement de l’augmentation de la température atmosphérique qui est due à d’autres facteurs naturels. Cela confirme la conclusion selon laquelle le réchauffement climatique n’est pas d’origine anthropique comme un produit de combustion. L’incidence économique et politique de cette conclusion est évidente.
L’article de Hermann Harde présente de manière compréhensible le modèle des physiciens et ceux du GIEC basés sur trois groupes d’hypothèses : Constant Airborne fraction, Bern Model et Absorption Scales with Concentration. Harde écrit (2019A109 p. 144, accent mis par mes soins) :
Ainsi, avec des paramètres bien choisis, toutes les approches étudiées peuvent très bien reproduire les observations effectuées à Mauna Loa. Mais ces modèles sont basés sur des hypothèses et des conditions limites différentes, certains d’entre elles étant même en contradiction mutuelle. Par conséquent, un seul d’entre eux, voire aucun, pourrait être correct. Une bonne conformité avec les observations n’est pas un critère suffisant pour tester la validité d’un modèle, celui-ci doit également être en accord avec les principes physiques de base. Ces derniers sont les seuls à pouvoir nous fournir des explications physiquement cohérentes pour un cycle du carbone, qui est dominé par plus de 95 % des émissions naturelles, et qui est à l’origine d’impacts environnementaux continuels. Il est également évident que ce cycle est régi par les mêmes principes à l’époque paléoclimatique qu’aujourd’hui avec les émissions humaines.
La réactivité du CO2 atmosphérique aux émissions de combustibles fossiles a été examinée par Jamal Munshi (2017A191) :
Ces résultats sont cohérents avec ceux d’études antérieures qui n’ont trouvé aucune preuve de l’existence d’un lien entre le taux de réchauffement et les émissions. Ils impliquent que le budget carbone du GIEC est défectueux, peut-être en raison d’une prise en compte insuffisante de l’incertitude, d’une confiance excessive dans les flux nets, et de l’utilisation d’un raisonnement circulaire qui sous-entend un rôle des émissions de combustibles fossiles dans l’augmentation observée du CO2 dans l’atmosphère.
Il va de soi que les fortes variations de taux atmosphérique de CO2 à l’époque paléoclimatique, déduites de l’analyse des carottages de glace, étaient d’origine naturelle… L’auteur conclut (Harde H, 2019A109 p. 145, 154) :
[…] les molécules émises naturellement et celles émises par l’homme ne peuvent pas être traitées différemment. Tant qu’aucune saturation de l’absorption n’est observée, ce qui n’est pas le cas […], une émission supplémentaire par l’Homme doit sous-tendre le même processus d’absorption que les émissions naturelles. Les séparer serait en contradiction flagrante avec le principe d’équivalence. En application de ce principe, il ne doit exister qu’un seul temps d’absorption, τR, avec le même comportement d’absorption, pour les émissions humaines et naturelles. […]
L’augmentation du CO2 au cours des dernières années peut être expliquée par une seule équation d’équilibre, la Loi de Conservation (Lüdecke HJ & CO Weiss, 2016A162), qui couvre dans son entier le cycle du CO2 atmosphérique, comprenant la température et donc des processus d’absorption naturels dépendant du temps, les activités humaines et un processus d’absorption dépendant de la température, à une échelle proportionnelle à la concentration actuelle. Cette absorption est caractérisée par une échelle de temps unique, le temps de résidence d’environ 3 ans, qui a augmenté légèrement avec la température au cours de l’ère industrielle. Ce concept est le seul en totale conformité avec toutes les observations et causalités naturelles.
Horst-Joachim Lüdecke et Car Otto Weiss sont parvenus à cette conclusion, rassurante pour les uns et « démobilisatrice » selon les autres (2016A162) :
Par conséquent, l’augmentation du CO2 atmosphérique cessera progressivement […] Après l’apogée de la concentration de CO2 dans l’atmosphère, ce sont principalement les océans et la biosphère qui seront les puits des futures émissions de CO2 de l’humanité.
Il est question ici de l’effet de quasi-saturation des spectres d’émission thermique du CO2 atmosphérique. Ce phénomène. n’est pris en compte, ni dans les rapports AR5 et AR6 du GIEC, malgré la recommandation pressante de l’expert reviewer François Gervais. Il en fait une présentation technique dans son ouvrage (2022A94 p. 71–73) complétée par une citation ancienne (p. 72) :
Dès 1971, Rasool & Schneider, le second auteur étant le fondateur de la revue Climatic Change, écrivait à propos de la quasi-saturation : « À mesure que plus de CO2 est ajouté à l’atmosphère, l’accroissement de la température est proportionnellement de moins en moins élevé, et l’augmentation finit par se stabiliser. L’emballement de l’effet de serre ne se produit pas, car la bande du CO2 à 15 micromètres, qui est la principale source d’absorption, sature, et l’ajout de CO2 n’augmente pas substantiellement l’opacité infrarouge de l’atmosphère. »
Pour une discussion plus détaillée et actualisée, lire Pour revisiter le cycle du carbone (Veyres C & JC Maurin, 2022A299), ainsi que La Physique du climat (Moranne JM, 2024aA184) complété par Faits et fables (Veyres C, 2023A303), Réchauffement climatique, une affaire entre la Nature et l’Homme (Vieillefosse M, 2022A304 p. 49–64) et Climat et CO2 : décryptage d’une manipulation (Moranne JM, 2024bA185 p. 45). Suivre aussi le fil de discussion sur le site de Moranne et Veyres.
⇪ Réalité de « l’empreinte carbone »
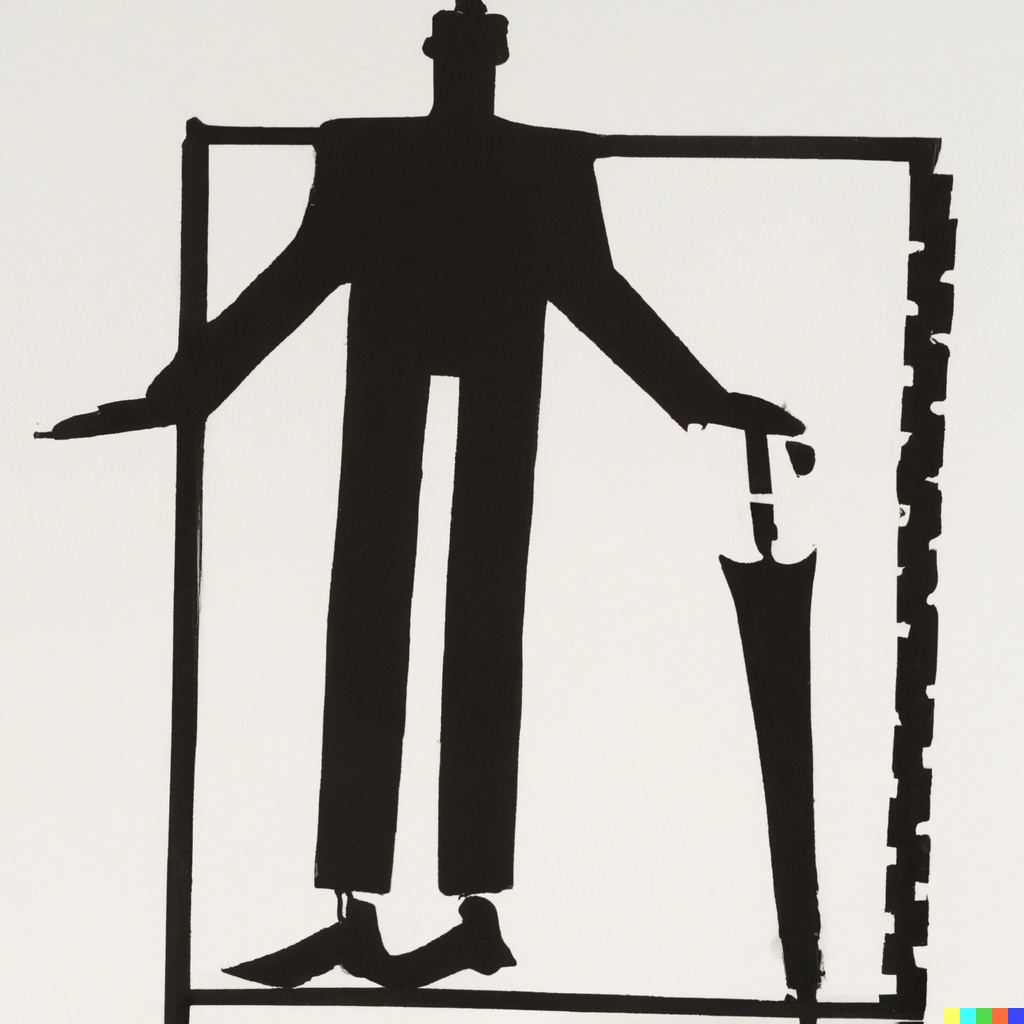
Le Tableau 1.2 (Gervais F, 2022A94 p. 62–63) reproupe les émissions de CO2 des principaux pays émetteurs, ainsi que celles de la France et du Royaume-Uni à titre de comparaison. François Gervais explique (2022A94 p. 60) :
La composante anthropique au réchauffement ressort à 0.2 picodegré par tonne de CO2 (équation 7 page 77) pour l’évaluation Gieco-compatible, et 0.1 picodegré par tonne de CO2 (équation 5 page 76) avec une sensibilité climatiqueN31 de 0.78°C. Ces résultats permettent à toute femme ou homme politique d’évaluer directement l’effet sur le climat d’une réduction chiffrée des émissions. Elle est rarement précisée, au profit de l’antienne selon laquelle l’important est de réduire, sans s’intéresser le moins du monde à l’impact thermique. Ce parti pris permet de cacher sous le tapis un impact infinitésimal. […]
En dépit des 36 milliards de tonnes de CO2 émis en 2019 ou en 2021, et quel que soit le mode d’évaluation retenu, on restait ainsi dans les millièmes de degrés par an, infiniment moins que les fluctuations de température autour des moyennes de saison, ou celles entre le jour et la nuit en l’absence de couverture nuageuse. […]
Nous adoptons […] un seuil intermédiaire de 0.07°C pour le seuil de mesurabilité de la température moyenne de la Terre. La colonne 8 du Tableau 1.2 [page 62] indique pendant combien d’années la contribution du pays au niveau de 2019 resterait imperceptible, car en-dessous du seuil de mesurabilité. Ce nombre d’années, qui dépasserait le siècle pour la plupart des pays, s’inscrit résolument en faux contre l’accusation de « crime contre l’humanité » ou de « trahison » des chefs d’États. […]
Le rapport Road to EU climate neutrality in 2050 (Brouwer & Bergkamp, 2021N35) confirme le Tableau 1.2. [Il] souligne qu’atteindre la neutralité carbone en 2050 pour l’ensemble de l’Union européenne se traduirait par un réchauffement évité de seulement 0.02°C. C’est, là encore, très en dessous du seuil de mesurabilité de la température de la Terre.
L’Union européenne et les Nations Unies ont déclaré l’année 2050 « Objectif de la neutralité carbone ». Les principaux émetteurs de CO2 peuvent-ils éviter à la Planète le « chaos » annoncé d’ici là ? François Gervais écrit (2022A94 p. 69) :
Le Tableau 1.2 [page 62] fournit la réponse dans la colonne 10, en extrapolant d’ici 2050 les émissions de 2019 pour les trois principaux pays émetteurs : Chine 0.04°C, États-Unis 0.02°C, Inde 0.01°C. […] Au rythme actuel, la contribution à la température mondiale n’excéderait pas 0.14°C d’ici 2050. Ni 1°C, ni 2°C, ni 3°C, encore moins 5°C ou d’avantage, comme le répètent à l’envi les médias alarmistes et les manifestants pour « sauver le climat », mais seulement 0.14°C. […]
Les Nations Unies se sentent-elles capables de convaincre la Chine et l’Inde qu’il faille qu’elles cessent impérativement leurs émissions pour éviter un réchauffement, d’ici 2050, de respectivement 0.04°C et 0.01°C ?
Richard Lindzen a fait un bref historique de la doctrine du CO2 anthropique tenu pour. responsable du réchauffement climatique (2018A153 p. 6) :
Bien que plusieurs scientifiques aient avancé ce point de vue au cours des 200 dernières années, il a été, jusqu’aux années 1980, généralement rejeté. Lorsqu’en 1988, le scientifique de la NASA, James Hansen, a déclaré au Sénat américain que la chaleur exceptionnelle de l’été reflétait l’augmentation du CO2, même le magazine Science a rapporté que la communauté des scientifiques du climat était sceptique. Le fait que cette position extrême ait été érigée en dogme au cours de la période actuelle est dû aux acteurs politiques, et à d’autres personnes qui aspirent à exploiter les opportunités qui abondent dans le secteur de l’énergie, d’un montant de plusieurs milliards de dollars.
C’est le cas de Maurice Strong, bureaucrate mondial et affairiste (qui a passé les dernières années de sa vie en Chine, apparemment pour éviter d’être poursuivi pour son rôle dans le scandale du programme « Pétrole contre nourriture » des Nations unies). On attribue souvent à M. Strong le mérite d’avoir lancé le mouvement en faveur du réchauffement climatique au début des années 1980, et il a ensuite contribué à l’organisation de la Conférence de Rio qui a débouché sur la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
C’est cet accord qui a entériné la thèse du CO2 et du climat, et qui a lancé la série de réunions internationales (qui se poursuivent encore aujourd’hui) visant à planifier le contrôle du climat. Cependant, d’autres personnes, comme le Premier ministre suédois, Olaf Palme, et son ami et conseiller scientifique, Bert Bolin, premier président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avaient également commencé à exploiter cette question dès les années 1970. Leur motivation était de vaincre la résistance à l’énergie nucléaire en diabolisant le charbon.
Les émissions de CO₂ ne peuvent pas expliquer l’énorme anomalie thermique de 2023, selon Gavin Schmidt (2024A253 — voir traduction) :
Alors, qu’est-ce qui a pu causer ce pic de chaleur ? Les niveaux atmosphériques de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter, mais la charge supplémentaire depuis 2022 ne peut expliquer un réchauffement supplémentaire que d’environ 0.02 °C. D’autres théories avancées par les climatologues incluent les retombées de l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Haʻapai en janvier 2022, qui ont eu à la fois des effets refroidissants dus aux aérosols et des effets réchauffants à cause de la vapeur d’eau injectée dans la stratosphère. Il y a eu aussi une accélération de l’activité solaire jusqu’à un maximum solaire prévu. Mais ces facteurs expliquent, tout au plus, quelques centièmes de degré de réchauffement (Schoeberl MR et al., 2023A257). Même après avoir pris en compte toutes les facteurs explicatifs plausibles, l’écart entre les températures moyennes annuelles attendues et les températures moyennes observées en 2023 reste d’environ 0.2 °C, soit à peu près l’écart entre le record annuel précédent et actuel.
⇪ Effet rebond
L’ouvrage False Alarm (Lomborg B, 2024A157) dresse une liste de prédictions des modèles climatiques qui ne se sont pas réalisées (p. 49–59) et s’insurge contre l’alarmisme entretenu par des militants, politiciens et journalistes qui spéculent sur les pires scénarios de ces modèles. Toutefois, Lomborg ne s’est pas prononcé sur les causes du réchauffement climatique. Il se contente de montrer que toutes les interventions visant à juguler ce réchauffement en diminuant les émissions de gaz à effet de serre se sont avérées inefficaces, voire contre-productives.
Cette inefficacité est aussi celle de comportements individuels « vertueux » comme l’achat de voitures électriques, le refus de voyager en avion, la diminution de la consommation de viande, etc. Parmi les raisons de l’absence d’effet — voire de l’effet inverse de celui escompté — figurent les phénomènes de rebond. Bjørn Lomborg écrit (2024A157 p. 91–92) :
Lorsque nous économisons de l’argent en étant plus efficaces, nous dépensons ces économies dans d’autres domaines qui entraînent davantage d’émissions. Prenons l’exemple de la réduction du gaspillage alimentaire. En théorie, si nous réduisons la quantité de nourriture que nous achetons, moins de nourriture devra être produite, ce qui réduira les émissions agricoles. Mais cela aura aussi l’heureux effet de nous faire économiser de l’argent. Le problème est que nous dépenserons cet argent pour d’autres choses, dont beaucoup produiront des émissions, comme de prendre des vacances supplémentaires. Dans une étude de 2018, des chercheurs norvégiens ont constaté qu’en réalité, l’argent économisé grâce à la réduction des déchets alimentaires sera dépensé pour d’autres biens qui émettront tellement de dioxyde de carbone que les économies d’émissions initiales seront entièrement annulées [Bjelle EL et al., 2018A22 p. 213–214].
Au sujet des voyages en avion (Lomborg B, 2024A157 p. 97–98) :
Les chercheurs ont constaté qu’environ 22 % des avantages en matière de changement climatique découlant de l’annulation d’un vol de vacances personnel sont annulés, car l’argent économisé est dépensé dans des activités qui génèrent des émissions. L’effet rebond de l’annulation d’un vol d’affaires est de 159 %, ce qui signifie que l’impact sur le climat augmente avec chaque vol annulé. (L’effet de rebond a des implications beaucoup plus dramatiques pour un siège en classe affaires, car le billet est beaucoup plus cher, alors que l’empreinte carbone n’est que légèrement plus élevée que dans les cabines les moins chères). Vous pensez économiser sur les émissions en faisant une croisière ? Désolé, il est prouvé que les bateaux de croisière sont plus nocifs pour l’environnement que les avions [Bjelle EL et al., 2018A22 p. 209].
⇪ Disparition (attendue) des glaciers
Patrice Poyet a présenté ainsi ce sujet (2022A221 p. 242–243) :
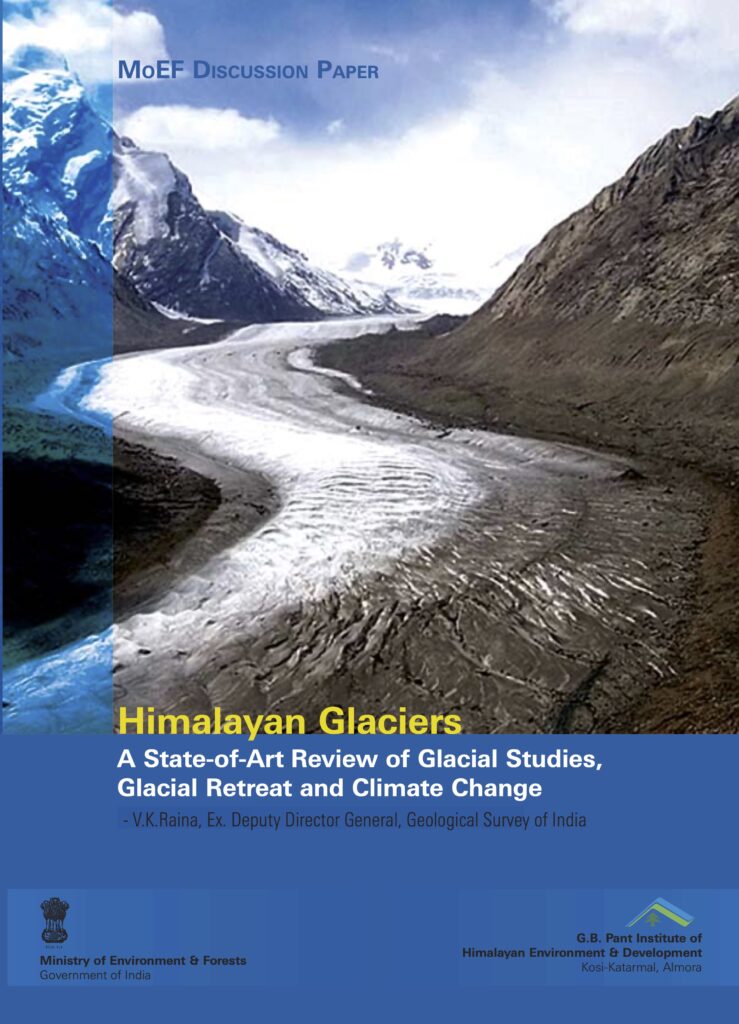
Comme cela a été détaillé dans la section « Climats passés » de ce document (Poyet P, 2022A221) et les sous-sections correspondantes « Les 2000 dernières années » et « Les 12000 dernières années, bref aperçu de l’Holocène », les glaciers offrent une réponse rapide à tout changement climatique.
Les observations frappantes de [Eugène] Trutat (Annuaire du Club Alpin Français, 1876), effectuées bien avant les émissions anthropiques, ont été rapportées à plusieurs reprises, et elles n’étaient pas isolées (Nussbaumer et al., 2011A204 fig. 4 et 5). C’est pourquoi les glaciers ont souvent été une cible facile des manœuvres alarmistes des fabricants de climat, car ils ont généralement reculé depuis la fin du petit âge glaciaire (Akasofu, 2011A3). En fait, on voit régulièrement de tels rapports dans les médias de masse faire la couverture ou la première page de journaux ou de magazines pour créer une sorte de réponse pavlovienne des masses conditionnées, où des gens crédules et faciles à influencer, parce qu’ils manquent de temps, de volonté ou de moyens pour se forger une opinion éclairée, sont persuadés qu’il n’y a pas à discuter, encore moins à « nier » — allusion implicite à l’holocauste. Les choses sont écrites, la messe est dite, le réchauffement climatique causé par l’homme est irréfutable, les glaciers disparaîtront.
La réalité dérangeante est que même ce pari facile — oui, des glaciers fondent — a souvent été perdu par les manipulateurs. Il a déjà été rapporté que les gestionnaires du Glacier National Park, une vaste zone sauvage située dans les Montagnes rocheuses du Montana, ont dû retirer les panneaux indiquant que « les glaciers auront disparu d’ici à 2020 », car la nature ne voulait pas coopérer avec leurs terribles prédictions. Ce n’était pas la première fois que les glaciers se montraient sournois et contredisaient des prévisions formulées à la légère. La fuite des courriels — “ClimategateN36” — de la Climatic Research Unit (CRU) de l’Université d’East Anglia (UEA), comme si elle n’était pas assez embarrassante, a coïncidé avec l’exposition de certaines erreurs flagrantes dans le rapport AR4 du GIEC (GIEC, 2007N6), plus particulièrement une annonce selon laquelle les glaciers de l’Himalaya disparaîtraient d’ici 2035, affirmation qui s’est avérée totalement dépourvue de fondement scientifique, par exemple (Bagla P, 2009A12 ; Cogley, 2011A46) et a conduit à des excuses contorsionnées du président et des vice-présidents du GIEC, ainsi que des coprésidents des groupes de travail du GIEC (GIEC, 2010).
Le glaciologue Vijay Kumar Raina, anciennement du Geological Survey of India, a dû démentir les affirmations non fondées du GIEC, en rejetant l’idée que les mesures effectuées sur une poignée de glaciers seraient représentatives du sort des quelque 10000 glaciers himalayens de l’Inde, et qu’ils diminueraient rapidement en réponse au changement climatique (Raina VK, 2009A225). Le document, “Discussion Paper, Ministry of Environment and Forests”, n’est plus disponible sur son site web d’origine (forme électronique du brûlage de livres ?) mais le Heartland Institute l’archive. Dans ce document, Raina affirme que « les glaciers de l’Himalaya, sur une période de 100 ans, se comportent de manière contrastée… Il est prématuré d’affirmer que les glaciers de l’Himalaya reculent anormalement à cause du réchauffement climatique. Un glacier est affecté par une série de caractéristiques physiques et par une interaction complexe de facteurs climatiques. Il est donc peu probable que l’on puisse affirmer que le mouvement du front glaciaire est le résultat de variations climatiques périodiques, tant que l’on ne disposera pas de plusieurs siècles d’observations. Alors que les mouvements des glaciers sont principalement dus au climat et aux chutes de neige, les mouvements du front semblent être propres à chaque glacier » et, en fait, ils « coopèrent » si peu qu’ « un côté de la langue glacière peut avancer tandis que l’autre stagne ou même recule » (Raina VK, 2009A225).
Vijay Kumar Raina est maintenant un ex-employé de tous les postes qu’il a occupés, identifié comme l’auteur d’un document de discussion controversé, et étiqueté par DeSmog comme un membre de la résistance climatique, un honneur ; imaginez qu’il a eu le culot de déclarer : « Le climat change naturellement tout le temps, parfois de façon dramatique. L’hypothèse selon laquelle nos émissions de CO2 ont provoqué, ou provoqueront, un réchauffement dangereux n’est pas étayée par des preuves. » Se débarrasser de lui n’accélérera pas la fonte des glaciers de l’Himalaya, mais nombreux sont ceux qui se sont réjoui d’une aussi belle prise.
Le GIEC a reconnu l’erreur dans une déclaration en date du 20 janvier 2010, dans laquelle il admet : « Nous avons toutefois appris récemment qu’un paragraphe de la contribution de 938 pages du Groupe de travail II à fait référence à des estimations mal étayées du taux de récession et de la date de disparition des glaciers de l’Himalaya. » […]
En fait, Raina (2013A226), compte tenu de sa connaissance approfondie des glaciers de l’Himalaya depuis des décennies, est encore plus prudent que la position que nous aurions pu défendre. Il n’observe même pas une réponse rapide des glaciers aux changements climatiques, et déclare : « Dans la mesure où l’observation des glaciers, depuis plus de cinq décennies maintenant, permet un diagnostic, je n’ai aucune hésitation à faire une déclaration selon laquelle un glacier ne répond pas nécessairement aux changements climatiques immédiats. Les données présentées révèlent que la fluctuation du museau du glacier n’est pas influencée par un seul paramètre, mais par une combinaison de paramètres. Le caractère physiographique de la zone d’accumulation et de la pente de la vallée joue probablement un rôle plus important que les précipitations annuelles et la température atmosphérique en soi » (Raina VK, 2013A226).
Nier l’évidence que les glaciers fondaient bien avant toute émission anthropogénique depuis la fin du petit âge glaciaire, n’aidera pas non plus à cacher que la traversée des Alpes par Hannibal avec ses éléphants pendant la deuxième guerre punique, en 218 avant l’ère chrétienne, n’a été possible que parce qu’il n’y avait pas de glacier sur son chemin ni de glace à l’époque, à la fin du mois d’octobre. La controverse sur la route alpine empruntée par l’armée d’Hannibal du bassin du Rhône vers l’Italie […] a fait rage pendant plus de deux millénaires, mais Mahaney et al. (2018A165) y ont récemment mis fin, en confirmant ce que Polybe avait écrit en 311, à savoir qu’Hannibal avait franchi le plus haut des cols alpins : le col de la Traversette (2947 mètres !) entre la haute vallée du Guil et le haut Pô est bien le plus haut des cols. […]
Le climat a beaucoup changé, avec ou sans nos ridicules émissions anthropiques, et, pour l’instant, même le pari le plus facile des fabricants de climat est régulièrement perdu. Les glaciers d’Alaska ne coopèrent pas non plus comme prévu et, comme le rapportent Berthier et al. (2010A21), les études précédentes ont largement surestimé la perte de masse des glaciers d’Alaska au cours des 40 dernières années. Comme le rappelle Spencer (2007A268), les glaciers réagissent manifestement aux changements de température, mais surtout aux changements de précipitations : « Des remarques similaires peuvent être faites au sujet du recul des glaciers. Les glaciers réagissent à diverses influences, en particulier aux précipitations. Seule une poignée des milliers de glaciers de la planète ont été mesurés pendant des décennies, et encore moins pendant des siècles. Certains des glaciers qui reculent mettent à jour des souches d’arbres, indiquant des époques antérieures où les fluctuations climatiques naturelles étaient responsables d’une étendue restreinte des champs de glace. » Et, à titre de preuve anecdotique, le lecteur se souviendra des troncs d’arbres révélés par le recul du glacier Tschierva en Engadine, par Joerin et al. (2006A125).
L’auteur expose plus loin le cas du Kilimanjaro comme exemple emblématique d’un glacier qui recule sous l’effet de divers facteurs, notamment une perte de précipitations, et certainement pas à cause de l’action néfaste du CO2 (Poyet P, 2022A221 p. 242–243). Les glaciologues soulignent la diversité des facteurs, écartant l’hypothèse d’un lien exclusif avec la température terrestre (Bagla P, 2009A12) :
Pourquoi de nombreux glaciers de l’Himalaya s’écartent-ils de la tendance au recul rapide observée dans les Alpes, par exemple, ou au mont Kilimandjaro, comme l’ont rapporté les Proceedings of the National Academy of Sciences la semaine dernière ? Selon Richard Armstrong, glaciologue au National Snow and Ice Data Center de Boulder (Colorado), « les glaciers de basse altitude réagiront plus rapidement au réchauffement climatique que les glaciers de haute altitude. » « Le régime des chutes de neige est plus important pour la stabilité des glaciers himalayens que les températures », ajoute Rajinder Kumar Ganjoo, glaciologue à l’université de Jammu, en Inde. « Si la hausse des températures était la véritable cause du recul, toutes les masses de glace de l’Himalaya devraient se dégrader uniformément », ajoute-t-il. « La question qui se pose dans les cercles scientifiques », note Kargel, « est de savoir quelle est la durée du temps de réponse et comment il varie d’un glacier à l’autre. »
⇪ L’eau monte ou le terrain descend ?

Si le niveau de la mer s’est élevé de 120 mètres en 18 000 années (source IFREMER), soit 6.6 mm par an, il ne s’est pas élevé de plus que de 1.2 mm par an (SHOM) depuis l’an 1800. Mesuré par 2133 marégraphes, il n’excédait pas 1.04 mm par an (Parker A & CD Ollier, 2015A210), soit 3 centimètres supplémentaires d’ici 2050, année déclarée « objectif de neutralité carbone » par l’Union européenne et les Nations Unies — ce qui est inférieur à l’amplitude de la plus minuscule vague, et très inférieur aux marées quotidiennes (Gervais F, 2022A94 p. 177)…
Quoi qu’il en soit, on n’observe aucune accélération récente de cette lente montée du niveau, ce qui exclut un couplage avec la production humaine de gaz à effet de serre (Christy J & R Spencer, 2003A36). Alors que le rapport AR6N3 du GIEC (2021) conclut à une accélération de la montée du niveau, les quantités mesurées ne justifient pas une telle affirmation (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 66–72) :
Les enregistrements des marégraphes constituent la meilleure preuve de l’évolution à long terme du niveau de la mer. Ces enregistrements montrent généralement un comportement remarquablement linéaire pendant plus d’un siècle. […]
L’opinion du GIEC selon laquelle il a calculé « une forte accélération (degré de confiance élevé) de l’augmentation du GMSL [global medium sea level] au cours du 20e siècle » est contredite par les enregistrements marégraphiques à long terme (> 50 ans) directement mesurés dans le monde entier, qui montrent les mêmes tendances linéaires, non affectées par l’accélération, ni ralenties ni accélérées. Les graphiques de ces enregistrements marégraphiques peuvent être consultés pour les marégraphes américains et mondiaux sur le site web Tides and CurrentsN37 de la NOAA. […]
L’accélération récente alléguée par le RE6 coïncide en grande partie avec le passage de données purement marégraphiques à des données satellitaires qui ne sont disponibles que depuis 1992. […] une partie de l’accélération peut en fait être un artefact dû au changement de méthodologie. Au cours du 20e siècle, le niveau de la mer s’est élevé d’environ 20 cm, à un rythme de 1.7 mm/an (±0.4 mm), selon la NOAA.
Dans le cadre des « candidats aux scénarios du pire », Judith Curry écrit (2024A52 p. 255, 258 ; 2023A51 p. 154, 156) :
Si l’on ne prend en compte que les projections de la hausse du niveau de la mer en 2100 représentant des processus inspirant au moins une confiance moyenne (1), les projections du 95e percentile [selon l’AR6 du GIEC] sont inférieures à 1 m dans le cadre du RCP 4.5 [réchauffement de 2 à 3 °C en 2100] et à 1.6 m pour le RCP 8.5 [réchauffement de 4 à 5 °C en 2100]. Si l’on prend aussi en compte les projections incluant la MisiN38 [instabilité de la banquise antarctique] ou le SEJ [jugement structuré des experts] (faible confiance), les projections du 95e percentile pour 2100 sont de 1.6 m pour le RCP 4.5 et de 2.4 m pour le RCP 8.5. […]
En résumé, les scénarios de hausse du niveau de la mer supérieurs à 1.8 m pour le XXIe siècle supposent des conditions sans précédent naturel dans les périodes interglaciaires. Ces scénarios extrêmes supposent un enchaînement d’événements et de paramètres extrêmement improbables. La vraisemblance conjointe de ces événements extrêmement improbables franchit sans doute le seuil du plausible.
Philip R Thompson et al. (2016A285 fig. 1) fournissent un graphique illustrant la concordance des tendances du niveau relatif de la mer mesuré par les marégraphes dans le monde entier.
Le niveau des océans varie en fonction du lieu de la mesure. On connaît, par exemple, un décalage de 20 cm entre les niveaux des océans Atlantique et Pacifique aux extrémités du canal de Panama. De plus, la terre n’est pas un solide indéformable. Elle est soumise à l’attraction de la lune, et de plus ses plaques tectoniques sont en mouvement (SCM, 2015A239 p. 57–66).
La montée absolue des niveaux des mers doit être corrigée du mouvement vertical des terres, ce qui donne en moyenne (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 72) :
Dans l’ensemble, le mouvement vertical des terres est de la même ampleur que l’augmentation réelle du niveau absolu de la mer, mesurée directement par les marégraphes corrigés par le CGPS dans les lieux d’intérêt pour l’humanité. Cette augmentation mesurée de la hauteur de la surface de la mer s’avère être bien inférieure à 2 mm/an, et non aux 3,4 mm/an rapportés pour le niveau conceptuel eustatique de la mer à partir de l’altimétrie satellitaire. Les enregistrements des marégraphes ne montrent aucune accélération du niveau relatif ni absolu de la mer.
Les ports, les villes et les bords de mer de l’humanité ont prospéré malgré l’élévation du niveau de la mer au cours du siècle dernier, qui a été ignorée dans de nombreux cas. Ce même aspect lent et régulier de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale, et les progrès constants de la technologie, rendent l’adaptation à l’élévation future du niveau de la mer éminemment possible.
Observation locale : « Au voisinage de Stockholm, le niveau de la mer de monte pas, il s’abaisse de 3.9 mm par an » (Gervais F, 2022A94 p. 120). Un détail cocasse a été signalé par Ole Humlum (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 10) : le GIEC a mis à la disposition du public un outil de projection des niveaux des mersN39 qui, pour Stockholm, « prédit » à partir de 2000 une élévation du niveau de la mer, en totale contradiction avec les données !
En Grande Bretagne, le niveau de la mer augmente en Angleterre alors qu’il « diminue » en Écosse, du fait de la collision entre les plaques tectoniques eurasiatique et nord-américaine.
Claude Allègre (2010A9 p. 71–72) a décrit un phénomène d’enfoncement des deltas de fleuves, appelé subsidienceN40, causé par l’apport de sédiments à l’embouchure des fleuves :
Ce qui est caractéristique de ce phénomène, c’est qu’il se produit par saccades. Il y a donc un délai entre l’apport de matières sableuses par les fleuves et l’enfoncement. Or, aujourd’hui, dans les deltas, s’ajoute à ce phénomène naturel une série de phénomènes dont l’homme est, pour le coup, responsable. […] il s’agit souvent des conséquences de l’exploitation pétrolière. […] L’extraction du pétrole et du gaz crée des cavités dans le sous-sol qui favorisent l’effondrement de ce dernier. […] Autre cause : ce sont les barrages qui arrêtent les sédiments, ce qui fait que le delta s’enfonce […] Depuis dix ans, 80 % des grands deltas ont subi des inondations dévastatrices. Certains cherchent à rattacher ce phénomène au changement climatique, mais c’est totalement artificiel.
Pour ce qui est du lien entre fonte des glaciers et montée des eaux, Nils-Axel Mörner écrit (2016A197 p. 1319–1320) :
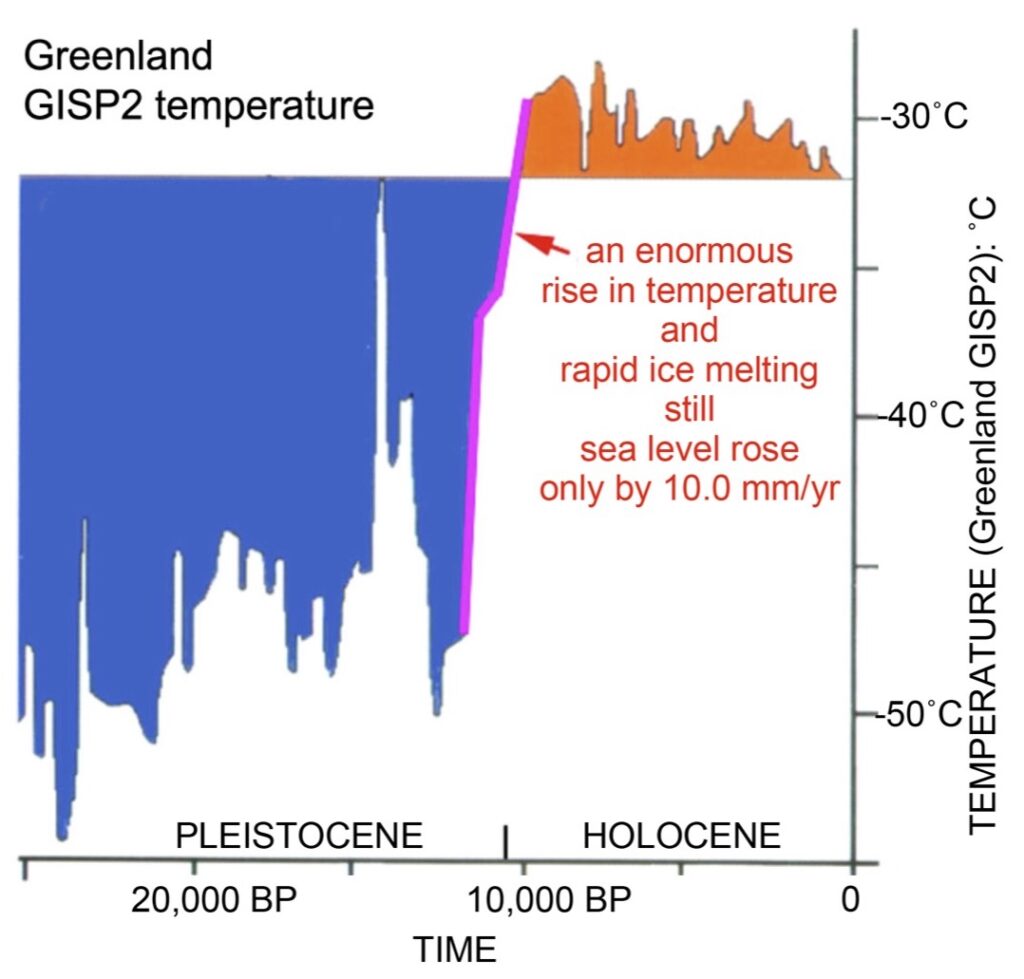
L’élévation du niveau de la mer il y a 10 000 à 11 000 ans n’a pas dépassé le taux [de 1 millimètre par an], bien que le forçage climatique ait été exceptionnellement intense, et que le taux de recul des glaciers ait été très rapide (de l’ordre de 200 à 300 mètres par an dans la région de Stockholm). Ceci est parfaitement vrai, mais peut maintenant être illustré d’une manière encore plus expressive. Les relevés de température du Groenland GISP2 [4] [5] enregistrent un changement de température exceptionnellement important qui s’est produit à la fin du Younger Dryas et au début de l’Holocène (figure 1). Et pourtant — et c’est ce qui est étonnant — le niveau de la mer n’a pas augmenté de plus d’environ 10 mm/an (c’est-à-dire 1 mètre par siècle), comme cela a été enregistré avec une grande précision dans le nord-ouest de l’Europe, et testé à l’échelle mondiale [6] [7].
À 11 000 ans avant notre ère, il restait d’énormes quantités de glace dans les gigantesques calottes glaciaires continentales de la dernière période glaciaire. Au Canada, le front glaciaire se trouvait dans la plaine du Saint-Laurent et en Scandinavie, la marge glaciaire se trouvait à Stockholm. Lors de l’impulsion de réchauffement qui a mis fin au Pléistocène et amorcé l’Holocène, la glace a fondu sous l’effet d’une force exceptionnelle. Aujourd’hui, il n’y a ni glace ni forçage climatique qui puisse être comparé à ce qui s’est passé entre 11 000 et 10 000 ans avant notre ère.
La conclusion est évidente : la fonte des glaces et l’élévation du niveau de la mer ne pourront jamais être aussi fortes — et certainement pas plus fortes — que celles qui se sont produites lors de la transition entre le Pléistocène et l’Holocène. Par conséquent, un taux d’élévation du niveau de la mer de +10 mm/an ou 1 mètre par siècle peut être considéré comme la valeur absolument limite de toute élévation du niveau de la mer [1]. Toute élévation actuelle du niveau de la mer doit être bien inférieure à cette valeur, pour être réaliste, compte tenu des données historiques et des facteurs physiques qui contrôlent la fonte des glaces. Par conséquent, nous pouvons également rejeter toute affirmation selon laquelle l’élévation du niveau de la mer dépasserait 1 mètre au cours du prochain siècle, en la qualifiant de pure absurdité et de démagogie infondée. […]
Le taux actuel d’élévation du niveau de la mer varie globalement entre ±0.0 et +1.0 mm/an, c’est-à-dire de zéro à 10 cm en un siècle. Cette valeur correspond très bien à la proposition de l’auteur d’une élévation du niveau de la mer, d’ici 2100, de +5 cm ± 15 cm (Mörner NA, 2015A196 ; 2016A197) .
Le PléistocèneN41 mentionné ici a été marqué par des cycles glaciaires. Des recherches sur les variations génétiques des humains ont révélé que le froid (et la sécheresse) avaient menacé l’espèce humaine d’extinction il y a 900 000 ans (Wu WJ et al., 2023A118) :
Les résultats ont montré que les ancêtres de l’Homme sont passés par un goulot d’étranglement important, avec environ 1280 individus reproducteurs, entre 930 000 et 813 000 ans. Ce goulot d’étranglement a duré environ 117 000 ans et a conduit les ancêtres de l’Homme au bord de l’extinction.
À une époque plus récente, celle de la période chaude médiévale, le Groenland a été envahi par les Vikings et désigné comme « Terre verte » par Erik le RougeN42 pour attirer les colons. Les travaux des archéologues mettent en évidence les événements associés au refroidissement climatique, à partir du 13e siècle, qui a contraint les colons à abandonner ce territoire. Paradoxalement, ce refroidissement s’est traduit par une apparente « élévation du niveau de la mer » qui était en réalité une dépression isostatiqueN43 du terrain causée par le poids de la glace sur la lithosphèreN44 (Borreggine M et al., 2023A26) :
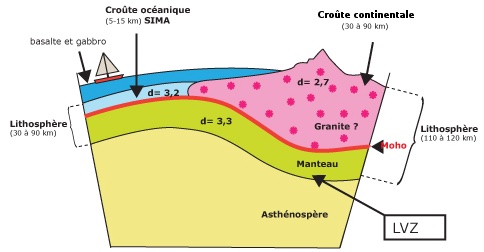
Les premiers témoignages sur les Vikings du Groenland remontent à 985 de notre ère. Les preuves archéologiques permettent de mieux comprendre le mode de vie des Vikings, mais les causes de leur disparition, au 15e siècle, restent énigmatiques. La recherche suggère qu’une combinaison de facteurs environnementaux et socio-économiques, ainsi que le changement climatique entre la période de réchauffement médiéval (environ 900 à 1250 de notre ère) et le petit âge glaciaire (environ 1250 à 1900 de notre ère), pourraient les avoir contraints à abandonner le Groenland. La géomorphologie glaciaire et les recherches sur le paléoclimat suggèrent que l’inlandsisN45 du sud du Groenland s’est réinstallé pendant l’occupation viking, atteignant son apogée au cours du petit âge glaciaire.
De manière contre-intuitive, cette réorientation a provoqué une élévation du niveau de la mer près de la bordure glaciaire, en raison d’une attraction gravitationnelle accrue sur la couche glaciaire et d’un affaissement de la croûte terrestre. Nous évaluons la croissance de la glace dans le sud-ouest du Groenland à l’aide d’indicateurs géomorphologiques et de données de carottes lacustres issues de la littérature antérieure. Nous calculons l’effet de la croissance de la calotte glaciaire sur le niveau régional de la mer, en soumettant notre histoire de la glaciation à un modèle géophysique du niveau de la mer, avec une résolution d’environ 1 km dans le sud-ouest du Groenland, et nous comparons les résultats aux données archéologiques. Les résultats indiquent que le niveau de la mer a augmenté jusqu’à environ 3.3 mètres en dehors de la zone de glaciation pendant la colonisation viking, ce qui a entraîné un recul du littoral de plusieurs centaines de mètres.
L’élévation du niveau de la mer a été progressive, et a touché l’ensemble de la colonie orientale. De plus, les inondations généralisées ont dû forcer l’abandon de nombreux sites côtiers. Ces processus ont probablement contribué à l’ensemble des vulnérabilités qui ont conduit à l’abandon du Groenland par les Vikings. L’évolution du niveau de la mer représente donc un élément intégral et manquant de l’histoire des Vikings.
La publication de Boyang Zhao et al. (2022A320) suggère que l’abandon du Groenland par les Vikings, au début du 15e siècle, aurait plutôt été causé par la sècheresse que par le froid. Ce qui ajoute au fait contre-intuitif — voir aussi le Sahara — que la sècheresse est plus souvent la conséquence d’un refroidissement que d’un réchauffement climatique !
L’article de Marisa Borreggine M et al. (2023A26) oblige à se demander si l’estimation de l’élévation du niveau de la mer, telle que quantifiée par Nils-Axel Mörner (2016A197) — voir ci-dessus — a bien été corrigée par l’évaluation du mécanisme glacio-isostatique d’élévation du niveau des côtes. Cette compensation été prise en compte par Mörner. Au terme d’une étude détaillée, il concluait (1970A195 p. 178) :
Tous ces éléments signifient qu’il doit être très difficile de trouver une zone vraiment « stable », où les changements du niveau de la mer sont de véritables changements eustatiques [liés au climat]. Cela signifie également qu’une étude détaillée d’une zone soulevée, où le facteur isostatique peut être déterminé avec précision, et où les facteurs eustatiques et isostatiques peuvent être séparés, est certainement l’un des meilleurs moyens de déterminer les changements eustatiques. Pour de telles études, la Scandinavie méridionale est particulièrement bien adaptée (Mörner, 1969aA194 p. 8).
La courbe eustatique de M/Srner est calculée avec une très grande précision (pour les 12 700 dernières années) et les modifications ou ajouts futurs ne concerneront probablement que des détails mineurs. Cependant, il faut se rappeler qu’elle donne les changements eustatiques dans l’Atlantique Nord-Ouest (55–58° de latitude Nord et 10–13° de longitude Est), le niveau de l’océan n’ayant pas nécessairement été réparti de façon égale dans le temps.

Au sujet de la « montée des eaux » dans d’autres régions du monde, François Gervais écrit (2022A94 p. 119) :
Il ne s’agit pas de nier l’érosion du littoral à certains endroits. Mais les pouvoirs publics ne sont pas obligés d’y délivrer des permis de construire. À l’échelle mondiale, Donchyts et al. (2016A63) et Luijendijk et al. (2018A160) rapportent en moyenne un accroissement de la superficie des continents en général, et des plages en particulier. La superficie des îles du Pacifique et de l’océan Indien, y compris les Maldives, s’est accrue de 6 % (Holdaway A et al., 2021A115), celle des Marshall de 4 % (Ford MR et PS Kench, 2015A81).
Observations confirmées par Virginie Duvat (2018A69) :
Au cours des dernières décennies, les atolls n’ont pas montré de signes généralisés de déstabilisation physique face à l’élévation du niveau de la mer. Une nouvelle analyse des données disponibles, qui couvrent 30 atolls du Pacifique et de l’océan Indien comprenant 709 îles, révèle qu’aucun atoll n’a perdu de superficie et que 88.6 % des îles sont restées stables ou ont vu leur superficie augmenter, tandis que seulement 11.4 % se sont contractées. Les atolls touchés par l’élévation rapide du niveau de la mer n’ont pas eu un comportement distinct de celui des autres atolls.
Voir plus bas l’émigration médiatisée vers l’Australie de réfugiés « climatiques » de l’archipel polynésien de Tuvalu.
À la fin des années 1980, des prédictions apocalyptiques étaient relayées avec fracas par les médias. Par exemple, Noel Brown, Directeur du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP), est cité par l’Associated Press, en 1989, pour avoir déclaré (AP News, 1989A1) :
Les gouvernements disposent d’une fenêtre de 10 ans pour résoudre le problème de l’effet de serre avant qu’il ne devienne incontrôlable par l’homme.
[…] le niveau des océans augmenterait jusqu’à un mètre, assez pour engloutir les Maldives et d’autres pays insulaires plats, […] un sixième du Bangladesh pourrait être inondé, entraînant le déplacement de 90 millions de personnes. Un cinquième de la terre arable dans le delta du Nil pourrait être inondé, […] les réfugiés écologiques deviendront une préoccupation majeure, […] Selon les estimations scientifiques les plus prudentes, la température de la Terre augmentera de 1 à 7 degrés au cours des 30 prochaines années.
Les fact-checkers affirment aujourd’hui « qu’il n’a jamais dit ça » — ou encore, si l’on insiste, « qu’il n’était pas climatologue »… D’autres exemples de déclarations stupéfiantes ont été répertoriés par Patrice Poyet (2022A221 p. 414–417).
Pour ce qui est du Bangladesh, les données indiquent au contraire une augmentation de 3274 km2 des terres émergées entre 1990 et 2022, malgré la perte de 2399 km2 causée par l’érosion des côtes (Shahid SB et al., 2024A262 p. 8–9, 17) :
Au Bangladesh, l’accumulation de terres l’emporte sur l’érosion, une nouvelle unité quaternaire protégeant désormais 19 % du littoral. […]
Le phénomène croissant de la stabilité des terres côtières au Bangladesh est devenu un sujet d’étude essentiel, avec des implications pour d’autres deltas.
Un dernier exemple : Jakarta est menacée de submersion, mais, ici encore, rien à voir avec une « montée de l’eau » et encore moins « le CO2 ». La ville s’enfonce de plusieurs centimètres par an, par effet d’un pompage incontrôlé de sa nappe phréatique. Le vécu de ses habitants a été évoqué avec pathos, dans un débat, par une journaliste météo qui l’avançait comme preuve irréfutable de « l’urgence climatique » (Rittaud B, 2019A235).
Comme le remarquait Richard Lindzen (2018A153 p. 7–8), « le récit est suffisamment simple pour que l’élite puisse enfin penser qu’elle “comprend” la science » :
Les scientifiques ont également une conscience aiguë et cynique de l’ignorance des non-scientifiques et de la peur qu’elle engendre. Cette peur rend les élites « vulnérables » particulièrement soulagées par la certitude que la théorie sous-jacente à l’alarme est trivialement simple, et que « tous » les scientifiques sont d’accord.
⇪ Fonte des calottes glaciaires

Dans son film largement diffusé et acclamé par les militants du climat, Al Gore avait suscité l’émoi en faisant apparaître comme imminente une élévation catastrophique du niveau des mers, consécutive à la fonte des glaces de la calotte Arctique, qu’il prédisait intégrale en 2013, et, il va de soi, causée par l’activité humaine (Rittaud B, 2023aA237). Cette prophétie est sans cesse renouvelée, avec des images de blocs de glace se détachant de la banquise chaque été, preuve irréfutable d’une destruction imminente et irréversible…
⇪ Arctique
On peut vérifier en temps réel, sur le site du National Snow and Ice Data Center (NSIDC), l’absence de couplage entre l’étendue moyenne de la glace de mer arctique et le taux croissant de CO2 dans l’atmosphère terrestre :
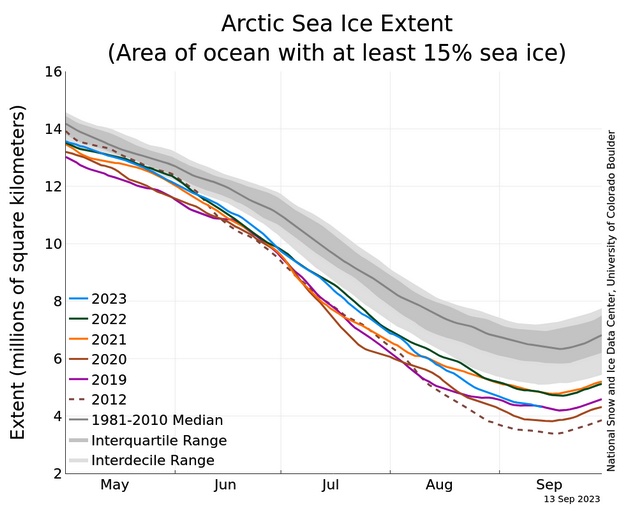
Source : Arctic Sea Ice News and Analysis (NSIDC, 2023N46)
Patrice Poyet commente (2022A221 p. 269) :
Ainsi, non seulement les prévisions de 2009 du Vice-président Al Gore sont réfutées par toutes les preuves, puisque ni en 2014 ni en 2016 l’Arctique n’a été sans glace pendant l’été, mais les études de Dr Maslowski [2013A167] semblent radicalement erronées, puisqu’il y a plus de glace en 2022 qu’en 2021, 2020, 2019 ou 2018, et même beaucoup plus qu’en 2012.
Malgré la relative constance de l’épaisseur de la glace, la banquise arctique diminue en surface depuis les années 1980 comme le montre ce graphique du NSIDC (2023N47) :
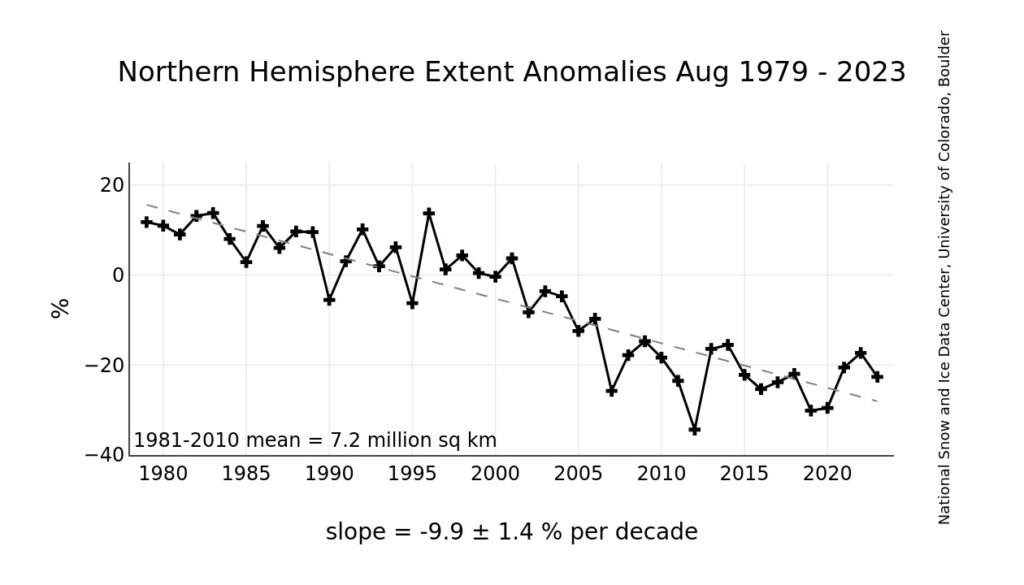
Alan Longhurst écrit (2012–2015A158 p. 184, 187) :
Une reconstruction de la température de l’air de surface au-dessus du Groenland au cours du dernier millénaire, dérivée des bulles d’argon et d’azote dans les carottes de glace prélevées sur le site GISP au centre du Groenland, montre un long déclin des températures depuis la période médiévale et une reprise relativement rapide depuis le début du 19e siècle, une tendance qui diffère de celle observée dans les données relatives aux dates de la période de gel pour les lacs et les rivières de l’hémisphère nord. L’ensemble de l’enregistrement — dans lequel les températures du 20e siècle sont plutôt similaires à celles de la période chaude médiévale — est marqué par des oscillations pluridécennales de plus de 2 à 3 °C, de sorte que les changements récents observés ne sont pas inhabituels, que ce soit en termes d’échelle ou de durée : l’enregistrement des températures dans les carottes glaciaires confirme donc les preuves historiques (Kobashi T et al., 2009A131). […]
Mais le recul actuel des glaciers n’est pas un phénomène uniforme, comme on le décrit généralement. Sur l’île de Bylot, de l’autre côté de la baie de Baffin depuis la côte du Groenland, à environ 73° Nord, une équipe de géologues canadiens a constaté, au cours de l’été 2009, que presque tous les glaciers se trouvaient dans leur moraine terminale, ce qui implique une absence de recul des glaciers à l’échelle régionale (Annual Review, Bedford Institute of Oceanography, 2009).
Patrice Poyet ajoute (2022A221 p. 263) :
Ainsi, le comportement du glacier est très différent, et le concept de CAGW [catastrophic anthropogenic global warming] met l’accent sur les glaciers qui reculent, comme le fait l’article de Wikipedia, en oubliant tous les autres. Mais […] le comportement des glaciers régionaux, et de l’Arctique en général, coïncide avec l’influence des eaux de l’Atlantique à travers les diverses oscillations connues sous le nom d’AMON20 (Chylek et al., 2011A39). Ou par exemple une phase négative de la NAO [North Atlantic Oscillation], c’est-à-dire une anti-corrélation de (r = ‑0.84 à 0.93) avec les températures du Groenland (Chylek et al., 2004A38), etc., mais pas avec un quelconque déséquilibre radiatif.
L’Arctique était libre de glace pendant la période optimale de l’Holocène, et pas en été, mais tout au long de l’année. « C’était il y a seulement 7000 à 8000 ans, et les émissions d’origine humaine n’y sont pour rien » (Poyet P, 2022A221 p. 507). Kenneth Richard ajoute (2020A230) :
Les chevaux sauvages et les mammouths mangeaient encore de l’herbe toute l’année dans l’Arctique jusqu’à il y a 2500–4000 ans. Les températures de surface devaient être beaucoup plus chaudes qu’aujourd’hui pour que les chevaux et les mammouths aient suffisamment d’herbe toute l’année et puissent subsister dans l’Arctique jusqu’à la fin de l’Holocène. […] La température actuelle n’est pas « sans précédent ».
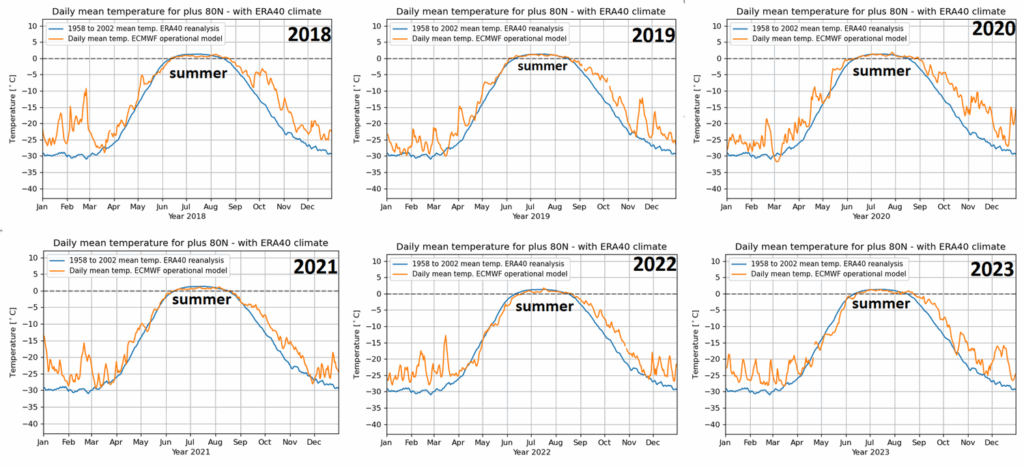
Données fournies par l’Institut météorologique danois. Source : Paul Dorian (2025A64)
⇪ Antarctique
Pour ce qui est de l’Antarctique, le graphe des anomalies mensuelles de l’étendue des glaces pour la période 1979–2023, publié par le NSIDC (2023N48), ne rend pas évidente « la phase de recul irréversible » annoncée par certains médias alarmistes. Les faibles fluctuations observées n’étaient en rien liées au réchauffement climatique, ni au CO2 :
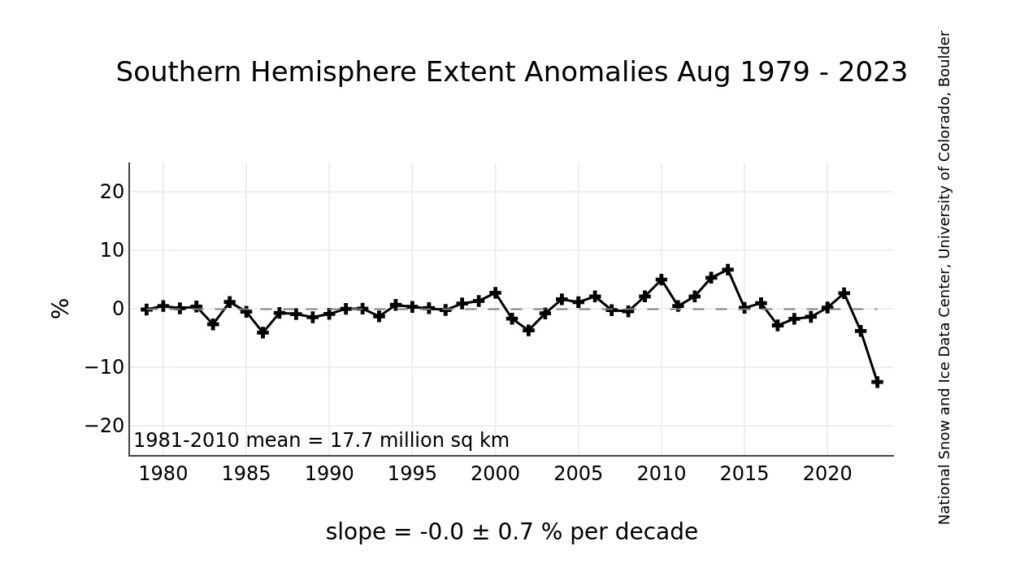
Source : NSIDC (2023N48)
Le graphique suivant affiche la température dans l’Antarctique et le CO2 (en échelle logarithmique) sur deux siècles. Malgré l’augmentation massive de CO2, il n’y a tout simplement pas eu de réaction de la température, pour la simple raison que le climat est très peu sensible au CO2… (Poyet P, 2022A221 p. 256) :
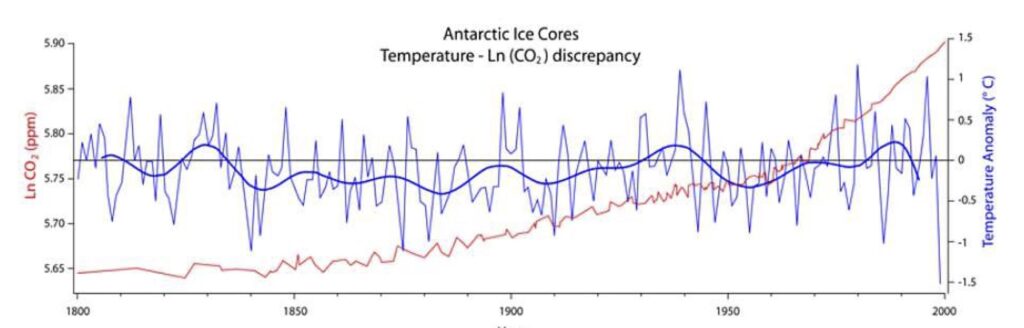
Par contre, la diminution subite de l’étendue de la banquise (à partir de 2022) pourrait être liée à une activité volcanique — très difficile à mesurer, et même à détecter. Maximillian Van Wyk de Vries et ses collègues (2017A298) ont récemment découvert 91 nouveaux volcans sous l’Antarctique, ce qui porterait leur nombre à 138 et ferait de ce continent la plus importante « province volcanique » de la Planète. Même les volcans inactifs ou dormants peuvent faire fondre la glace, en raison des températures élevées qu’ils génèrent sous terre. Judith Curry fournit plus de détails et de liens à ce sujet (2024A52 p. 252–253 ; 2023A51 p. 153).
⇪ Acidification des océans

François Gervais écrit (2022A94 p. 122–123) :
Autre menace existentielle déclinée dans la longue liste risquant de frapper l’humanité selon les médias alarmistes, l’acidification des océans. La moyenne du pH des océans a effectivement évolué de 8.2 à 8.1 ces dernière décennies. Le pH, ou potentiel hydrogène, mesure la basicité (pH > 7) ou l’acidité (pH < 7) d’une solution aqueuse. Les océans sont donc basiques et non pas acides et le resteront vraisemblablement. « Débasification », en l’occurrence de 0.1 point de pH, devrait être le terme à employer, au lieu de la trompeuse « acidification », probablement plus vendeuse pour les marchands de peur.
La concentration en CO2 est maximale dans les eaux froides parce que sa solubilité augmente à mesure que diminue la température […] Les eaux chaudes sous les tropiques ont plus de mal à le retenir. La variation annuelle de pH d’origine anthropique n’excède pas ‑0.0017 (Byrne RH et al., 2010), valeur reprise par le GIEC, mais restant petite par rapport au pH de 8.1. Ainsi, les variations saisonnières (Wei HZ et al., 2021A311) excèdent-elles largement la minuscule contribution anthropique.
Guillaume de Rouville pousse un peu plus loin le bouchon au sujet de cette « acidification » (2024A57 p. 41) :
Et pourquoi, alors, ne pas parler « d’enneigement » quand la température de la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère se met à baisser ou de « bouillonnement » quand la température ambiante monte ? Le Secrétaire général de l’ONU n’hésite pas à le faire et s’alarme, bien volontiers, avec l’air consterné et dramatique qu’il sait afficher devant les caméras, du bouillonnement général des océans, quand il s’aperçoit que la température est montée de quelques malheureux degrés entre le matin et l’heure du déjeuner au sortir de son bungalow de vacances au bord d’une plage à Honolulu ou aux Maldives.
Christopher Walter Monckton of Brenchley était un expert évaluateur du cinquième rapport (AR5) du GIEC (2013). Il résume le problème ainsi (2013A308 p. 12) :
Comme les océans contiennent déjà 70 fois plus de CO2 que l’air, il serait impossible de les acidifier sensiblement, même si tout le CO2 de l’air se retrouvait dans la mer. En outre, les océans sont régulés par les bassins rocheux dans lesquels ils se déplacent, et cette régulation est homéostatique, ce qui permet de maintenir l’équilibre acido-basique actuel, qui est nettement alcalin. Ainsi, même la position de repli adoptée par les profiteurs du malheur face à l’échec de leurs prédictions sur le réchauffement climatique — l’« acidification » des océans — ne repose sur aucune base scientifique rationnelle.
Pour un exposé beaucoup plus détaillé, voir The Myth of the Acidification of the Oceans (Poyet P, 2022A221 p. 275–292). Ce développement est une réponse à Claude Allègre (2010A9 p. 12) qui partageait la crainte d’une acidification des océans.
La controverse des coraux qui disparaîtraient « à cause du changement climatique » continue de faire la une des médias. Or les études ont montré l’absence de lien avec une prétendue acidification des océans, mais plutôt un effet de la pèche dévastatrice d’espèces comme les holothuriesN49 (concombres de mer) dans les eaux coralliennes (Henry J, 2024A111).
⇪ Coup de froid et positionnement éthique
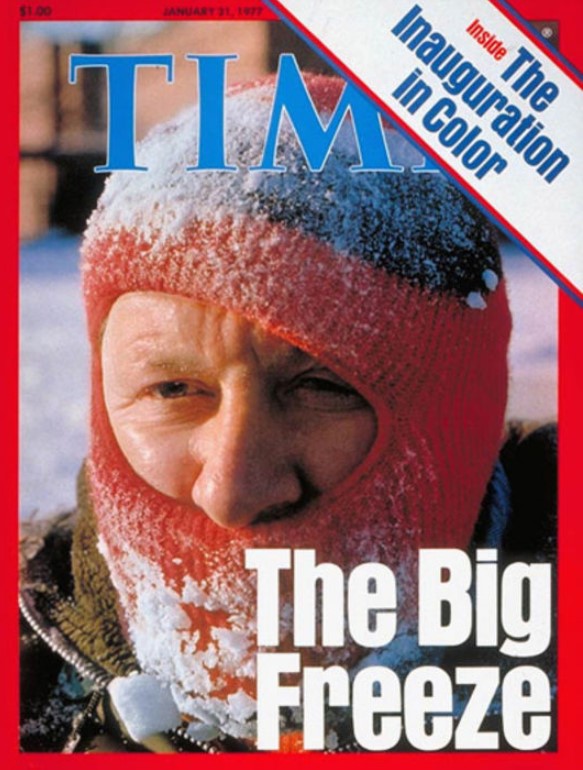
Dans les années 1970, la majorité des spécialistes s’inquiétaient d’un refroidissement planétaire global qui mettait en danger l’existence de l’humanité, ajoutant que les théories nouvelles d’un réchauffement induit par le CO2 étaient encore discutables et incertaines. Par exemple, Ichtiaque Rasool et Stephen Schneider (1971A227) alertaient sur un risque de refroidissement de 3.5 degrés causé par les aérosols, et pouvant conduire au déclenchement d’une nouvelle ère glaciaire.
Patrice Poyet cite d’autres déclarations (2022A221 p. 413) :
En 1970, il y a exactement 50 ans, le premier Jour de la TerreN50 a encouragé les craintes d’une ère glaciaire, et l’écologiste Nigel Calder a averti : « La menace d’une nouvelle ère glaciaire doit maintenant figurer aux côtés de la guerre nucléaire comme source probable de mort et de misère pour l’humanité » et C. C. Wallen, de l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré : « Le refroidissement depuis 1940 a été suffisamment important et constant pour ne pas s’inverser de sitôt. » Lors de ce même premier Jour de la Terre, Kenneth E. F. Watt a déclaré : « Si les tendances actuelles se poursuivent, le monde sera plus froid d’environ quatre degrés par rapport à la température moyenne globale de 1900, mais de onze degrés d’ici à l’an 2000… C’est environ deux fois ce qu’il faudrait pour nous faire entrer dans une ère glaciaire. »
C’est à ce même Jour de la Terre, en mai 1970, que Harrison Brown, de l’Académie nationale des sciences aux USA, avait averti que « l’humanité serait totalement à court de cuivre peu après l’an 2000. Le plomb, le zinc, l’étain, l’or et l’argent auraient disparu avant 1990. » Et Peter Gunter, professeur de philosophie à North Texas State University, écrivait en 1970 : « En l’an 2000, dans trente ans, le monde entier, à l’exception de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l’Australie, sera en proie à la famine. » (Poyet P, 2022A221 p. 414)
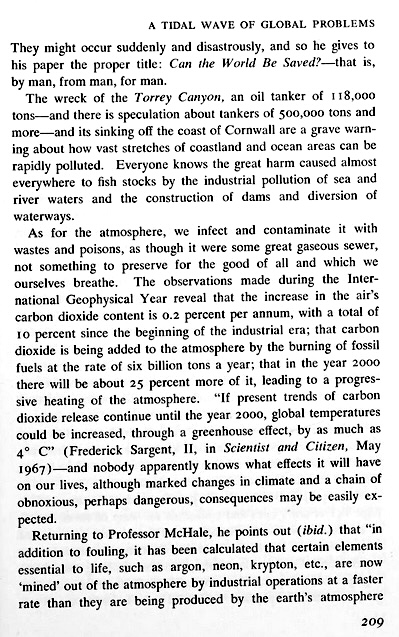
L’accroissement de température annoncé était 40 fois celui qui a réellement eu lieu !
L’hypothèse alarmiste du réchauffement par effet de serre causé par le CO2 était elle aussi avancée, notamment par Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome, qui écrivait dans The Chasm Ahead — « Le précipice qui nous attend » au chapitre A Tidal Wave of Global Problems (1969A213 p. 209) :
Les observations effectuées au cours de l’Année géophysique internationale révèlent que l’augmentation de la teneur en dioxyde de carbone de l’air est de 0.2 % par an, avec un total de 10 % depuis l’ère industrielle ; que le dioxyde de carbone est ajouté à l’atmosphère par la combustion de combustibles fossiles au rythme de six milliards de tonnes par an ; qu’en l’an 2000, il y en aura environ 25 % de plus, ce qui conduira à un réchauffement progressif de l’atmosphère. « Si les tendances actuelles de rejet de dioxyde de carbone se poursuivent jusqu’en l’an 2000, les températures mondiales pourraient s’accroître, par effet de serre, de jusqu’à 4°C. » (Frederick Sargent, II, dans Scientist and citizen, mai 1967A242 p. 82) […]
Frederick Sargent citait en réalité Philip Hauge Abelson dans son éditorial Global Weather de Science (1967A2).
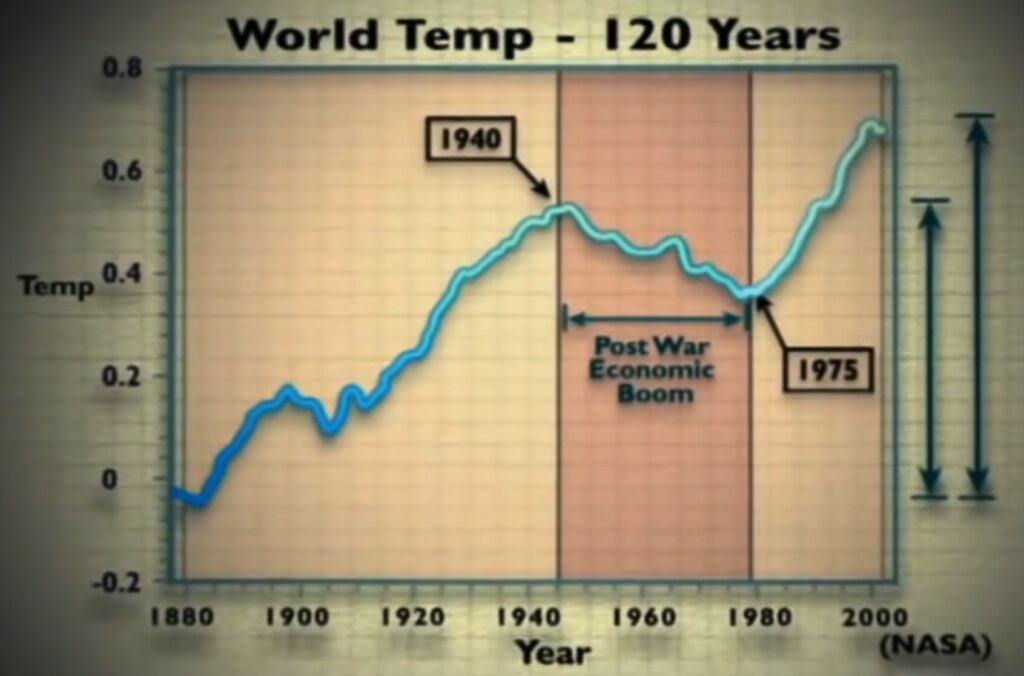
L’historique du consensus des années 1970 sur le refroidissement global, dont se souviennent ceux qui ont connu cette époque — mes parents disaient « à cause des bombes atomiques » — a été délibérément réécrit (notamment par William Connolley sur Wikipedia) pour projeter l’illusion d’une position inverse. Voir à ce sujet l’article Refroidissement global dans les années 1970 : un mythe ? et pour plus de détails, notamment sur les agissements de Connolley (ami de Michael Mann), la section Global Cooling (May A, 2020A173 p. 199–204).
Margaret Thatcher a joué un rôle primordial dans le revirement en faveur de la théorie du réchauffement global — et surtout la politisation de ce sujet — lors de sa confrontation aux grèves des mineurs anglais (1984–85), qui se sont soldées par la fermeture de mines de charbon (Durkin M, 2007A67 36:05). C’est alors qu’elle a soutenu le recours à l’énergie nucléaire, participé au financement de la recherche climatique, et surtout à la fondation du GIEC en 1988. La question du changement climatique est alors devenue un enjeu de nature essentiellement politique médiatisé par les ONG environnementales.
Peu après la création du GIEC, dont il était devenu auteur principal des rapports, le même Stephen Schneider — jusqu’ici prophète du « refroidissement planétaire » — changeait son fusil d’épaule (1989A254 p. 771) :
Les résultats des modèles climatiques les plus récents suggèrent que les températures moyennes à la surface du globe augmenteront d’environ 2° à 6°C au cours du siècle prochain, mais les changements à venir dans les concentrations de gaz à effet de serre et les processus de rétroaction qui ne sont pas correctement pris en compte dans les modèles pourraient produire des augmentations plus importantes ou plus faibles. Des hausses du niveau de la mer de 0.5 à 1.5 mètre sont normalement prévues pour le siècle prochain, mais il existe une faible probabilité de changements plus grands, voire négatifs. […]
Une stratégie consiste à mettre en œuvre dès maintenant les politiques qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre et apporteront des bénéfices sociétaux additionnels. La question de savoir si les incertitudes sont à ce point importantes qu’il faille retarder les réponses politiques n’est pas une question scientifique en soi, mais un jugement de valeur.
Il affirmait la même année (dans Detroit News le 5 décembre 1989) qu’il n’avait jamais alimenté la crainte d’un retour à l’âge glaciaire. Quelques années plus tard, il déclarait (Schneider SH, 2011A255, souligné par mes soins) :
D’une part, en tant que scientifiques, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, promettant en fait de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité — ce qui signifie que nous devons inclure tous les doutes, les mises en garde, les « si », les « et » et les « mais ». D’autre part, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des êtres humains. Et comme la plupart des gens, nous aimerions que le monde soit meilleur, ce qui, dans ce contexte, se traduit par notre travail pour réduire le risque d’un changement climatique potentiellement désastreux. Pour ce faire, nous devons obtenir un large soutien et capter l’imagination du public. Cela signifie, bien sûr, obtenir une couverture médiatique importante. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et dramatiques, et ne pas faire mention de nos doutes éventuels. Cette « double contrainte éthique » dans laquelle nous nous trouvons fréquemment ne peut être résolue par aucune formule. Chacun d’entre nous doit décider du juste équilibre entre efficacité et honnêteté. J’espère que cela signifie être les deux à la fois.
Steven Koonin répond à ce sujet (2021A135 p. 9–10) :
Bien que Schneider ait par la suite abondamment expliqué sa déclaration sur la « double contrainte éthique », je pense que la prémisse sous-jacente est dangereusement erronée. Il ne devrait pas y avoir de question sur « le juste équilibre entre l’efficacité et l’honnêteté ». C’est le comble de l’orgueil pour un scientifique que d’envisager de désinformer délibérément les discussions politiques au service de ce qu’il croit être l’éthique. Cela paraîtrait évident dans d’autres contextes : imaginez le tollé si l’on découvrait que des scientifiques déforment des données sur le contrôle des naissances en raison de leurs convictions religieuses, par exemple. […]
Il n’y a rien de fâcheux à ce que les scientifiques soient des militants, mais le militantisme déguisé en « La Science » est pernicieux.
John Houghton, responsable du groupe GI, épaulé par Rajendra Pachauri, président du GIEC en 2007, avait affirmé ouvertement que « s’ils ne sont pas alarmistes, personne ne prendra leurs travaux au sérieux. » (Allègre C, 2010A9 p. 183)
Koonin écrit par ailleurs (2021A135 p. 183) :
Il est clair que les médias, les politiciens et souvent les rapports d’évaluation eux-mêmes déforment de manière flagrante ce que la science dit sur le climat et les catastrophes. Ces négligences sont le fait de scientifiques qui rédigent et révisent avec trop de désinvolture les rapports, les journalistes qui les relaient sans esprit critique, les rédacteurs en chef qui laissent faire, les militants et leurs organisations qui attisent les feux de l’alarme, et les experts dont le silence public cautionne la tromperie. La répétition constante de ces affirmations et de bien d’autres contre-vérités sur le climat les transforme en « vérités » communément admises.
Patrice Poyet explique son positionnement (2022A221 p. 513) :
En tant que géologue, il m’était évident que le climat a toujours évolué à toutes les échelles de temps, et qu’il n’a pas eu besoin de l’homme pour démontrer sa nature capricieuse ; en tant qu’informaticien, je savais depuis longtemps que les programmes les plus complexes peuvent plus ou moins dire tout ce pour quoi les développeurs les ont conçus (en plus du syndrome “garbage in garbage out” avec des données accordées ou même falsifiées) et même d’une manière parfois mal reproductible selon le paradigme trop souvent rencontré de CACE (Changing Anything Changes Everything) ; et enfin, en tant que géochimiste, je me suis méfié des prétendues preuves (chimiques et physiques) qui expliquaient tout sur la base d’hypothèses exagérément simplistes (absorption radiative par un gaz désigné comme bouc émissaire) et qui, en outre, ne devaient pas être discutées, car le consensus ne vous donnerait pas une chance de faire votre travail en tant que scientifique, c’est-à-dire se poser des questions et évaluer la pertinence des arguments.
La position éthique, qui fait cruellement défaut chez les modélisateurs climato-alarmistes, peut être illustrée par une déclaration du physicien Richard Feynman dans son allocution Cargo Cult Science (1974A80) :
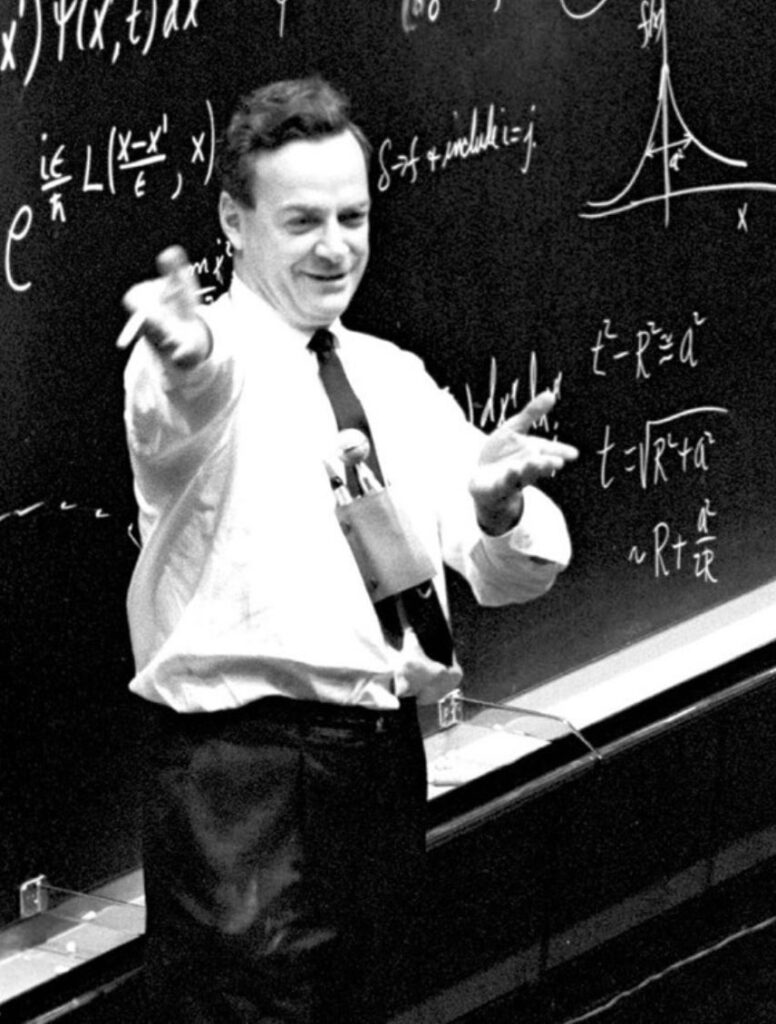
Les détails qui pourraient mettre en doute votre interprétation doivent être donnés, si vous les connaissez. Vous devez faire de votre mieux — si vous savez quelque chose d’erroné ou de possiblement erroné — pour l’expliquer. Si vous élaborez une théorie, par exemple, et que vous en faites la publicité ou la diffusez, vous devez également indiquer tous les faits qui sont en désaccord avec elle, en plus de ceux qui sont en accord avec elle. Il existe également un problème plus subtil. Lorsque vous avez rassemblé un grand nombre d’idées pour élaborer une théorie complexe, il faut vous assurer, lorsque vous expliquez ce à quoi elle correspond, que les éléments auxquels elle correspond ne sont pas seulement ceux qui vous ont donné l’idée de la théorie, mais que la théorie élaborée permet à quelque chose d’autre de s’avérer correct, en plus.
En résumé, l’idée est d’essayer de donner toutes les informations qui aideront les autres à juger de la valeur de votre contribution, et pas seulement les informations qui conduisent à un jugement dans une direction particulière ou une autre. […]
Le premier point est que vous ne devez pas vous tromper vous-même — et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Il faut donc être très prudent à ce sujet. Une fois que l’on ne s’est pas trompé soi-même, il est facile de ne pas tromper les autres scientifiques. Il suffit ensuite d’être honnête de manière conventionnelle.
⇪ Météo versus climat

Dans son analyse du rapport AR6N3 du GIEC, dont il était expert reviewer, François Gervais résume ainsi l’attribution au réchauffement climatique des événements météorologiques extrêmesN51 mis en exergue ces dernières années (2022A94 p. 154) :
L’abondance de « probable » qui constellent le Résumé SPM ne reflète pas ce qui serait attendu pour un texte censé être scientifique. Le corpus de références citées dans cet essai [Impasses climatiques] relativise l’amalgame entre météo et climat qu’a fini par s’approprier le GIEC. C’est un peu trop facile et pas franchement à son honneur. […] Les fluctuations de températures […] ne sont ni plus fréquentes ni plus intenses de nos jours qu’elles ne l’étaient il y a un ou près de quatre siècles. L’amplitude de ces fluctuations, quotidiennes entre le jour et la nuit, saisonnières, excède très largement le minuscule réchauffement annuel anthropique de 0.007°C évalué avec les chiffres du GIEC (bien qu’exagéré compte tenu de la sensibilité climatique trop élevée qu’il reprend), minimisant jusqu’au ridicule l’attribution anthropique des événements météorologiques. Un réchauffement annuel anthropique (exagéré) de sept millièmes de degrés centigrades ne peut évidemment pas causer de manière significative davantage d’incendies de forêt, d’inondations, de sécheresses, ou réduire la vitesse du Gulf Stream. […] En raison du coût pharaonique déclaré par la Banque mondiale, le changement climatique induit par l’Homme reste à démontrer, et ne peut pas seulement être supposé probable.
Shoshiro Minobe et ses collègues ont recherché les causes de l’augmentation en nombre et en intensité des événements météorologiques extrêmes en 2023–2024. Ils écrivent (Minobe S et al., 2025A182 p. 1, 5) :
Les records climatiques ont été battus avec une régularité alarmante ces dernières années, mais les événements de 2023–2024 ont été exceptionnels même en tenant compte des tendances climatiques récentes. Nous quantifions ici ces événements à travers de multiples variables et montrons comment l’accumulation d’énergie excédentaire dans le système terrestre a été à l’origine de ces conditions exceptionnelles. Les facteurs clés ont été la tendance décennale positive du déséquilibre énergétique de la Terre (EEI), les conditions persistantes de La Niña à partir de 2020 et le passage à El Niño en 2023. Entre 2022 et 2023, le réchauffement dû à l’EEI a été supérieur de plus de 75 % à celui observé lors de l’apparition d’événements El Niño récents similaires. Nous montrons en outre comment les processus régionaux ont façonné des schémas distincts de températures de surface de la mer record dans les différents bassins océaniques. Si la tendance récente de l’IEE se maintient, nous soutenons que les fluctuations naturelles telles que les cycles ENSO entraîneront de plus en plus des impacts amplifiés et records, la période 2023–2024 servant d’aperçu des extrêmes climatiques futurs.
[…]
Des progrès récents ont été réalisés dans l’identification de certaines des causes de la tendance positive de l’IEE1, mais de grandes incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne le rôle des aérosols anthropogéniques et des changements dans les nuages. […]
Nos résultats montrent que les extrêmes de 2023–2024 ne peuvent pas être expliqués comme de simples extensions des tendances anthropiques à long terme ; au contraire, il y a eu un rôle critique pour les processus régionaux, dont certains sont liés à des modes interannuels de variabilité (ENSO, wavenumber‑3, dépression des Aléoutiennes) qui ont agi en amplifiant le réchauffement.
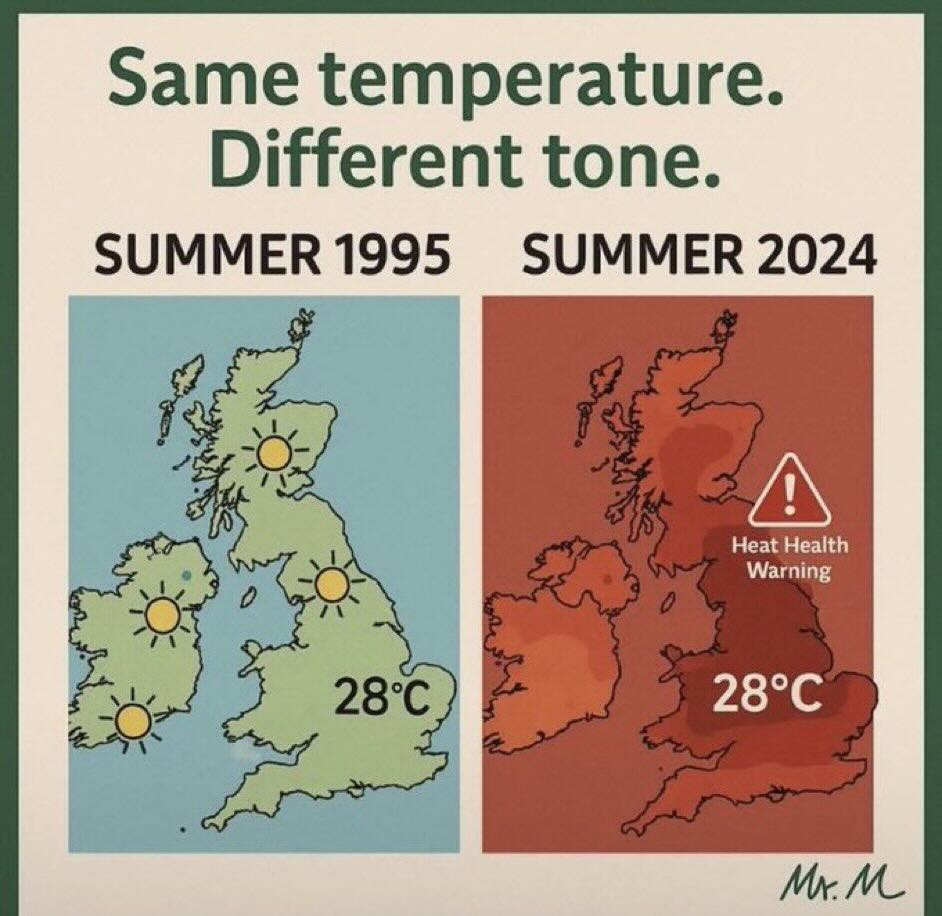
Richard Lindzen, membre de l’Académie nationale des sciences aux USA, était titulaire jusqu’en 2013 de la chaire de météorologie au Massachussetts Institute of Technology. Lors de sa conférence à la Global Warming Policy Foundation à Londres (2018A153 p. 8–9) il déclarait :
En ce qui concerne ces extrêmes, les données ne montrent aucune tendance et le GIEC est d’accord. Même Gavin Schmidt, le successeur de Jim Hansen à l’atelier new-yorkais de la NASA, le GISS, a fait remarquer que « les déclarations générales sur les extrêmes sont pratiquement absentes de la littérature, mais semblent abonder dans les médias populaires. » Il a ajouté qu’il suffit de quelques secondes de réflexion pour se rendre compte que l’idée reçue selon laquelle « le réchauffement climatique signifie que tous les extrêmes doivent augmenter en permanence » est « absurde ».
Au cœur de cette absurdité se trouve l’incapacité à distinguer la météo du climat. Ainsi, le réchauffement climatique fait référence à l’augmentation bienvenue de la température d’environ 1°C depuis la fin du petit âge glaciaire, il y a environ 200 ans. En revanche, les extrêmes météorologiques impliquent des changements de température de l’ordre de 20°C. Ces changements importants ont une origine profondément différente de celle du réchauffement climatique. En termes simples, ils résultent de vents transportant de l’air chaud et de l’air froid depuis des régions éloignées très chaudes ou très froides. Ces vents se présentent sous la forme de vagues. La force de ces vagues dépend de la différence de température entre les tropiques et l’Arctique (des différences plus importantes entraînant des vagues plus fortes). Or, les modèles utilisés pour prévoir le réchauffement climatique prévoient tous que cette différence de température diminuera plutôt qu’elle n’augmentera.
Ainsi, l’augmentation des températures extrêmes serait plus favorable à l’idée d’un refroidissement global qu’à celle d’un réchauffement global. Cependant, les analphabètes scientifiques semblent incapables de faire la distinction entre le réchauffement climatique et les températures extrêmes dues aux conditions météorologiques. En fait, comme on l’a déjà noté, il ne semble pas y avoir de tendance perceptible en ce qui concerne les extrêmes climatiques. Il n’y a que l’attention accrue accordée par les médias aux conditions météorologiques et l’exploitation de cette couverture médiatique par des personnes qui se rendent compte que les projections de catastrophes dans un avenir lointain ne sont guère convaincantes, et qu’elles ont donc besoin d’un moyen de convaincre le public que le danger est immédiat, même si ce n’est pas le cas.

Halène Arezki résume avec brio (2022A10) :
Les médias nous montrent les preuves du changement climatique sur la planète avec les aléas météorologiques comme un ivrogne affirme qu’il est toujours l’heure de l’apéro quelque part sur Terre. Les urbains profonds, y compris ceux qui vivent à la campagne, y voient les premières manifestations de l’apocalypse thermocarbonée qui nous est promise.
Judith Curry ajoute (2024A52 p. 41 ; 2023A51 p. 11) :
La première moitié du XXe siècle a connu davantage de phénomènes météorologiques extrêmes que la seconde, durant laquelle le réchauffement causé par les activités humaines est censé être le principal responsable du changement climatique observé [Kelly MJ, 2016A127].
Après le passage de l’ouragan Harvey, l’incontournable Michael Mann ‘Crosse-de-hockey’ affirmait dans un entretien : « Il ne fait guère de doute pour les scientifiques que le changement climatique a augmenté l’intensité potentielle des ouragans et autres grandes tempêtes » et « Nous envisageons d’abandonner littéralement les villes côtières du monde et de nous déplacer vers l’intérieur des terres. » (Satija N et al., 2017A243).
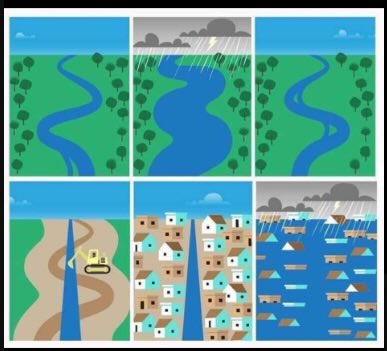
Les médias opèrent des glissements sémantiques caractéristiques du discours catastrophique. Ainsi, on entend souvent parler de « montée des eaux » là où se produisent des inondations — comme si les eaux en question ne devaient jamais redescendre — et toute vague de chaleur de quelques jours est désormais qualifiée de « canicule »…
Gianluca Alimonti et trois collègues avaient publié un article A critical assessment of extreme events trends in times of global warming [Évaluation critique des tendances en matière d’événements extrêmes à l’heure du réchauffement climatique] (Alimonti G et al., 2022A7) qui était en accord avec une conclusion du rapport AR5 du GIEC : « Il est difficile de trouver des tendances significatives dans les données concernant les évènements extrêmes. »

Jugé insuffisamment alarmiste, cet article a été rétracté, suite à la pression exercée dans les médias par des personnages aussi peu prévenants que Michael Mann. Les détracteurs ont stupidement reproché aux auteurs de ne pas avoir fait référence au rapport AR6 (2021N3) du GIEC diffusé après la soumission de l’article. Lire à ce sujet un commentaire de Jean N (2023A198) et le récit de Tony Thomas (2023aA283 ; traduction 2023bA284) :
Ce mauvais traitement était logique puisque l’AFP et The Guardian sont les chefs de file de la coalition Covering Climate Now (CCN) qui regroupe quelque 500 médias touchant 2 milliards de téléspectateurs. Ces médias ont signé l’engagement de CCN de faire la promotion du catastrophisme, de réfuter et de censurer tout scepticisme quant au destin funeste annoncé pour notre planète.
Un nouvel article a été publié par deux chercheurs de la même équipe (Alimonti G & et L Mariani, 2023A6). Contrairement à ce qu’a écrit Tony Thomas (2023aA283 ; traduction 2023bA284), il ne s’agit pas d’une nouvelle version du précédent article, mais d’une analyse des tendances temporelles du nombre de catastrophes naturelles signalées depuis 1900 dans la base de données des événements d’urgence (EM-DATN52) du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (CREDN53). Parmi leurs conclusions :
L’ensemble de données EM-DAT sur les catastrophes naturelles a été analysé au moyen de la méthode par blocsN54 de Tome et Miranda, et il a été conclu que la tendance n’est pas homogène sur l’ensemble de la série 1900–2022 en raison de divers facteurs, le principal étant l’amélioration progressive du signalement des catastrophes naturelles. […]
Le nombre de catastrophes géophysiques contemporaines — volcans, tremblements de terre, glissements de terrain secs — qui, de par leur nature, ne sont pas influencées de manière significative par le climat ni par des facteurs anthropogéniques, affiche une tendance similaire au fil du temps. […]
Par conséquent, avant toute analyse de tendance, la série chronologique doit être divisée en sous-séries : l’intervalle de temps le plus récent, qui commence dans les premières années du 21e siècle, montre une tendance à la baisse dont le degré de réalisme est renforcé par le fait que la série chronologique du nouveau siècle peut être considérée comme complète, étant donné l’efficacité accrue des activités de surveillance et de signalement des catastrophes naturelles.
Ensuite, l’affirmation selon laquelle nous sommes confrontés à une tendance à la hausse des catastrophes naturelles, comme le prétendent les trois rapports officiels de l’UNDRR et de la FAO (FAO, 2021A77 ; UNDRR, 2020A293 ; UNDRR, 2022A294) sur la base du même ensemble de données EM-DAT, a été vérifiée : une tendance linéaire sur les données à partir de 1970 a été trouvée dans le rapport le plus récent de l’UNDRR (UNDRR, 2022A294), et cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir, prévoyant ainsi une nouvelle augmentation des catastrophes naturelles de 40 % pendant la durée de vie du Sendai Framework. Notre conclusion est que les affirmations présentées dans les rapports susmentionnés ne sont pas étayées par des données.
À la lumière de cette déduction, les auteurs s’inquiètent de la présentation erronée de la tendance en matière de catastrophes naturelles, car ces affirmations ont été diffusées sans esprit critique par de nombreux médias, et par la FAO elle-même, déformant ainsi la perception du public sur le risque de catastrophes naturelles. Considérons que si la tendance trouvée par l’ajustement linéaire proposé par l’UNDRR est projetée, 560 catastrophes naturelles sont prévues d’ici 2030 (UNDRR, 2022A294) et plus de 700 d’ici 2050 ; l’ajustement plus réaliste proposé dans ce travail donnerait au contraire environ 200 catastrophes de moins d’ici 2030, et moins de la moitié d’ici 2050.
Une mauvaise interprétation de l’évolution des catastrophes naturelles est très grave, car elle expose la population mondiale au risque de politiques incohérentes, tant au niveau national qu’international, gaspillant ainsi des ressources ou les détournant de la résolution de problèmes beaucoup plus concrets.
Le fait que la mortalité due à des événements climatiques ou atmosphériques extrêmes ait diminué de plus de 90 % au cours du siècle dernier, alors que la population mondiale a fortement augmenté, nous invite à réfléchir aux causes d’un tel phénomène. Selon nous, l’absence de croissance des catastrophes naturelles au cours du nouveau millénaire atteste de l’efficacité des politiques de protection civile mises en place pour la gestion des catastrophes naturelles (PPRR – Prevention, Preparedness, Response and Recovery) au cours des dernières décennies.

Un examen critique des données de l’EM-DATN52 permet de dresser un « état des lieux » des catastrophes naturelles mondiales, en veillant à corriger les doubles comptages (MD, 2024A163) :
Au vu des graphiques précédents, rien ne permet d’affirmer que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves comme le prétendent certains commentateurs. Aucune tendance n’est discernable sur ce quart de siècle. Les écarts interannuels parfois considérables s’apparentent plutôt à des tirages au hasard, même si le hasard frappe plus fréquemment certaines régions du monde plus exposées du fait de leur géographie ou de leur géologie.
L’association entre le changement climatique et les événements atmosphériques extrêmes reste solidement ancrée dans le discours médiatique. Par exemple sur la radio France Info. En octobre 2023, une présentatrice météo terminait son annonce d’une tempête sur les côtes de Bretagne, précisant : « Notez bien qu’on a affaire, une fois de plus, à un marqueur du réchauffement climatique. » Il est intéressant de noter que le mot évasif « marqueur » a été habilement substitué à celui de « preuve ».
Quelques semaines plus tôt, un directeur de recherche du CNRS expliquait que la tempête Daniel qui venait de frapper la Libye « n’était pas en lien avec le réchauffement climatique ». Il s’était senti toutefois obligé de conclure son intervention par : « Il est indispensable de réduire la production de gaz à effet de serre. »
En novembre 2023, après le passage de la tempête Ciaran sur la Bretagne, le préfet d’Ille-et-Vilaine expliquait à la radio qu’il était très risqué de s’aventurer en forêt car, « à cause du réchauffement climatique », les arbres avaient gardé leurs feuilles plus longtemps. Trop lourds, ils s’écrasaient dangereusement sur le sol ! Une absence de feuilles, dans un autre contexte, aurait tout aussi bien été mise sur le compte du réchauffement…

Par un effet de formation des masses ou de polarisation des groupes (voir ci-dessous), les journalistes ont — sans y être obligés — intégré la confusion entre météo et climat. Ils ne parlent plus d’événements météorologiques extrêmes mais d’événements climatiques extrêmes. Les mots « climat » et « climatique » sont de plus en plus omniprésents dans les messages. En octobre 2023, j’ai entendu une présentatrice de radio, voulant parler des « élèves de CM2 » à l’école primaire, dire « les élèves de CO2 » sans même corriger ce lapsus révélateur d’un alarmisme obsessionnel !
En mars 2024, on apprend dans la presse (Les Échos) que « les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards d’euros aux assureurs en 2023. » À ce sujet, Rémy Prud’homme écrit (2025A223) :
Le Figaro, qui cite l’AFP, qui cite les Assureurs de France explique que le coût des événements climatiques pour les assureurs est trois fois plus élevé en 2024 (5 milliards) qu’en 1984 (1.5 milliard). Ces trois institutions voient là une preuve irréfutable des méfaits croissants du « dérèglement climatique ». Vite, doublons la taxe carbone et les crédits du ministère de la transition écologique ! Il est pourtant facile de voir que la démonstration est quadruplement mensongère.
Primo, elle compare un coût en euros 1984 avec un coût en euros 2024, une absurdité que l’on ne pardonnerait pas à un étudiant de première année. Secundo, cette présentation ignore le fait qu’en 40 ans, la France s’est développée, qu’il y a davantage de maisons, d’entreprises, de routes, etc. à la merci des phénomènes climatiques, et qu’un ouragan donné détruit plus de biens en 2024 qu’en 1984. Tertio, elle fait l’hypothèse que le taux d’assurancialité (le pourcentage de propriétaires assurés) est resté constant ; on espère pour les assureurs qu’il a augmenté. Quarto, elle postule que les dommages naturels dépendent uniquement de la violence des phénomènes et pas du tout des mesures prises pour les contrôler.
Il est facile corriger les deux premiers mensonges. Il suffit de comparer le ratio coût des dommages / PIB (en euros courants) pour les deux dates. En 1984, il était de 0.20 %. En 2024, de 0.17 %. Rapporté au PIB, le coût pour les assureurs des phénomènes climatiques n’a pas augmenté de 230 % (ce qui serait effrayant), il a au contraire diminué de 15 % (ce qui est rassurant).
Quid des grands incendies de forêts ?
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, affirmait en été 2023 : « Nous voyons de plus en plus de ces feux à cause du changement climatique. » Les journalistes qui ont relayé ce message en boucle n’ont pas pris la peine de consulter la base de données des nombres d’incendies et des superficies forestières brûlées au Canada. Celles-ci ne varient pas dans le sens d’une augmentation, et certainement pas en lien avec la production de gaz à effet de serre (2021N55) :
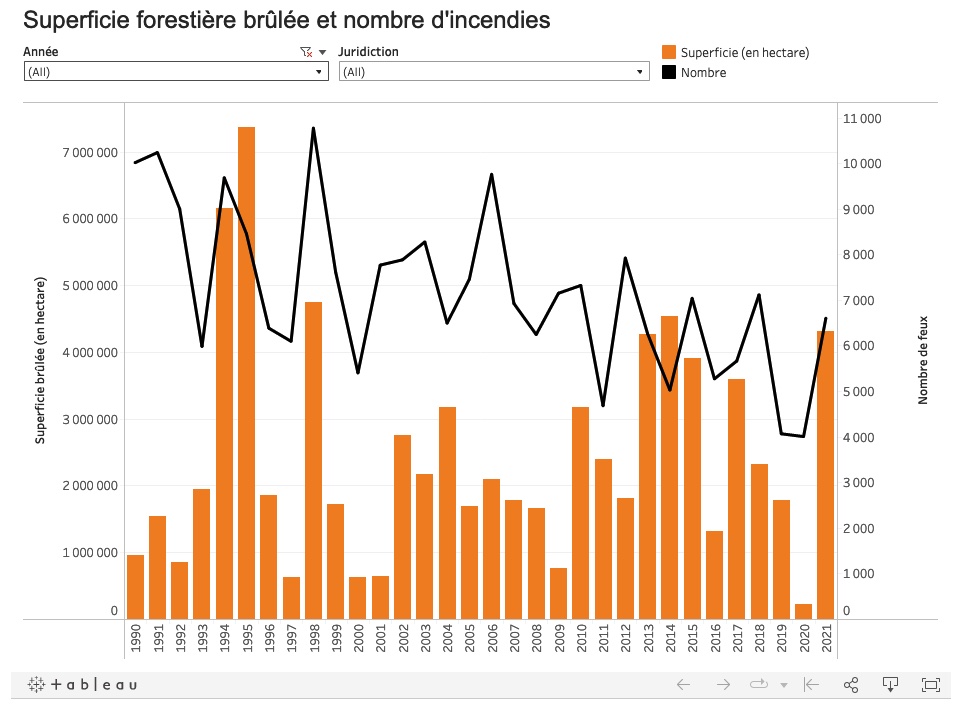
Source : Base de données nationale sur les forêts (BDNFN55)
La confusion entre météo et climat est à la source de généralisations hâtives qui font la une des médias. La longue période de sècheresse suivie de pluies torrentielles en Californie est exemplaire de ces pirouettes rhétoriques (Koonin SE, 2021A135 p. 178) :
Les incertitudes climatiques sont plus importantes au niveau régional qu’au niveau mondial. Par exemple, pendant les cinq ou six premières années de la récente sécheresse en Californie, de nombreux climatologues ont affirmé que les influences humaines sur le climat augmentaient le risque de sécheresse (Diffenbaugh NS et al., 2015A62). Pourtant, il n’a fallu qu’un an environ, après la fin dramatique de la sécheresse en 2016, pour que des articles soient publiés, affirmant qu’un monde qui se réchauffe signifierait également une Californie plus humide (Allen RJ & RG Anderson, 2018A8). Peut-être s’agit-il simplement d’un processus d’affinement des connaissances scientifiques. De manière moins charitable, j’ai la nette impression que la science est suffisamment incertaine pour que n’importe quel phénomène météorologique inhabituel puisse être « attribué » à des influences humaines.
En citant les travaux de Roger Pielke Jr (2014A216), Emmanuel Garnier écrit (2018A87 p. 36) :
Sur ce site, il montre qu’entre 1990 et 2014 le total mondial, en milliards de dollars, des montants des dommages dus aux événements climatiques en général, compilés par le réassureur Munich Re, a suivi une pente ascendante. Mais il montre surtout qu’il n’en va pas de même lorsqu’on normalise les dommages en les évaluant en pourcentage du produit national brut mondial. Dans ce cas il n’y a aucune tendance. Autrement dit, l’essentiel de la croissance des dommages liés aux événements climatiques est dû à la croissance économique mondiale, pas au réchauffement lui-même. […]
Ne pas mesurer d’impact significatif du réchauffement climatique sur les montants des dommages ne revient pas à nier ce réchauffement. S’il doit être mis en évidence, la mesure des dommages n’est pas un indicateur fiable. Enfin, la source de bien des errements nourrissant les polémiques est contenue dans les données des dommages elles-mêmes. Cette source d’erreur concerne les défenseurs des thèses du Giec tout comme les climatosceptiques.
Judith Curry écrit (2024A52 p. 289–290 ; 2023A51 p. 180) :
Si les risques découlant du changement climatique sont jugés intolérables, c’est parce que l’on confond, à tort, la lente montée du réchauffement planétaire (risque émergent) avec les conséquences des événements climatiques extrêmes (risques urgents) et que l’on estime inacceptable que les populations les plus pauvres soient les plus exposées. Si l’on dissociait les risques associés aux événements météorologiques et climatiques extrêmes des effets du réchauffement planétaire, cela réduirait l’urgence perçue de réduire les émissions des combustibles fossiles. Les populations les plus pauvres bénéficieraient bien plus de l’accès à un réseau électrique et d’une aide à réduire leur vulnérabilité face aux événements météorologiques extrêmes que de la réduction de la quantité de CO2 dans l’atmosphère [Lomborg B, 2024A157].
Le personnel politique chargé des conférences sur le climat ne « capte » pas vraiment ces messages (Gervais F, 2018A92) :
La météo dépend essentiellement des gradients de pression mesurés par le… baromètre. Les gradients régissent les vents, eux-mêmes véhiculant les nuages et les masses d’air chaud ou froid. Sur cet instrument inventé en 1643 par Torricelli, « tempête » indique le vent prévu pour une pression atmosphérique très basse. Au-dessus est inscrit « forte pluie » et/ou « vent fort », au-dessus encore « pluie », à 76 centimètres de mercure « variable ». Cette valeur correspond à la pression atmosphérique moyenne, 1013 millibars au niveau de la mer. Pour des pressions plus élevées, le baromètre indique « beau temps ». Également découverte par Torricelli, la corrélation entre pression atmosphérique et le temps qu’il va faire, pour être simple n’en est pas moins relativement fiable. En revanche, on aura remarqué qu’un thermomètre extérieur, dont la graduation peut descendre jusqu’à ‑20°C durant les vagues de froid et monter à 40°C durant les canicules, n’indique pas une température particulière à laquelle correspondrait « tempête », « vent », « grêle » ou « orage ». C’est ce que j’ai gentiment rappelé au secrétaire d’État alors en charge de la préparation de la COP 21 avec lequel je débattais sur RTL en 2014. Il m’a répondu : « je ne suis pas scientifique »… Ce qui ne l’empêche pas d’avoir entre-temps été nommé directeur de WWF France et d’être consulté comme « expert » à ce titre.
François Gervais parlait ici de Pascal Canfin, ancien ministre délégué chargé du Développement de 2012 à 2014, nommé directeur général du WWF France en janvier 2016. Voir la vidéo de cet entretien.
⇪ Le CO2 source de nos malheurs ?

Nous avons vu dans la section Réalité de « l'empreinte carbone» que l’augmentation du taux atmosphérique de CO2 — dont l’attribution à l’activité humaine est quantifiée de manière incertaine — a une influence négligeable sur la température globale de la Planète, puis, dans Météo versus climat, qu’elle ne pouvait pas plus être tenue pour responsable de phénomènes météorologiques extrêmes.
Cette augmentation du CO2 est en réalité un bénéfice pour la couverture végétale, notamment dans les zones arides. Le rapport AR6N3 du GIEC le reconnaît (Groupe I, 2021 p. 50) :
L’augmentation du CO2 atmosphérique, le réchauffement des hautes latitudes et l’usage des sols ont contribué à la tendance au verdissement observée.
L’océanographe Roger Revelle, qui a été le maître à penser d’Al Gore au sujet du réchauffement climatique d’origine anthropique, a donné une interview en 1984 dans le magazine Omni. Claude Allègre précise (2010A9 p. 193) :
[…] il affirme que cette augmentation de CO2 va augmenter la fertilité de l’agriculture et minorer les changements trop brutaux du climat. Dans l’interview qu’il donne au Times en 1987, il est toujours aussi prudent : il dit que rien n’est prouvé, et qu’il faut travailler d’avantage pour comprendre les effets du CO2. En 1990, au congrès de l’American Association for the Advancement of Science à la Nouvelle-Orléans, Revelle présente un document décapant, en tout cas dérangeant : l’augmentation du CO2, écrit-il, va favoriser le développement du plancton, et l’activité photosynthétique de ce dernier va réguler le CO2. Eh bien, Revelle ne sera jamais consulté par le GIEC, ni inclus dans ses groupes de travail.
L’article d’Audrey M Yau et collègues (2016A317) décrit la plus récente période interglaciaire (Éémien) de 130 000 à 115 000 ans avant le présent. L’Europe de l’Ouest était alors peuplée de Néandertaliens. Les températures estivales de l’Arctique étaient de 3 à 5 °C plus élevées qu’aujourd’hui, et le niveau de la mer plus élevé de 6 à 9 mètres. Les auteur·e·s ont formulé l’hypothèse que la fonte de glace au Groenland n’était pas la cause première de l’élévation du niveau de la mer, et que l’Antarctique jouait un rôle plus important.
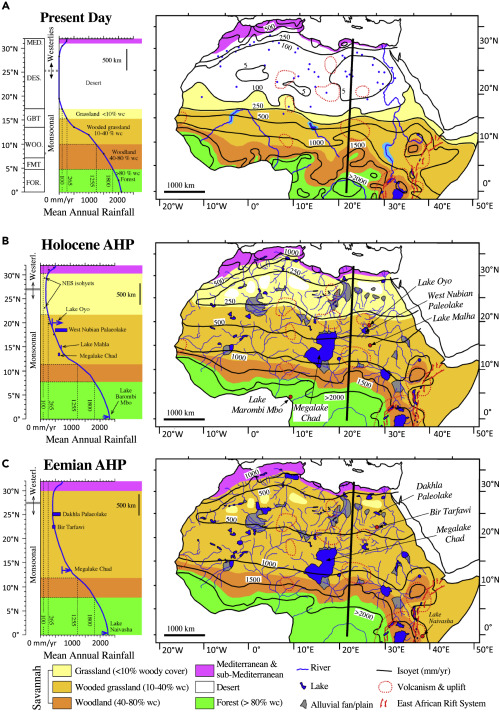
À cette époque, la couverture végétale de l’Afrique était nettement plus importante qu’aujourd’hui, comme le montrent les cartes publiées par Francesco SR Pausata et al. (2020A212) — voir image ci-jointe. Ces données réfutent la croyance que le réchauffement climatique se traduirait systématiquement par une « désertification ».
La couverture forestière de l’Afrique subsaharienne s’est accrue de 8 % en trois décennies (Bastin JF et al., 2017A16 ; voir sept autres références dans Gervais F, 2022A94 p. 131). Les jeunes forêts tropicales humides peuvent absorber onze fois plus de carbone atmosphérique que les forêts anciennes (Poorter L et al., 2016A219). Le rapport Sécheresse, désertification et reverdissement au Sahel de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification reconnaît (Descroix L, 2021A61) :
[…] un reverdissement général et spontané du Sahel, comme si, 25 ans après le retour d’une pluviométrie « normale » (en quantité de pluie tombée mais leur intensité a crû sensiblement), la végétation parvenait à reprendre sa place et ses droits.
Judith Curry a exposé des prédictions concernant les régions dont la survie dépend de la régularité des moussons. Selon les indications de l’AR6 du Groupe 1 (2021N3) (Curry JA, 2024A52 p. 245, 246, 249 ; 2023A51 p. 149, 150, 151) :
• L’augmentation des gaz à effet de serre (principalement le CO2) contribue puissamment aux changements de la mousson, qui se traduisent par une augmentation des pluies.
• Les émissions industrielles de particules d’aérosols affaiblissent, pense-t-on, la mousson.
• L’expansion massive de l’agriculture aux dépens de la forêt et des zones arbustives, avec une irrigation généralisée, contribue au dessèchement.
• Les modes de variabilité climatique décennale, comme l’oscillation décennale du Pacifique et l’oscillation multidécennale de l’Atlantique, provoquent une modulation décennale de la mousson. […]
L’augmentation apparente des pluies de mousson depuis 2002 est due, soit à un changement de dominance d’un forçage (par exemple des aérosols par rapport aux gaz à effet de serre), soit à un changement de phase de l’oscillation pacifique décennale [Jin Q & C Wang, 2017A124. […]
L’AR6 estime que les précipitations de mousson augmenteront probablement de 1.3 à 2.4 % par degré Celsius de réchauffement. […]
Je me suis souvent demandé si, dans le cas où la politique régissant les émissions était décidée par un vote, la majorité de la population mondiale ne voterait pas pour une augmentation des émissions de CO2 (à condition que les émissions d’aérosols soient réduites) afin d’accroître la ressource en eau, facteur qui domine le bien-être de la région.
La reforestation et l’amélioration des pratiques agricoles contribuent au verdissement de la planète. En Chine, la surface verte a presque doublé en 17 ans, en partie grâce au dioxyde de carbone, mais aussi à un programme massif de reforestation et de multicultures saisonnières qui maintiennent la végétation au sol la plupart du temps (Chen C et al., 2019A34).
Bjørn Lomborg écrit (2024A157 p. 55–56) :
Les chercheurs ont constaté que le verdissement de la planète au cours des trente-cinq dernières années a fait pousser des feuilles sur des plantes et des arbres d’une superficie équivalente à deux fois celle de la partie continentale des États-Unis. Cela équivaut à verdir l’ensemble du continent australien avec des plantes ou des arbres, à hauteur de deux fois. Il est tout à fait remarquable qu’en quelques décennies, nous ayons obtenu l’équivalent de deux continents entiers de verdure à cause du dioxyde de carbone, et que pratiquement personne n’en ait entendu parler [Hille KB, 2016A112].
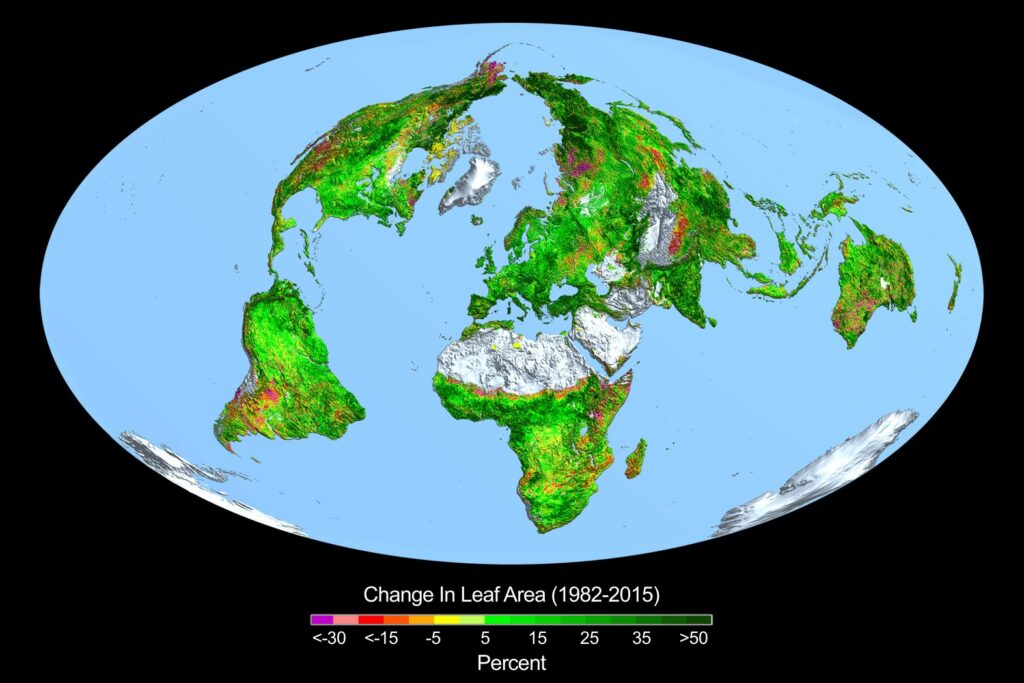
Source : Boston University/R. Myneni (Hille KB, 2016A112)
⇪ Pétitions et déclarations
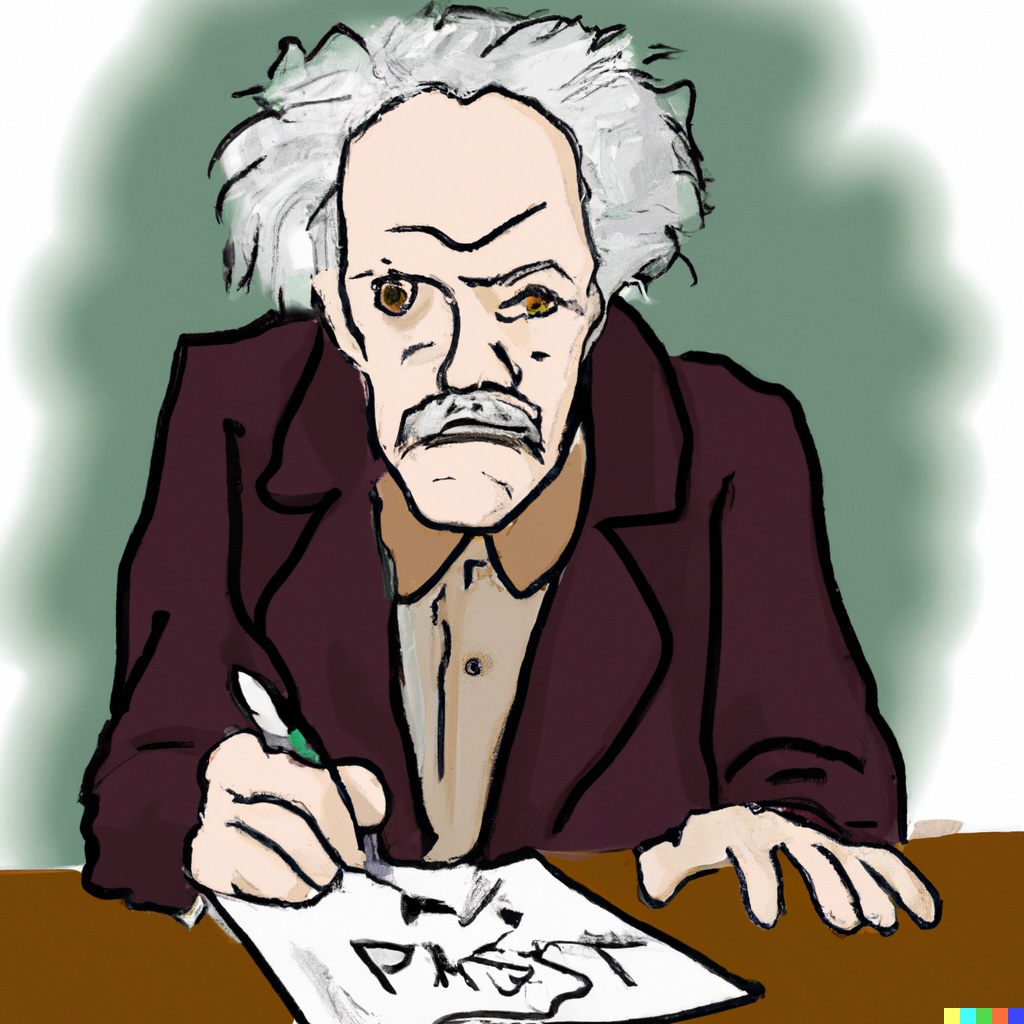
Le « consensus », à l’époque d’Al Gore, était loin de représenter la « science établie » (settled science), si l’on en juge par la signature d’une pétition sur le réchauffement global (2008N56) qui avait rassemblé pas moins de 31 000 universitaires américains, tout en étant ignorée par la presse (Bast D, 2008A14) :
« La presse grand public est guidée par l’alarmisme », explique M Taylor. « Si vous avez une bonne nouvelle — 31 000 scientifiques ne pensent pas que la fin du monde est proche — la presse ne veut pas vraiment l’entendre, ni la partager avec ses lecteurs et ses auditeurs. »
Une critique radicale du fonctionnement du GIEC a été publiée en 2011 par Ross McKitrick, préfacée par John Howard, ancien premier ministre de l’Australie qui se déclarait « agnostique » en matière de climat. Les points essentiels soulevés par ce rapport étaient (McKitrick R, 2011A180 p. 29) :
• Le processus opaque de sélection des auteurs principaux et le recrutement confidentiel des auteurs collaborateurs ;
• L’absence de toute exigence contraignante permettant d’intégrer l’ensemble des points de vue ;
• Les failles et les lacunes dans la séquence d’examen par les pairs ;
• Les conflits d’intérêts intellectuels.
D’autres déclarations contredisant les annonces du GIEC ont été publiées par la suite. Voir notamment une Enquête sur l’urgence climatique (Mathieu A & C Veyres, 2021A171) concrétisée par un échange avec François-Marie Bréon, président de l’Association française pour l’information scientifique. Mathieu et Veyres soulignent plusieurs décennies d’incertitudes et écrivent en conclusion (2021A171 p. 26) :
Le prochain rapport du GIEC devra donc fournir une preuve incontestable et non une croyance, fondée sur des aberrations scientifiques, que les émissions humaines sont la cause du réchauffement. Faute de cette preuve, le scepticisme grandira.
L’analyse critique des questions climatiques est synthétisée dans l’article N’ayez pas peur ! Onze faits démontrent qu’il n’y a pas et qu’il ne saurait y avoir de réchauffement climatique dû aux combustibles fossiles (Veyres C, 2019aA300) complété par ses Réponses à des Questions Fréquemment Posées (FAQ) (Veyres C, 2019bA301).
Camille Veyres avait aussi publié un article de 167 pages intitulé Sur la preuve de fautes intentionnelles dans lequel il faisait état de « la responsabilité civile et pénale des auteurs et propagandistes de fraudes et de tromperies » (Veyres C, 2020aA302 p. 10).
La CLINTEL Foundation a publié une analyse pointilleuse du rapport AR6N3 du GIEC : The Frozen Climate Views of the IPCC. An analysis of AR6 (Crok M & A May eds., 2023A49).
La pétition « Il n’y a pas d’urgence climatique » (2023N57), initiée par John Clauser a été signée par plus de 1000 scientifiques, universitaires, ingénieurs, professionnels de l’environnement et de la santé de 37 pays, qu’on peut mettre en balance avec les 234 scientifiques de 66 pays signataires en 2021 du rapport AR6N3 du GIEC (Groupe 1). François Gervais a répondu point par point (2022A94 p. 175–179) aux critiques (non étayées) de cette déclaration, publiées sur le site Climatefeedback.
Évoquées dans les sections précédentes, les critiques des praticiens de sciences dures vis-à-vis du cliché simpliste servant d’oriflamme au GIEC peuvent être résumées ainsi (Poyet P, 2022A221 p. 432) :
Il convient de rappeler que le climat est en fait la conséquence d’une interaction incroyablement complexe de forces massives et diverses, allant des variations de l’intensité du rayonnement solaire aux excentricités de l’orbite terrestre, à la précession de l’axe et à sa rotation, à l’absorption et à la réflexion atmosphériques, à la convection et à l’advection, à l’absorption de la chaleur par les océans, aux courants de mélange et à la circulation thermohalineN14, au volcanisme, et même à la tectonique des plaques créant des ceintures de montagnes influençant l’emplacement des moussons et la circulation atmosphérique mondiale, ainsi qu’à de nombreuses autres forces massives interagissant entre elles.
Les alarmistes climatiques prétendent que l’ensemble de ces forces massives est en quelque sorte insignifiant par rapport à un changement de seulement 0.007 % sur 250 ans dans la concentration d’un gaz à l’état de trace dans l’atmosphère terrestre, qui ne représente au total que 0.04 % de l’atmosphère, ce qui est manifestement absurde. Ce gaz est essentiel à la vie et, à d’autres moments de l’histoire de la Terre, sa concentration a été jusqu’à dix fois supérieure sans aucun effet néfaste. En fait, les périodes de forte concentration ont été marquées par une vie végétale et animale incroyablement luxuriante, vivante et diversifiée, dont les restes de carbone fossilisés ont engendré les vastes réserves de pétrole et de gaz dont nous dépendons aujourd’hui pour faire vivre la civilisation humaine.
⇪ Vers un « enfer climatique » ?

Après la publication du rapport AR6N3 du GIEC (2021), l’ancien directeur de l’Environmental Assessment Institute de Copenhague, Bjørn Lomborg, soulignait dans un tweet, que cela fait cinquante ans que les directeurs successifs du Programme Environnement des Nations unies (UNEP, dont dépend le GIEC) nous avertissent du « désastre » si l’on ne fait rien. Selon Maurice Strong, en 1972, il nous restait dix ans pour arrêter la catastrophe en mettant fin à la société industrielle. En 1982, le nouveau directeur de l’UNEP, Frank Bradford Morse, prédisait « une catastrophe environnementale aussi irréversible qu’un holocauste nucléaire » vers les années 2000. En 1989, nous devions stopper le changement climatique en 1999 avant qu’il n’échappe à notre contrôle. En 2007, Rajendra Pachauri, président du GIEC, disait : « Si l’on n’agit pas avant 2012, il sera trop tard… » etc.
Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, déclarait à un forum de Davos : « Si nous n’agissons pas sur le changement climatique, les générations futures seront rôties, grillées, toastées et ébouillantées. » (Hirschler B, 2013A114).
Bjørn Lomborg écrit (2024A157 p. 49) :
L’histoire est la suivante : le réchauffement climatique aggrave les choses, et comme il touche presque tout, il aggrave presque tout. Le scénario nous dit que là où il y a plus de pluie, il y aura des inondations, et là où il y a moins de pluie, il y aura de la sécheresse. Le réchauffement climatique sera bénéfique pour les mauvaises choses et néfaste pour les bonnes.

En 2011, l’UNEP prédisait « 50 millions de réfugiés climatiques » en 2020 (Zeitvogel K, 2011A318). La même prédiction avait été faite par l’UNEP en 2005 pour 2010…
Le mythe de l’exode imminent de réfugiés climatiques est périodiquement recyclé sans qu’un esprit fâcheux n’ose relever que l’oracle précédent ne s’est pas concrétisé (Boas I et al., 2019A24 p. 903) :
Au lieu de laisser la politique dicter les priorités de la science, ce qui a pour effet de perpétuer de fausses affirmations sur les migrations induites par le climat, le processus de réflexion scientifique doit permettre à une recherche minutieuse et critique de données probantes de signaler les principaux défis à relever.
Parmi les nombreux points abordés dans l’article The Frozen Climate Views of the IPCC (Les opinions figées du GIEC sur le climat) (Crok M & A May eds., 2023A49) figure l’absence de mention d’un document intitulé « La prospérité au 21e siècle : Accroître le développement, réduire les inégalités, l’impact du changement climatique » (2020A156), dont une section traite des décès liés au climat. L’auteur de cet article est le sus-nommé Bjørn Lomborg, fondateur du Copenhagen Consensus Center. Les rédacteurs (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 164–167) présentent le travail de Lomborg comme une réponse à l’annonce (précitée) du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’un « enfer climatique » qui nous attend au virage…
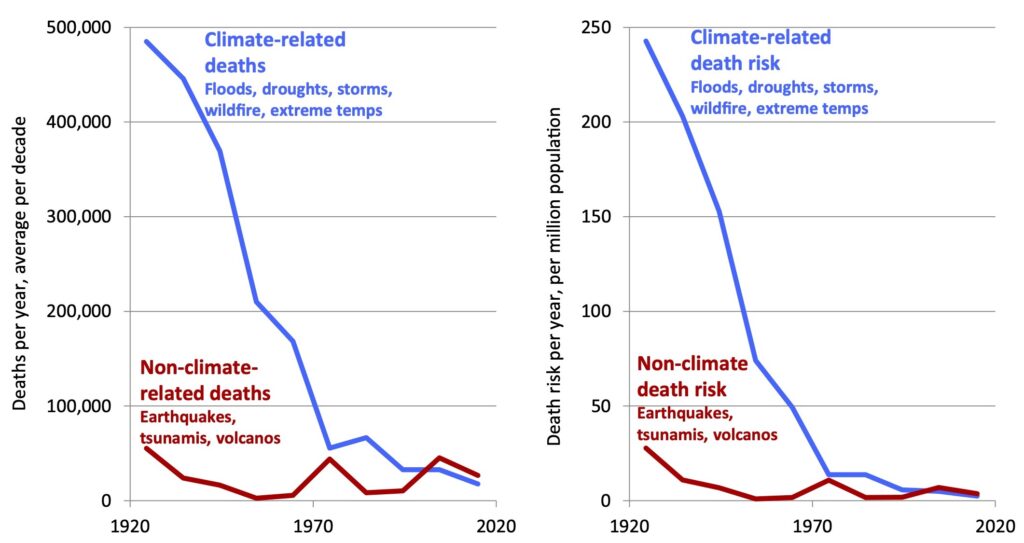
Marcel Crok, Andy May et leurs collègues rédacteurs citent l’unique mention positive de ce sujet dans le rapport AR6 (2021N3) du GIEC :
Cependant, la bonne nouvelle s’est glissée dans le rapport, à la page 2435 (sur 3068 !) le GIEC mentionne un article de Formetta et Feyen qui a le titre révélateur Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-related hazards [Preuves empiriques de la diminution de la vulnérabilité mondiale aux risques liés au climat] (en gras de ma main) :
« Formetta et Feyen (2019A82) démontrent une baisse de la mortalité mondiale toutes causes confondues et des pertes écologiques dues aux événements météorologiques extrêmes au cours des quatre dernières décennies, avec les réductions les plus importantes dans les pays à faible revenu, et avec des réductions corrélées à la richesse. »
La recherche pour cet article a été financée par la Commission européenne, et provient donc d’une source irréprochable.
Ceci pour déplorer la non-prise en compte des données EM-DATN52 (Crok M & A May eds., 2023A49 p. 167) :
Une fois de plus donc, le GIEC ignore un document clé (de Bjørn Lomborg dans ce cas), qui présente de très bonnes nouvelles quant à la diminution de l’impact des conditions météorologiques extrêmes sur l’homme. Il n’évoque pas ces bonnes nouvelles, que ce soit dans le rapport complet, ni dans le résumé à l’intention des décideurs politiques. Il s’ensuit que les décideurs politiques ont une image trop négative du changement climatique et de son impact sur l’Homme. Il n’y a aucune excuse à cela. Le GIEC est au courant de l’existence de la base de données EM-DAT, et Bjørn Lomborg en est l’un des spécialistes.
En examinant les pertes dues aux catastrophes et les décès liés au climat, le GIEC aurait pu simplement réitérer ses conclusions du rapport AR5 WG2 (chapitre 10, résumé exécutif) (en gras de ma main) :
« Pour la plupart des secteurs économiques, l’impact du changement climatique sera faible par rapport aux impacts d’autres facteurs (preuves moyennes, accord élevé). Les changements dans la population, l’âge, le revenu, la technologie, les prix relatifs, le mode de vie, la réglementation, la gouvernance et de nombreux autres aspects du développement socio-économique auront un impact sur l’offre et la demande de biens et services économiques qui est important en comparaison à celui du changement climatique. {10.10} »
En réalité, les décès liés au climat sont pour la plupart ceux de personnes mortes de froid, la surmortalité hivernale étant même extrêmement sensible dans les pays riches et aggravée par l’augmentation du coût de l’énergie. Chiffres à l’appui, Allan MR MacRae écrit (2019A164) :
C’est le froid, et non la chaleur, qui est de loin le plus grand tueur de l’humanité. Aujourd’hui, le temps frais ou froid tue environ 20 fois plus de personnes que le temps chaud ou tiède. La surmortalité hivernale, définie comme le nombre de décès au cours des quatre mois d’hiver par rapport aux mois non hivernaux équivalents, s’élève à plus de deux millions d’âmes par an, aussi bien dans les climats froids que dans les climats chauds. La Terre est plus froide que l’optimum pour l’humanité, et le réchauffement climatique modéré actuellement observé allonge la durée de vie.
Camilo Mora et ses collègues (2017A183) avaient fait grand cas de 783 décès survenus pendant de fortes chaleurs, ajoutant que : « Les vagues de chaleur mortelles sont souvent mentionnées comme l’une des principales conséquences du changement climatique en cours, les rapports citant généralement des événements majeurs passés tels que Chicago en 1995, Paris en 2003 ou Moscou en 2010. » Patrice Poyet signale qu’il a été prouvé que toutes les canicules ici mentionnées n’avaient aucun rapport avec le réchauffement climatique. Il ajoute (Poyet P, 2022A221 p. 428) :
Les journalistes endoctrinés et les grands médias partisans portent une sinistre responsabilité dans les opérations de désinformation du public. Ils ignorent les preuves fournies par une étude [Gasparrini A et al, 2015A88] portant sur 74 millions de décès dans treize pays chauds et froids, dont la Thaïlande et le Brésil, ainsi que par des études menées au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Australie et au Canada, et accordent un intérêt immédiat, concerté et disproportionné à une étude douteuse [Mora C et al., 2017A183] basée sur 783 cas, formulant des prévisions sans fondement pour l’an 2100.
Contrairement à la croyance populaire, la Terre est plus froide que l’optimum pour la survie de l’homme, nous sommes à l’origine une espèce tropicale peu adaptée au froid intense. Un monde plus chaud, tel qu’on l’a connu pendant la période chaude romaine et la période chaude médiévale, réduit la mortalité hivernale, tandis qu’un monde plus froid, tel que le petit âge glaciaire, l’augmente. Ces conclusions sont connues depuis plusieurs décennies, sur la base des statistiques nationales de mortalité, mais les journaleux finissent par dire le contraire de la vérité la plus flagrante.
La Société de géographie a relayé un communiqué faisant l’écho d’un rapport du Lancet (Watts N et al., 2020A309) selon lequel « les décès liés à la chaleur chez les plus de 65 ans ont augmenté de 54 % lors des deux dernières décennies, pour atteindre près de 300 000 morts en 2018 » (Société de géographie, 2010A266). Dans leur communiqué, les climato-réalistes rappelaient que cinq ans plus tôt le même Lancet avait publié un article révélant que le froid tue vingt fois plus que que le chaud (Gasparrini A et al., 2015A88).
⇪ De nouvelles épidémies ?

Les climato-alarmistes affirment que le « réchauffement » climatique aura pour effet une extension de l’habitat des moustiques, transmetteurs de maladies tropicales à des latitudes et altitudes de plus en plus élevées.
Paul Reiter, professeur d’entomologie médicale à l’Institut Pasteur, spécialisé dans l’épidémiologie et le contrôle de maladies transmises par les moustiques (paludisme, dengue, etc.), a signalé que ces affirmations n’avaient aucune base scientifique (Durkin M, 2007A67 55:02). Participant à un groupe de travail du GIEC, il s’est trouvé en total désaccord avec les conclusions du Second Assessment Report, chapitre 18 (Reiter P, 2005A228) :
Le texte très amateur de ce chapitre reflétait les connaissances limitées des 22 auteurs. L’accent était mis sur les « changements dans l’aire de répartition géographique (latitude et altitude) et l’incidence (intensité et saisonnalité) de nombreuses maladies à transmission vectorielle » tels qu’ils sont « prédits » par les modèles informatiques. Ces modèles ont fait l’objet d’une large couverture, bien qu’ils soient tous basés sur un modèle très simpliste développé à l’origine pour aider les campagnes de lutte contre le paludisme. Les auteurs ont reconnu que les modèles ne prenaient pas en compte « l’influence des circonstances démographiques, socio-économiques et techniques locales ».
Il précisait par ailleurs (Reiter P, 2005A228) :
[…] le paludisme était ce que nous appellerions aujourd’hui un « grave problème de santé publique » dans de nombreuses régions des îles britanniques, et il était endémique, parfois courant dans toute l’Europe jusqu’à la Baltique et au nord de la Russie. Il a commencé à disparaître de nombreuses régions d’Europe, du Canada et des États-Unis à la suite de multiples changements dans l’agriculture et le mode de vie qui ont affecté la reproduction du moustique et son contact avec l’homme, mais il a persisté dans les régions moins développées jusqu’au milieu du 20e siècle. En fait, l’épidémie la plus catastrophique jamais enregistrée dans le monde s’est produite en Union soviétique dans les années 1920, avec un pic d’incidence de 13 millions de cas par an et 600 000 décès. La transmission était élevée dans de nombreuses régions de Sibérie, et l’on a recensé 30 000 cas et 10 000 décès dus à une infection à falciparum (le parasite le plus mortel du paludisme) à Archangel, près du cercle arctique. Le paludisme a persisté dans de nombreuses régions d’Europe jusqu’à l’avènement du DDT. L’un des derniers pays impaludés d’Europe était la Hollande : l’OMS l’a finalement déclarée exempte de paludisme en 1970.
J’espère avoir réussi à vous convaincre que le paludisme n’est pas une maladie exclusivement tropicale, et qu’il n’est pas limité par les hivers froids ! De plus, bien que la température soit un facteur de transmission (le parasite ne peut se développer dans le moustique que si les températures sont supérieures à environ 15ºC), de nombreux autres facteurs — dont la plupart ne sont pas associés au temps ou au climat — jouent un rôle beaucoup plus important. L’interaction de ces facteurs est complexe et défie toute analyse simple. Comme l’a dit un éminent malariologue : « Tout ce qui concerne le paludisme est tellement modelé et modifié par les conditions locales qu’il devient un millier de maladies et de puzzles épidémiologiques différents. Comme les échecs, il se joue avec peu de pièces, mais est capable d’une variété infinie de situations ». […] Il en va de même pour toutes les maladies transmises par les moustiques.
Après sa démission du comité, Paul Reiter a constaté que son nom figurait sur la liste des contributeurs au rapport final, dont 15 contributions scientifiques avaient été délibérément supprimées. Il a eu dû brandir la menace d’une action en justice pour obtenir l’effacement de son nom (Durkin M, 2007A67 58:30).
⇪ Les effets, jamais les causes
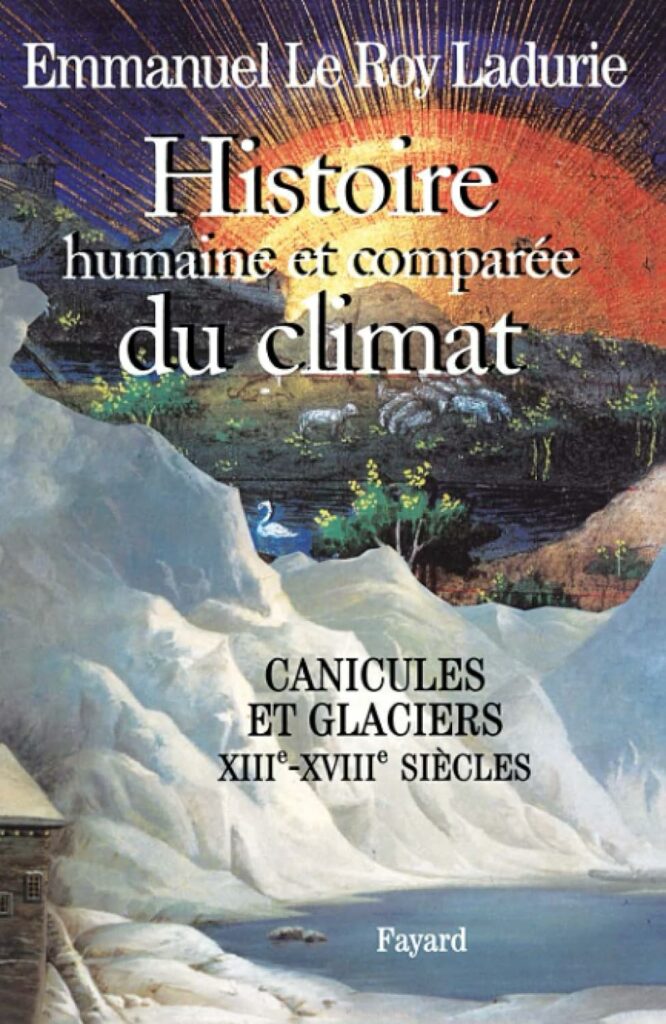
Le message catastrophique sur le climat — omniprésent sur les médias et dans les programmes politiques — s’est focalisé sur les effets du réchauffement climatique. La quantification de ce réchauffement et sa cause anthropique (gaz à effet de serre) sont tenues pour acquises, puisque prouvées dans les rapports du GIEC. Tout questionnement à ce sujet désigne « l’empêcheur de chauffer en rond » comme un climato-négationniste (complotiste).
Reçu par le président Joe Biden, Steven Koonin — sous-secrétaire aux sciences du département américain de l’Énergie dans le gouvernement de Barack Obama — s’est vu qualifier de porteur d’un « discours de droite »…
En France, le décès d’Emmanuel Le Roy Ladurie (22 novembre 2023) a été l’occasion de célébrer avec justesse un « précurseur de l’histoire du climat ». Mais aussi, dans la foulée, de citer hors-contexte une phrase qui le mettait au diapason des climato-alarmistes (Reporterre, 2023A229) :
Dans les dernières années de sa vie, il alertait sur les conséquences du changement climatique : « Le réchauffement va s’accompagner, en diverses régions de la planète, de guerres, de troubles sociaux éventuellement graves, voire révolutionnaires », affirmait-il au MondeA148.
Dans cet article du Monde datant de 12 ans plus tôt, Le Roy Ladurie tenait un discours plus circonstancié. Et surtout, la citation mise en exergue par Reporterre n’est pas représentative de ses travaux… S’exprimant « au nom de l’homme de la rue, dès lors qu’il dispose d’un minimum de culture écologique », il avait repris à son compte les conclusions du GIEC telles qu’analysées par « l’excellente journaliste qu’est Lise Barnéoud ». Il écrivait par ailleurs (Le Roy Ladurie, 2011A148) :
L’auteur du présent article [LRL] n’est pas un scientifique à part entière, simplement un historien du climat qui s’efforce depuis très longtemps de se tenir au courant du dossier présenté par les hommes de science. Ce dossier, tout bien réfléchi, lui paraît crédible. […]
Et d’abord une impression que je partage avec l’historien américain Geoffrey Parker : le réchauffement va s’accompagner, en diverses régions de la planète, de guerres, de troubles sociaux éventuellement graves, voire révolutionnaires.
C’est du reste la conclusion à laquelle était parvenu précisément le professeur Geoffrey Parker pour une tout autre période, celle du petit âge glaciaire, notamment le XVIIe siècle et plus précisément les années 1640. Geoffrey Parker (American Historical Review, 2008) s’était placé résolument à l’échelle mondiale, c’est ce qu’on appelle “big history” aux Etats-Unis. […]
L’accumulation du chaud au cours du XXIe siècle, voire du XXIIe, jouera-t-elle un rôle analogue à ce que fut l’accumulation du froid lors du siècle de Louis XIV et de tant d’autres monarques eurasiatiques en termes de catastrophes dorénavant plus fréquentes ?
Autrement dit, par un retournement du fait historique — la corrélation entre les périodes froides, comme le petit âge glaciaire, et des difficultés économiques entraînant de graves troubles sociaux — Le Roy Ladurie a suggéré que la cause inverse (un réchauffement) pourrait produire les mêmes effets… Toutefois, cette extrapolation était nourrie par une adhésion inconditionnelle, en toute modestie de cet historien, aux prédictions alarmistes des modèles mathématiques du GIEC (Le Roy Ladurie, 2011A148) :
[…] une hausse probable ou possible des températures de 1 à 3°C pour les années 2050 […] sur la base d’un prolongement des courbes thermiques actuelles et d’une appréciation des considérables volumes de gaz à effet de serre qui seront injectés dans notre atmosphère […]

Un autre exemple de focalisation sur les effets du changement climatique, sans remise en question de ses causes ni de sa quantification, est celui de l’archipel polynésien de Tuvalu. Un reportage « vu à la télé » (sur Arte) en octobre 2023 annonçait la disparition imminente de ces îles sous l’effet de la montée du niveau de l’océan causée par le réchauffement climatique, autrement dit l’activité humaine.
Ce dossier a été présenté avec plus de prudence sur Wikipedia (2023A314) :
Ce phénomène est lié au cumul de plusieurs facteurs. Ainsi, l’érosion côtière, aggravée par les activités humaines, affecte le niveau des eaux. Le facteur dominant est la hausse rapide du niveau de l’océan dans le Pacifique Ouest. Ce phénomène d’élévation du niveau de la mer, est aggravé localement par le phénomène ENSON16. En effet, le basculement de l’oscillation pacifique décennale en phase négative et la plus grande fréquence des phases négatives de l’ENSO conduisent à la dilatation du Pacifique Ouest et à la contraction du Pacifique Est. Pour Tuvalu en particulier, le rythme de la hausse relative approche les 2 millimètres ± 1 mm/an, hors l’effet d’érosion et de subsidience.
Toutes ces observations sont en accord avec ce qui a été exposé plus haut. Rappelons que la subsidienceN40 est un abaissement de la surface de la croûte terrestre, qui n’a donc rien à voir avec une montée des eaux, a fortiori sans lien avec le réchauffement climatique.
La suite sur Wikipedia (2023A314) :
Les Tuvaluans s’inquiètent de la possible submersion des îles. Un nombre croissant d’entre eux a quitté l’archipel. En 2002, le premier ministre d’alors, Koloa Talake, annonça son intention d’amener les États-Unis et l’Australie devant la Cour internationale de justice de La Haye du fait de leurs émissions disproportionnées de dioxyde de carbone. […]
Bien qu’attirer l’attention sur les effets du changement climatique ait permis d’apporter une certaine visibilité internationale aux problèmes des îles, d’autres facteurs doivent être pris en compte, dont l’explosion démographique sur une île aux ressources limitées, source de dégâts environnementaux. Depuis 1980, la population de Funafuti a plus que doublé, passant de 2000 à 4500, soit près de la moitié de la population des Tuvalu. Une autre cause majeure de l’engloutissement de l’île et de la salinisation de ses sources d’eau douce est l’installation d’un aéroport (construit par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale), qui a mis une part notable de l’île à quelques centimètres du niveau de la mer, causant des dégâts notables à la base corallienne de l’île. Toutefois, il paraît indéniable que le changement climatique pourrait accentuer ce phénomène.
La dernière phrase — malgré la modération du « paraît » et du « pourrait » — résume l’argumentaire des dirigeants qui ont obtenu de l’Australie l’autorisation « en réponse au réchauffement climatique […] à tout citoyen tuvaluan d’émigrer en Australie et d’y bénéficier pleinement de droits sociaux, avec un quota de 280 migrants par an ». Autrement dit, l’Australie, tenue pour responsable du réchauffement climatique en raison de ses activités minières productrices de CO2, devrait maintenant se racheter en accueillant les réfugiés climatiques de Tuvalu…
Ce n’est pas tout (Wikipedia, 2023A314) :
Le 15 novembre 2022, dans le cadre de la COP27 organisée en Égypte à Charm El-Cheikh, Simon Kofe [ministre des affaires étrangères aux Tuvalu] s’adresse à nouveau aux dirigeants de la planète, et à travers eux à l’ensemble de la population mondiale, pour leur enjoindre d’agir rapidement pour enrayer les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur son pays et l’ensemble de la planète. Son discours est enregistré sur un îlot de l’archipel et également diffusé sur son compte YouTube. Il y évoque la possibilité que son pays soit le premier état au monde à disparaître totalement dans un avenir proche et n’existe plus que dans le métaversN58. Parallèlement, le gouvernement de l’archipel a mis un site en ligne préfigurant ce que serait alors « Tuvalu, la première nation numérique » […]
Le projet de « numériser » un pays prochainement englouti par les eaux, suite à l’imprudence et à la corruption des hommes, peut être entendu comme le recyclage moderne de mythes véhiculés par des récits anciens comme La légende d’Ys !
Les effets, jamais les causes. Le CNRS s’est clairement positionné dans cette mouvance en attribuant trois médailles (de bronze, d’argent puis d’or) à une chercheuse en écologie fonctionnelle, Sandra Lavorel, pour des travaux qui portaient sur les effets du changement climatique sur les services liés aux écosystèmes. « Quatre scénarios couplés climatiques/socio-économiques à l’horizon 2030 ont été envisagés » (Lamarque P et al., 2014A145 p. 13755).
Aucune hypothèse n’était avancée sur les causes des changements climatiques. Malgré cela, la présentation médiatique de ces travaux (en octobre 2023) a principalement servi de prétexte à un rappel de l’urgence de diminuer la production de gaz à effet de serre.
Le problème soulevé ici n’est pas la qualité, ni la portée, de travaux justement récompensés — bravo à la lauréate ! — mais l’usage qu’en font les médias pour légitimer « scientifiquement » le discours sur la décarbonation.
⇪ Le « package écologiste »
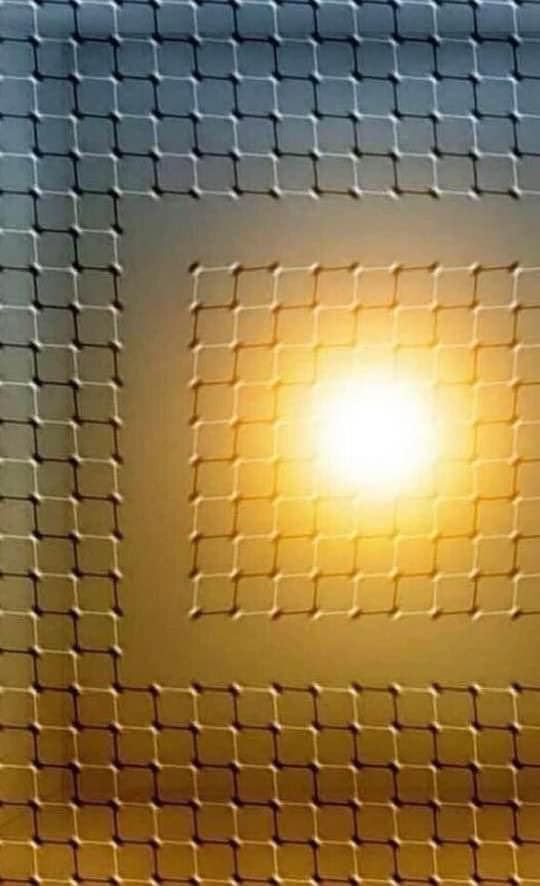
Dans son ouvrage Mythes et légendes écologistes, Benoît Rittaud écrit sous le titre « Tout est lié » (2023bA238 p. 119) :
Chaque domaine se doit aujourd’hui de s’accrocher à la crise climatique, la plus glorieuse de toutes, celle par qui n’arrivera rien de moins que la fin du monde. De la crise des migrants à la guerre en Syrie, tout se relie donc à un moment ou à un autre au « dérèglement climatique », qui constitue, dans la mythologie contemporaine, la crise-racine de laquelle partent toutes les autres. […]
Le « tout est lié » ne permet pas seulement de coller à bon compte l’étiquette de cartésien borné sur le front de quelqu’un qui doute de tel ou tel lien improbable. Dans sa version moderne de théorème éthique, il permet aussi de faire du mécréant un suppôt du Mal, selon une logique éprouvée : vous ne croyez pas que le réchauffement cause l’obésité des chevaux, c’est donc que vous êtes indifférent à la santé de ces pauvres bêtes. Remplacez l’obésité des chevaux par les inégalités sociales ou la précarité et vous obtenez un raisonnement tout aussi faux mais qui fera son effet, selon la même non-logique qui voit dans chaque adversaire de la peine de mort un partisan des assassins.
Judith Curry écrit (2021A50) :
Le changement climatique est ainsi devenu un grand récit dans lequel le changement climatique causé par l’homme est devenu une cause dominante des problèmes sociétaux. Tout ce qui va mal renforce la conviction qu’il n’y a qu’une seule chose à faire pour prévenir les problèmes sociétaux : arrêter de brûler des combustibles fossiles. Ce grand récit nous incite à penser que, si nous résolvons le problème du changement climatique d’origine humaine, alors ces autres problèmes seront également résolus. Cette croyance nous éloigne d’une enquête plus approfondie sur les véritables causes de ces problèmes. Le résultat final est un rétrécissement des points de vue et des options politiques que nous sommes prêts à envisager pour traiter des questions complexes telles que la santé publique, les catastrophes météorologiques et la sécurité nationale.
Le climato-alarmisme est devenu le fond de commerce d’organisations non-gouvernementales qui surfent sur la menace de catastrophes planétaires — autres qu’un conflit nucléaire — causées par les humains, la désignation de coupables (industrie, agriculture…) et celle de « victimes sympathiques ».

Dans son ouvrage très documenté, Andy May décrit par le menu l’évolution de Greenpeace (2020A173 p. 108–123) ainsi que les agissements de la Fondation Tomkat, de l’Union of Concerned Scientists (UCS), et pour finir (p. 123–147) les détails de la campagne ExxonKnew, calquée sur les procès contre l’industrie du tabac, accusant les scientifiques d’ExxonMobil d’avoir su depuis longtemps que l’usage des combustibles fossiles aurait un « impact dramatique sur le climat ». Andy May écrit (2020A173 p. 133–134, 141) :
Naomi Oreskes, qui a écrit Merchants of Doubt (Marchands de doute) en 2010A208, a ensuite rédigé des articles accusant les grandes compagnies pétrolières de dissimuler des informations « dangereuses » sur le changement climatique d’origine humaine (Supran G & N Oreskes, 2017A277). Elle a également publié un article affirmant que les projections climatiques récentes sous-estimaient les impacts dangereux du changement climatique (Brysse K et al., 2013A31). Tout cela avait pour but de jeter les bases académiques des poursuites judiciaires à venir. Leur projet d’utiliser des articles évalués par des pairs comme matériau pour de futures poursuites judiciaires montre à quel point le processus universitaire d’évaluation par les pairs est devenu corrompu. […]
Quant à l’idée qu’ExxonMobil cachait des preuves que le changement climatique provoqué par l’homme conduisait à une catastrophe mondiale, un examen des documents montre que l’entreprise a publié toutes ses conclusions sur le changement climatique dans des revues scientifiques publiques. […]
Les chercheurs en climatologie d’ExxonMobil ont participé aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports d’évaluation du GIEC, apportant des contributions majeures à la description du cycle du carbone et à la modélisation du climat. Ils ont calculé l’impact potentiel du CO2 d’origine humaine dans plusieurs publications. Ils ont étudié des méthodes de séquestration du CO2 et d’adaptation au changement climatique. Ils ont également étudié plusieurs biocarburants potentiels.
Des copies des Exxon Climate Papers peuvent être téléchargées sur le site d’Andy May.
Lors d’un débat sur la chaîne Arte (28 minutes le 27/11/2023), les invités ont dressé la liste de mesures environnementales combattues par les parlementaires européens d’extrême droite : interdiction du glyphosate et des pesticides, limitation des déchets plastiques, lutte contre la pollution de l’air, etc.
La liste était pertinente — et l’indignation légitime, vue l’opposition viscérale de ces politiciens à toute proposition émanant des « écologistes ». Sauf que ces votes défavorables étaient présentés comme autant de renoncements au Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) dont l’objectif est la neutralité carbone en 2050 (WikipédiaN59). Aucun intervenant n’a fait mention d’opinions contradictoires sur les causes du changement climatique — que le Green Deal est présumé combattre. L’intervenant affiché favorable à l’extrême droite a même pris soin de rappeler que la « lutte pour le climat » était incontournable. Personne n’a relevé la contradiction d’une telle position, ni l’absence de lien entre les mesures rejetées et le pacte vert européen.
Le « tout est lié » implicite dans ce débat permet de comprendre que le climato-réalisme, aux yeux des médias « dominants », est quasiment toujours amalgamé avec l’extrême droite — ce qui inclut le complotisme, les antivax, le trumpisme, etc. Alors que, nous venons de le voir, un militant déclaré « d’extrême droite » peut à la fois combattre « les écologistes » et tenir un discours climato-alarmiste.
La croyance « le CO2 anthropique est responsable du réchauffement » est une position quasi-religieuse moderne, que personne n’ose remettre en question, de la même manière que dans l’Europe d’il y a quelques siècles l’existence de Dieu était un fait établi. Les discussions pouvaient porter sur le sexe des anges ou d’autres questions métaphysiques, mais jamais émettre le moindre doute sur les dogmes fondateurs. Les déviants risquaient trop le bûcher… Les « climatosceptiques » d’aujourd’hui sont certes moins menacés, mais leur parcours professionnel est souvent compromis, comme nous allons le voir.
⇪ L’hydrogène

Une nouvelle source d’énergie « décarbonée », objet de lourds investissements en Europe, serait l’hydrogène natif (« blanc ») extrait de la croûte terrestre, ou « vert » extrait de l’eau par électrolyse à partir d’électricité « propre ». L’idée de produire de l’hydrogène à l’aide d’éoliennes remonte à 1923, et elle a donné lieu à de nombreuses recherches depuis 1972, avant la première crise pétrolière.
L’hydrogène « vert » est aujourd’hui promu comme une solution idéale de stockage de l’énergie des sources intermittentes (éoliennes ou solaires). Cet hydrogène serait ensuite brûlé dans des moteurs, ou encore utilisé dans des piles à combustible fabriquant de l’électricité — une opération qui affiche un rendement inférieur à 30 %.
Dans son ouvrage L’Utopie Hydrogène (2020A86), Samuel Furfari nous interroge :
Comment espérer qu’un système chimique qui transforme en hydrogène, avec des pertes, un excès d’électricité pour ensuite le retransformer en électricité, avec des pertes additionnelles, puisse être rentable ?
Guillaume de Rouville ajoute (2024A57 p. 112) :
Produire de l’hydrogène à partir d’énergie (sous forme d’électricité) pour produire à nouveau de l’énergie (à nouveau sous forme d’électricité), telle est l’équation économiquement absurde que nous propose le pacte vert de l’Union européenne. Mais qu’importe la rentabilité lorsqu’il s’agit de sauver l’univers.
⇪ La géo-ingénierie
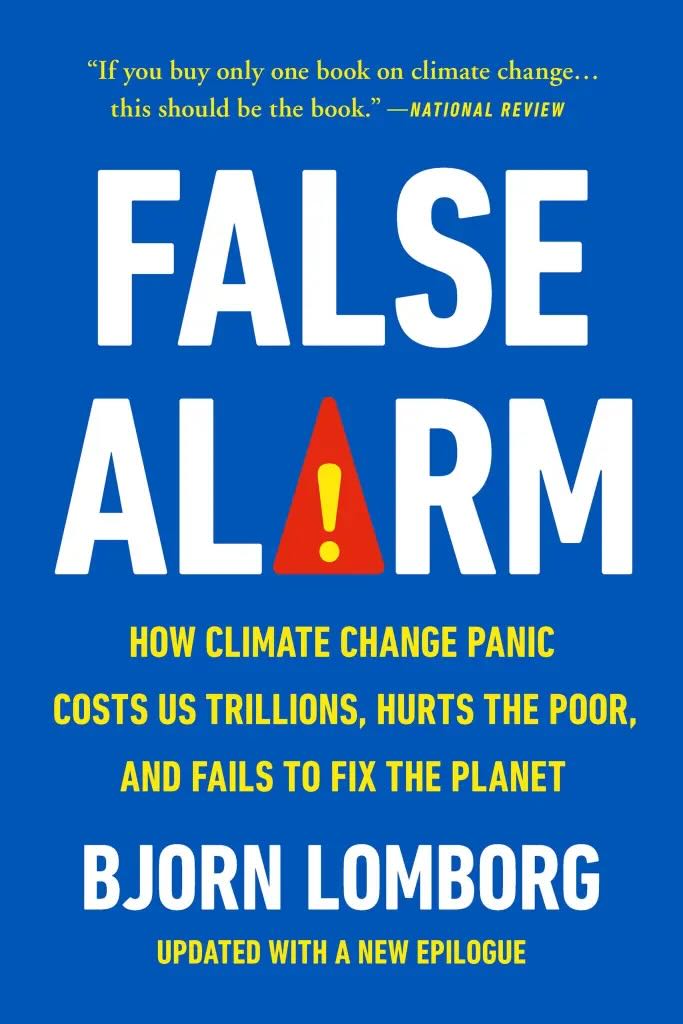
Dans son ouvrage False Alarm (2024A157 p. 195–201), Bjørn Lomborg aborde le sujet vivement controversé de la géo-ingénierie : les techniques qui visent à modifier directement le climat de la Terre. Compte tenu des incertitudes sur le réchauffement climatique qu’il a précédemment exposées, il suggère (p. 195) que « ce n’est pas une politique qui devrait être implémentée immédiatement, mais une solution partielle au changement climatique qui mérite d’être étudiée. »
L’éruption du volcan du Mont Pinatubo, en 1991, a émis dans l’atmosphère assez de dioxyde de soufre pour diminuer de 2.5 % la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface terrestre. Il en a résulté une diminution de la température du globe d’environ un demi degré Celsius pendant les 18 mois qui ont suivi. Une des techniques envisagées consisterait donc à diffuser dans la haute atmosphère de fines particules qui feraient obstacle à la lumière solaire (Koonin SE, 2021A135 p. 240–241). Toutefois, les scientifiques craignent que de telles interventions aient des effets dramatiques totalement imprévisibles, comme par exemple l’augmentation de pluies dans des zones déjà trop humides, et inversement la désertification accrue de zones arides.
D’autres solutions moins hasardeuses, et surtout réversibles, ont été proposées (Lomborg B, 2024A157 p. 196) :
L’une des approches les moins coûteuses et les plus efficaces est appelée « éclaircissement des nuages marins » [marine cloud brightening]. Les vagues qui se brisent sur l’océan créent des particules de sel marin en suspension dans l’air, et les nuages au-dessus des océans sont principalement constitués de minuscules gouttelettes d’eau qui se sont condensées autour de ces particules. L’idée est que si vous augmentez le nombre de particules marines dans l’air au-dessus des océans, les nuages qui en résulteront contiendront davantage de minuscules gouttelettes d’eau. Moins de gouttelettes signifie des nuages plus sombres (comme nous le voyons à chaque fois qu’il est sur le point de pleuvoir), tandis que de nombreuses petites gouttelettes rendent les nuages plus blancs. Si nous parvenons à rendre les nuages océaniques plus blancs, ils réfléchiront davantage d’énergie solaire vers l’espace, ce qui refroidira la planète [National Research Council, 2015A200].
Lomborg se prononce pour la recherche (et non la mise en œuvre immédiate) sur la géo-ingénierie (2024A157 p. 197, 198) :
Le premier argument en faveur de la recherche sur la géo-ingénierie est qu’il s’agit de la seule approche connue qui nous permette de réduire considérablement la température mondiale à faible coût. Les recherches menées dans le cadre du Consensus de Copenhague montrent qu’il suffirait de dépenser 9 milliards de dollars pour construire 1900 bateaux pulvérisant de l’eau de mer pour empêcher la totalité de l’augmentation de température prévue au cours de ce siècle. Il s’agit là d’une possibilité alléchante si l’on considère les 60 000 milliards de dollars de dommages qui résulteraient d’un réchauffement climatique non maîtrisé au cours du XXIe siècle. […]
Toute politique standard de réduction des combustibles fossiles mettra des décennies à être mise en œuvre, et un demi-siècle à avoir un impact notable sur le climat. Au contraire, à l’instar du mont Pinatubo, la géo-ingénierie peut littéralement réduire les températures en l’espace de quelques semaines.
Dans la suite de son chapitre Geoengineering : a backup plan (Géo-ingénierie : un plan de secours), Bjørn Lomborg décrit les controverses qui opposent partisans et adversaires de la géo-ingénierie. Entre autres, certains craignent que la mise en place d’une telle approche coupe court à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre, qu’ils défendent comme la seule solution acceptable.
⇪ Disqualification du scepticisme et loi du silence
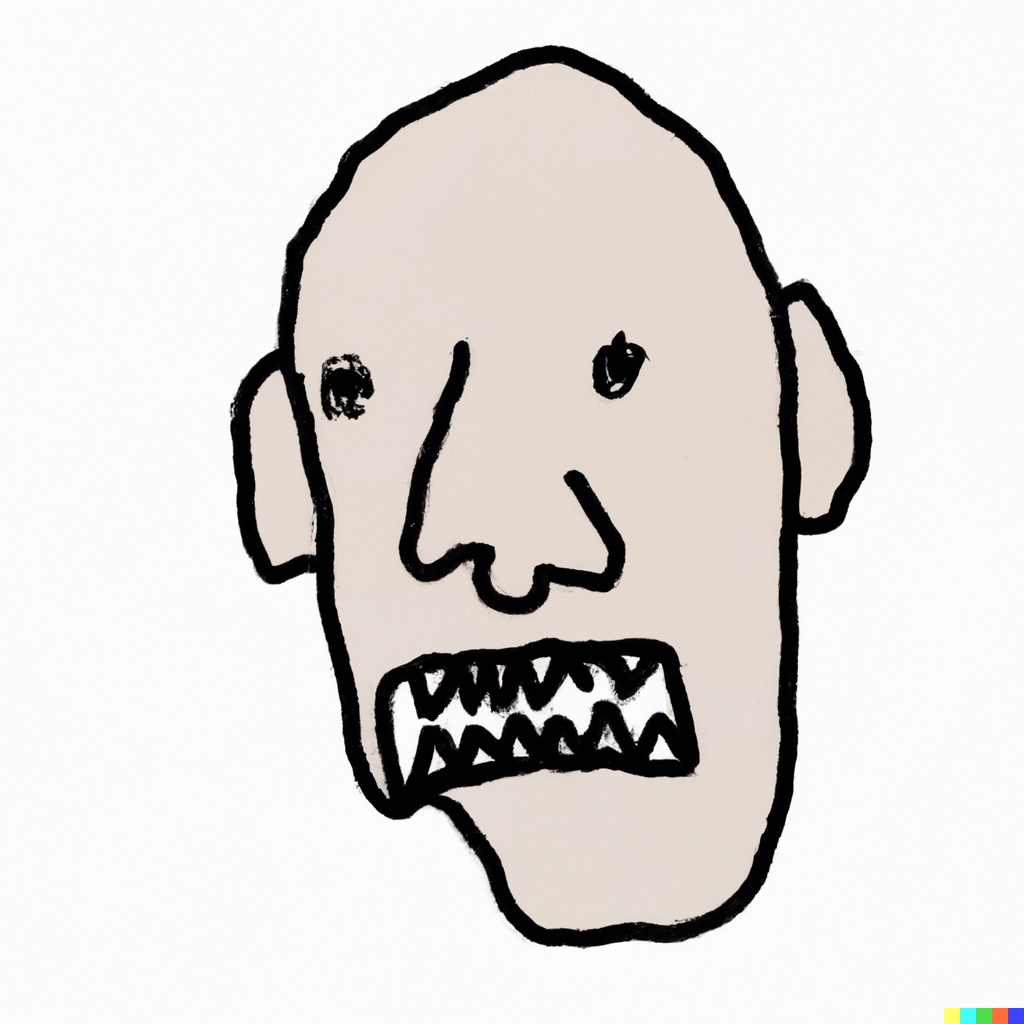
Lors d’une conférence à l’American Geophysical Union à San Francisco, en 2008, Al Gore a terminé son discours en disant : « Vous avez le devoir de réduire au silence ceux qui s’opposent aux avis du GIEC ! » (Allègre C, 2010A9 p. 140). Effectivement, le GIEC et les groupes « climatiquement corrects » ont progressivement investi les journaux scientifiques et « cadenassé » le système, comme l’a révélé le piratage informatique de courriels de la Climatic Research Unit au Royaume-Uni (scandale du ClimategateN36).
À noter que mon lien « Climategate » renvoie vers un site conservateur nord-américain pour partager certains détails minorés ou recyclés par les sites francophones sous l’emballage « théorie du complot »… J’invite donc à une lecture critique attentive des faits signalés. Lire notamment Climategate : A Battlefield Perspective (McIntyre S, 2010A177).
La revue Climate Research a été boycottée pour avoir publié, en 2003, un article critiquant le graphique en crosse de hockeyN18 de Michael E Mann. Le boycott a duré jusqu’à ce que l’éditeur « coupable » [Hans von Storch] ait démissionné. Mann et Jones sont à l’origine de cette action concertée (Allègre C, 2010A9 p. 142). Lire plus de détails (avec un œil critique) sur Wikipedia.
Patrice Poyet a écrit (2022A221 p. 512) :
Jusqu’en 2007, une certaine forme d’opposition pouvait encore exister et se faire entendre. À l’époque, la Conférence des Nations Unies sur le Climat, qui s’est tenue à Bali, a rencontré une forte opposition de la part d’une équipe de plus de 100 éminents scientifiques internationaux [à présent 1000, voir Climate Depot, 2010A186] qui ont averti les Nations Unies que toute tentative de contrôle du climat de la Terre était vaine en fin de compte. « Les tentatives visant à empêcher le changement climatique mondial de se produire sont en réalité futiles et constituent une réaffectation inadéquate de ressources qui seraient mieux utilisées pour résoudre les problèmes réels et urgents de l’humanité », peut-on lire dans la lettre signée par les scientifiques. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, n’a pas répondu à ces scientifiques et n’a rencontré aucun d’entre eux, mais il a affirmé que « le réchauffement climatique constitue une menace aussi grande pour le monde que les guerres modernes », et il s’est engagé à faire de la réduction des gaz à effet de serre (GES) l’une des grandes priorités de son mandat. Le surnom de Ban était jusa (주사), qui signifie « l’employé administratif », probablement mérité car, sans formation scientifique ni désir d’écouter un autre point de vue, il a pris parti et s’est engagé à faire avancer l’agenda du GIEC.
L’époque où une certaine opposition pouvait être exprimée est malheureusement révolue (Morano, 2010A186) et il est de plus en plus difficile pour les personnes dissidentes d’exister car elles ont été discréditées, menacées, licenciées ou réduites au silence. En tout état de cause, il ne faut pas s’attendre à ce que l’ONU accepte une responsabilité future dans les résultats désastreux des politiques de lutte contre le changement climatique ; par exemple, lorsqu’un procès a remis en cause l’immunité juridique de l’ONU au nom des victimes haïtiennes du choléra (les gardiens de la paix de l’ONU venus du Népal seraient à l’origine de l’épidémie de choléra en Haïti entre 2010 et 2013), Ban Ki-Moon a déclaré que l’immunité juridique de l’ONU devant les tribunaux nationaux devait être préservée.
Michel Vieillefosse écrit (2022A304 p. 232) :
L’attitude du GIEC induit en erreur les décisions énergétiques prises par les pays. À des fins d’intercomparaison des intervenants, en entrée des simulations informatiques, il propose d’utiliser des profils non représentatifs d’une planète profondément modifiée par l’homme. Pour obtenir des crédits, les laboratoires scientifiques sont obligés de satisfaire les exigences du GIEC. Un paradoxe : ils n’observent plus les changements graves de notre globe. L’adéquation aux mesures [de] terrain, en particulier au sol, doit être privilégiée à la confrontation des modèles mathématiques entre eux.
Dans son article Climate of Fear (Climat de peur), Richard Lindzen expliquait pourquoi « personne ne bouge » face aux agissements de ceux qui réservent les moyens de recherche aux tenants des thèses du GIEC (2006A152) :
Les déclarations scientifiques ambiguës sur le climat sont amplifiées par ceux qui ont tout intérêt à alarmer, ce qui augmente les enjeux politiques pour les décideurs politiques qui financent davantage de recherches scientifiques afin d’alimenter davantage d’alarmes pour augmenter les enjeux politiques. Après tout, qui investit dans la science — qu’il s’agisse du sida, de l’espace ou du climat — lorsqu’il n’y a rien de vraiment alarmant ?
En 2001, Richard Lindzen a été désigné par le gouvernement américain pour participer au GIEC, chargé de coordonner le rapport scientifique sur les processus physiques. Claude Allègre disait de lui (2010A9 p. 204–205) :
Je vous ai dit qu’en 1999 Michael Mann avait publié son historique courbe de température de la planète, la fameuse « crosse de hockeyN18 ». Or, dans une autre section du GIEC, on prend cette courbe à la lettre, on la tient pour une évidence, et, bien sûr, on tient Lindzen à l’écart de cette prise de position capitale. Du coup, le rapport de 2001 va être, paradoxalement, le rapport le plus alarmiste jamais publié. S’appuyant sur une courbe de Mann littéralement sacralisée, le GIEC annonce — froidement, si j’ose dire — qu’en l’an 2100 les températures du globe pourraient s’élever de +6°C et le niveau de la mer monter de deux mètres. Et le GIEC d’égrener la liste des catastrophes afférentes… […] Lindzen, lui, révèle qu’il a été tenu à l’écart de la rédaction et que le rapport de synthèse a été rédigé par quatorze personnes péremptoires. […]
Bush refuse de signer le protocole de Kyoto, et sa secrétaire d’État, Condolezza Rice, fait une sèche déclaration : « Kyoto est mort. » Conséquence : les opposants à Bush, de plus en plus nombreux, vont identifier les opposants à l’alarmisme climatique ambiant à des pro-Bush. La science est désormais totalement liée à la politique. Ceux qui sont sceptiques à la lecture du rapport du GIEC sont, dit-on, des réactionnaires, des suppôts de Bush, liés sans doute au lobby du pétrole. Bien des scientifiques de talent qui sont réservés sur les positions du GIEC se taisent, car ils sont démocrates, ils détestent Bush et ne veulent pas apporter de l’eau à son moulin. Le GIEC, lui, est présenté comme le symbole d’un humanisme responsable. Or le pauvre Lindzen a le malheur d’être républicain. Al Gore a donc beau jeu de rassembler autour de lui tous les démocrates.
Après Kyoto, au Royaume-Uni, le travailliste Tony Blair, poussé par son conseiller scientifique David Anthony King, ami de John Houghton, est devenu la « locomotive du clan des alarmistes ». Le Hadley Centre est promu au rôle de collecteur de données sur la température. Toutefois, David King, qui avait déclaré dans la revue Science que « le réchauffement de la planète est le problème le plus grave auquel nous sommes aujourd’hui confrontés, plus grave encore que la menace terroriste » (2004A129), puis que la température en Europe pourrait baisser de 10°C du fait de l’arrêt du Gulf Stream, a tenté sans succès de convertir les scientifiques russes à cette vision apocalyptique (Allègre C, 2010A9 p. 203, 206).
En France, les vagues d’opposition au « climatoscepticisme » de chercheurs de sciences dures émettant des hypothèses explicatives du changement climatique, autres que l’influence directe et exclusive de l’activité humaine, ont été médiatisées dans la deuxième décennie du 21e siècle. Faute de pouvoir débattre sur le contenu de leurs publications, des fact-checkers (pour beaucoup scientifiquement incultes) accusent les géophysiciens, géochimistes, etc., de s’exprimer « hors de leur domaine de compétence ». Les réseaux sociaux, quant à eux, diffusent des exposés « à vocation pédagogique », sur des chaînes vidéo, qui intensifient cette campagne de dénigrement. Dans une analyse qui reste d’actualité, Claude Allègre déplorait (2010A9 p. 252) :
Il y a eu des dérapages, mélange entre politique et science, mélange entre science et médias. Quelques journalistes se sont pris pour des scientifiques. Quelques scientifiques leur ont laissé croire qu’ils l’étaient s’ils leur emboîtaient le pas et les mettaient en vedette.
En 2009, Vincent Courtillot, membre de l’Académie des sciences et directeur de l’Institut de physique du globe de Paris, publiait son Nouveau voyage au centre de la Terre (Courtillot V, 2009A48). Il opposait une démarche critique au « consensus » postulé par le GIEC (page 76) :
À ce stade, je ne suis pas sûr que nous puissions nous permettre d’affirmer qu’il y a un réchauffement global d’origine clairement anthropique dans les dernières décennies, au regard de ce que nous avons appris (tant bien que mal) au sujet des climats des deux derniers millénaires par exemple.
Le chapitre 3, intitulé Quelle est la température moyenne de la surface du globe ? (Courtillot V, 2009A48 p. 55–83) décrit les observations de son équipe qui mettent en doute les chiffres « officiels », compilés par deux groupes de travail affichant de faibles incertitudes, ce qui suscitait un doute sur la qualité de leur traitement. Comment le vérifier ? Courtillot n’a pas bénéficié d’un accès aux données brutes des stations météorologiques car, lui a répliqué Philip Douglas Jones (de la Climatic Research Unit en Grande-Bretagne) : « Pour en obtenir beaucoup, le centre a signé des accords avec les stations disant qu’il ne transmettrait pas les données brutes à des tiers. » (Courtillot V, 2009A48 p. 60)
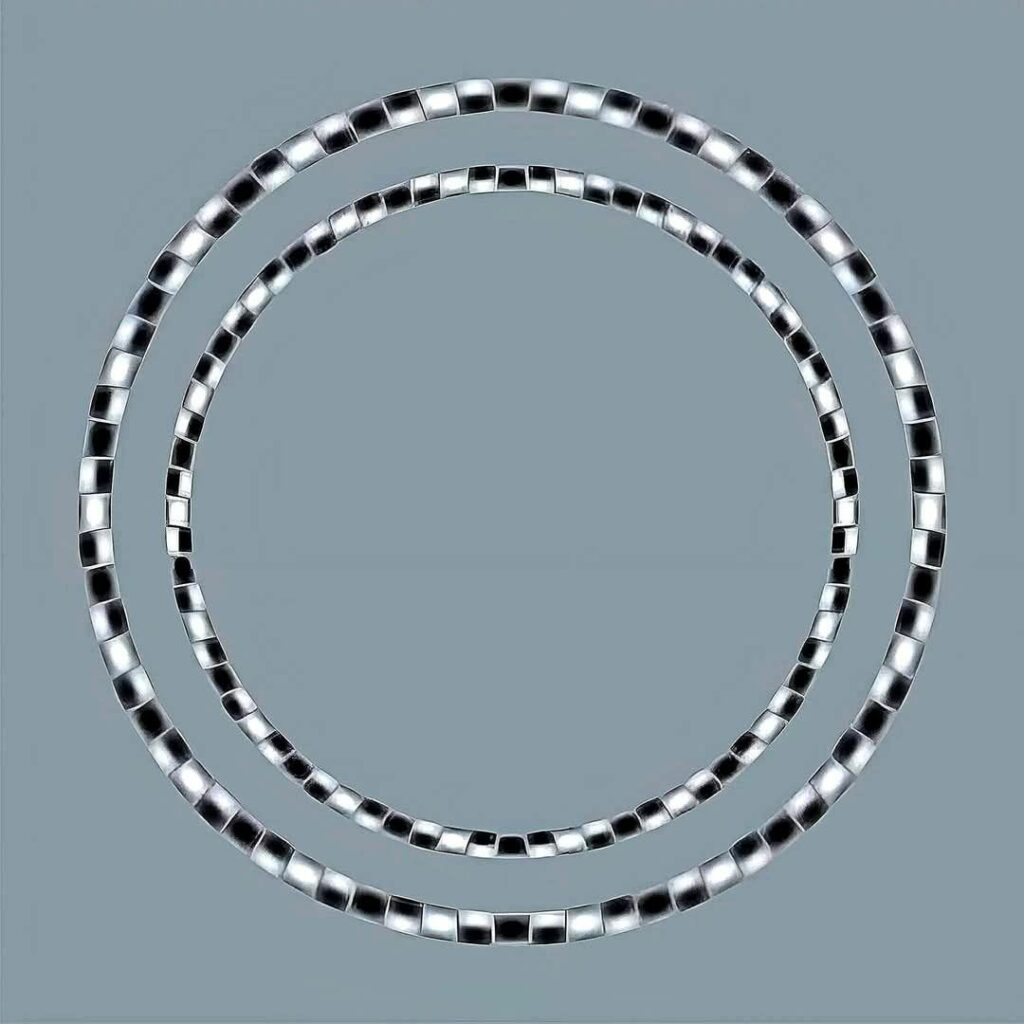
Le motif d’une telle dissimulation laisse rêveur ! Les données ont-elles au moins été archivées ? Certains en doutent : […] aujourd’hui [en 2010], on apprend qu’on a détruit des données sur le climat des vingt dernières années pour ne pas avoir à les communiquer aux chercheurs concurrents ! […] Une commission d’enquête a été constituée en Grande-Bretagne et [Phil] Jones a été obligé de démissionner de son poste (Allègre C, 2010A9 p. 143).
Les hypothèses de l’équipe de Vincent Courtillot et Jean-Louis Le Mouël (Ferry L ed., 2011A79 p. 79–87), ainsi que de nombreux autres chercheurs dans la communauté scientifique mondiale, introduisaient dans le modèle du climat les variations d’activité du soleil et la réponse du système atmosphérique à ces variations (Durkin M, 2007A67 26:26). Elles ont été tournées en ridicule — et le sont encore, aujourd’hui, par des béotien·ne·s intronisé·e·s fact checkers à l’AFP (Jacob M & CL Nass, 2022A121) !
Le débat théorique est complexe, le plus pratique étant de lire le chapitre 3 du livre de Vincent Courtillot (2009A48) ou de visionner les explications de Martin Durkin (2024A68 32:00) sur les travaux de Henrik Svensmark et collègues (2012A279 ; 2021A280).
L’échange de points de vue sur les causes du changement climatique — étendu à d’autres questions d’écologie — a fait l’objet d’un ouvrage, édité par Luc Ferry, où apparaissent des personnages connus de la sphère médiatico-politique française : Claude Allègre, Patrick Artus, Jean-Louis Borloo, Yves Cochet, Vincent Courtillot, Jean Jouzel, Jacques Le Cacheux (Ferry L ed., 2011A79). Vincent Courtillot y a rédigé un chapitre intitulé « Le rôle du Soleil a été sous-estimé » (2011A79 p. 57–110) suivi de questions et réponses.
Il serait inconvenant de ne pas évoquer la mémoire d’un des pionniers du mouvement « climato-réaliste » en France : le physicien Jacques Duran (1942–2018) dont le site Pensée Unique est préservé en archive. Directeur de Recherche de première classe du CNRS jusqu’à sa retraite en 2004, il a été Directeur des Études de l’École Supérieure de Physique et Chimie de Paris (1996–2003) auprès du nobélisé Pierre-Gilles de Gennes, et Vice-Président chargé de la recherche de l’Université Pierre et Marie Curie (1986–1992). Pour justifier ses prises de parole sous le couvert de l’anonymat, il écrivait (Duran J, 2010A65) :
Lorsque j’ai entrepris la rédaction de ce site en 2005–2006, je venais de quitter la Direction de l’ESPCI, en même temps que Pierre-Gilles de Gennes, et je ne souhaitais pas impliquer de quelque manière que ce soit, ni cette honorable institution à laquelle je reste très attaché, ni mes anciens collègues, dans une démarche qui m’était, à l’époque, strictement personnelle. En ce temps-là, émettre le moindre doute sur le caractère anthropique du réchauffement climatique, évoquer le rôle du soleil, des oscillations océaniques, etc., vous faisait immédiatement vouer aux gémonies, et je me sentais bien seul avec Charles Muller du site Climat-Sceptique.
Et plus récemment ?
Benoît Rittaud décrit la campagne de dénigrement qui frappe les scientifiques osant porter un regard critique sur les affirmations du GIEC (2022A236) :
En France, Bruno Latour est efficacement parvenu à étouffer toute pensée véritablement réflexive sur le climat, au profit d’un bréviaire militant qui ne recule pas devant l’ignominie : quelques jours à peine après les attentats de novembre 2015, Latour prenait sa plus belle plume pour écrire que l’indignité des climato-sceptiques était équivalente à celle des terroristes du Bataclan.
Le cas de Latour est révélateur, car ce sociologue des sciences avait au départ tout l’outillage intellectuel pour étudier intelligemment la mécanique à l’œuvre derrière les proclamations de « consensus scientifique ». Il fut un analyste impitoyable des récits un peu trop triomphalistes sur la marche irrésistible et désintéressée de la science vers le progrès. Jadis utile poil à gratter pour faire descendre les scientifiques de leur piédestal, Latour, et tant d’autres avec lui, a hélas choisi la facilité. Son hémiplégie intellectuelle lui fait désormais réserver ses flèches aux épouvantails commodes que sont « la droite américaine » ou les « lobbys du fossile ».
La répression des réfractaires au discours officiel affecte en premier leurs carrières. On peut citer le cas de la zoologue Susan Crockford, exclue de Victoria University pour avoir affirmé que la population d’ours dans l’Arctique ne diminue pas malgré le changement climatique (Richardson V, 2019A231). Une liste de ses publications à ce sujet (ignorées sur sa fiche Wikipedia) peut être consultée sur cette page.
François Gervais écrit (2022A94 p. 39) :
Certains scientifiques paient un lourd tribut, châtiés qu’ils sont de ne pas adhérer à la pensée unique. Les tous derniers résultats sur le blanchiment de la barrière de corail, par exemple, montrent que la situation de 2016 était vraisemblablement liée au phénomène El Niño d’amplitude majeure cette année-là [lien]. La barrière de corail a depuis complètement récupéré [lien]. Peter Ridd [lien], spécialiste de la barrière australienne qui plaidait pour le phénomène naturel, a été abusivement licencié de son Université, et a été contraint de se lancer dans un recours en justice. Nombre d’autres universitaires affichant des positions sceptiques ont été licenciés ou réduits au silence.
D’autres exemples d’atteintes à la liberté académique sont cités dans les pages suivantes (Gervais F, 2022A94 p. 39–52) :
Les climatosceptiques sont qualifiés de deniers en anglais. Dénier suppose une vérité établie. Mais justement, le Tableau 1.1 [pages 45–49] recense pas moins de 111 articles qui, dans le contexte, ont eu le mérite d’être passés sous les fourches caudines de la revue par les pairs pour conclure à une sensibilité climatiqueN31 égale ou inférieure à 1°C. La fourchette dans le dernier rapport AR6 (2021N3) du GIEC a été resserrée à 1.3–2.1°C, valeurs supérieures à 1°C. Les sensibilités climatiques à l’équilibre, équilibre qui serait peut-être atteint d’ici deux ou trois siècles, sont encore plus élevées.
On reste tellement loin d’un consensus que le mot perd tout son sens. Il ne saurait donc y avoir déni, encore moins négationnisme selon le qualificatif d’une rare impudence jeté à la face des sceptiques. L’Holocauste est un fait historique. Les projections de température d’ici la fin du siècle se contredisent. Comment pourrait-on « nier » ou « dénier » ce qui reste trop fortement contradictoire, et surtout ce qui n’est pas encore arrivé ?
L’exemple suivant montre le peu de soin apporté par certains experts des groupes de travail du GIEC à l’examen scientifique des données à leur disposition. Il s’agit, ni plus ni moins, de fraude scientifique : la mise à l’écart de publications qui ne contribuent pas à renforcer le discours alarmiste du GIEC (Gervais F, 2022A94 p. 50–51) :
Les 111 études du Tableau 1.1 [pages 45–49, qui concluent à une sensibilité climatiqueN31 égale ou inférieure à 1°C] sont à comparer à celles listées par Knutti et al. (2017A130) où 47 sensibilités climatiques TCR [réponse climatique transitoire], ou intervalles de TCR, sont citées. Parmi celles-ci, une seule conclut à 1°C et une seule autre à moins de 1°C (Ollila 2014A207). 78 ECS (Equilibrium climate sensitivityN28) ou intervalles d’ECS sont également passés en revue. Seulement 7 études rapportent 1°C ou moins […].
Pourquoi un tel tri sélectif si différent du Tableau 1.1 ? Knutti est auteur principal du rapport AR5 du GIEC (2013), de son Résumé pour décideurs et du résumé technique. Il est aussi Coordinating lead author du chapitre 12. Son nom apparaît pas moins de 201 fois dans le rapport AR5, y compris via 75 autocitations. Ainsi est-on autorisé à se poser la question de la politisation des rapports, depuis l’AR4, au vu du tri sélectif opéré par le GIEC, de l’autocitation très exagérée, et de l’exclusion du vaste corpus de travaux revus par les pairs, listés dans le Tableau 1.1.
Citant les travaux de Nicola Scafetta (voir ci-dessus), François Gervais écrit à ce sujet (2022A94 p. 54) :
Loin de l’affirmation d’une science établie, les incertitudes des modèles de climat apparaissent grandissantes, atteignant 3.8°C d’écart pour les modèles CMIP6 (Scafetta 2021cA249) comparé à 2.7°C pour les modèles CMIP5. Prendre la moyenne de valeurs fausses, sauf peut-être une, en écartant d’autorité celles inférieures à 1°C du Tableau 1.1, est hautement contestable.
Selon Pascal Blamet (2021A23) :
La simulation numérique est […] une discipline scientifique en soi : le domaine confidentiel, hermétique (et inexistant sur le plan médiatique) des numériciens, infime minorité de chercheurs discrets, et hyper spécialisés, dont l’objectif est d’abord que leur modèle aboutisse à des résultats stables numériquement et plausibles physiquement.
Quant à la « communauté scientifique climatique », elle relève pour l’essentiel d’une juxtaposition de disciplines distinctes, souvent naturalistes, et attachées à des objets spécifiques (glaciologie, océanographie, météorologie, thermodynamique, astronomie, hydrologie, etc.).
Il est frappant de noter que ces scientifiques observent, mesurent (ce qui n’est déjà pas simple) mais, faute de capacité d’interprétation globale, se retranchent derrière le préambule rituel du GIEC de la « faute au CO2 » et la nécessité d’en « sauver la planète ».
C’est tout simplement oublier que la recherche ne relève pas des bonnes intentions, mais d’une démarche intellectuelle où la liberté, la controverse, et surtout la raison critique (exact inverse du complotisme) sont bien sûr primordiales.
En climatologie, sans que cela heurte qui que ce soit, cette dernière a manifestement disparu de la sphère publique, comme si la thermodynamique atmosphérique avait la simplicité et la reproductibilité de la bille qui tombe sous l’effet de la pesanteur !
Ce qui explique sans doute que seuls des professeurs émérites et des scientifiques à la retraite se considèrent en situation de pouvoir émettre des avis critiques : ils sont désormais quasiment les seuls à avoir la liberté de le faire, avec courage d’ailleurs, compte tenu de l’ostracisme dont ils font l’objet, malgré leur expérience.
La répression contre les « climato-réalistes » s’exerce aussi par le biais d’interventions dans les médias généralistes qui peuvent contraindre les éditeurs de revues scientifiques à rétracter un article jugé en désaccord avec le mantra de « l’urgence climatique » (Thomas T, 2023aA283 ; traduction 2023bA284).
Des personnalités médiatisées en France, comme l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, en sont à accuser d’imposture les organisateurs de débats sur ce sujet (Debey A, 2024A58). En 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a sanctionné la chaîne Cnews à une amende de 20 000 euros pour climatoscepticisme. Des militants écologistes applaudissent cette entrave à la liberté d’expression. Eva Morel, co-fondatrice de QuotaClimat, déclare (Mullineaux J, 2024A190) :
L’autorité de régulation reconnaît ainsi le réchauffement climatique comme un fait scientifique, et non pas une opinion.
Une fierté de QuotaClimat (lire son rapport en 2024) est la « détection automatisée de la désinformation climatique dans les médias »… Lire à ce sujet l’article de Jean-Louis Legrand (2025A150).
Lors des réunions sur l’impact du développement durable du Forum économique mondial (WEF) (20 septembre 2022) s’est tenue une table ronde sur la lutte contre la désinformation, au cours de laquelle des participants de l’ONU, de CNN et de Brown University ont discuté de la meilleure façon de contrôler les récits [narratives]. Melissa Fleming, secrétaire générale adjointe à la communication mondiale des Nations unies, a signalé que l’ONU s’était associée à plusieurs grandes entreprises technologiques, dont TikTok et Google, pour contrôler les récits sur le COVID et le climat, en affirmant : « Nous devenons bien plus proactifs. Nous sommes propriétaires de la science, et nous pensons que le monde devrait le savoir. […] Nous avons formé à TikTok des scientifiques et des médecins du monde entier, et TikTok travaillait avec nous. » (Hinchliffe T, 2022A113)
Claude Allègre réfutait ainsi l’argument ad numerum qui lui était opposé pour disqualifier tout désaccord (2010A9 p. 192) :
Lorsqu’on me dit : « Vous vous opposez à l’opinion de 2500 scientifiques », c’est complètement faux. 2500, c’est seulement le nombre de scientifiques et de non-scientifiques utilisés pour relire les articles ou rédiger des bouts d’articles annexes. Quelle serait l’influence sur les vers de terre si le climat augmentait de 10°C ? Et le biologiste spécialiste des vers de terre répond. Si le niveau de la mer montait de deux mètres, quelle serait la conséquence ? Un géographe et un économiste répondent dans un article, etc. Tous ces rédacteurs n’approuvent pas nécessairement les conclusions des documents restreints auxquels ils ne sont d’aucune façon associés.
Un des ouvrages les plus lus dans le monde anglophone, au sujet de la modélisation en climatologie — mais, comme nous l’avons vu, sans aller jusqu’à mettre en doute un réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre d’origine anthropique — est celui de Steven E Koonin (2021A135). Ce professeur de l’Université de New York a participé au développement des tous premiers modèles informatiques en sciences. Il a étudié leur usage en sciences du climat, à partir de 2004, engagé par la firme pétrolière British Petroleum pour un travail de recherche sur les énergies renouvelables. Le Président Barack Obama l’a par la suite nommé sous-secrétaire aux sciences du département américain de l’Énergie.
Les prophètes de « l’effondrement climatique » n’ont de cesse de disqualifier les climato-réalistes en les soupçonnant de complicité avec le lobby des ressources d’énergie fossile. La tentation est grande d’en faire de même avec un auteur comme Steven Koonin, qui a travaillé pour British Petroleum avant de rejoindre le gouvernement… Sauf que sa mission était d’étudier les options des énergies renouvelables permettant à la compagnie d’aller « au delà du pétrole » — voir Ron Bousso (2020A27) au sujet des ambitions de BP. L’intérêt pour ces industriels, au début 21e siècle, était plutôt de soutenir la « transition énergétique ». Même si, en 2025, les grandes entreprises énergétiques, dont BP et Shell, ont réduit leurs initiatives écologiques, privilégiant la rentabilité au détriment d’objectifs « climatiques ».
Après la publication de son éditorial intitulé Climate Science Is Not Settled dans le Wall Street Journal (2014A133), Steven Koonin avait été confronté à des avis mitigés (2021A135 p. 5) :
Cet article a suscité des milliers de commentaires en ligne, dont la grande majorité était favorable. Ma franchise sur l’état de la science du climat a cependant été moins populaire dans la communauté scientifique. Comme me l’a dit en privé le président d’un département de sciences de la Terre d’une université très respectée : « Je suis d’accord avec presque tout ce que vous avez écrit, mais je n’ose pas le dire en public.»
De nombreux collègues scientifiques, dont certains sont mes amis depuis des décennies, ont été outrés que je mette en évidence les problèmes de « La Science » et que je donne ainsi, comme l’a dit l’un d’entre eux, « des munitions aux négationnistes ». Un autre a déclaré qu’il aurait été acceptable de publier mon essai dans une obscure revue scientifique, et m’a reproché de l’avoir fait dans un forum comptant autant de lecteurs. Enfin, un éminent défenseur de l’idée que « La Science » est suffisamment établie a publié une réponse à mon éditorial, qui commençait par demander à l’Université de New York de reconsidérer mon emploi, continuait en déformant beaucoup de choses que j’avais écrites, puis, de manière déconcertante, reconnaissait que la plupart des incertitudes que j’avais signalées étaient bien connues, et avaient fait l’objet de nombreuses discussions parmi les experts (Pierrehumbert RT, 2014A217). Il semble qu’en soulignant ces incertitudes de manière aussi claire et publique, j’avais par inadvertance brisé un certain code du silence, comme l’omerta de la mafia.
Un éditorial du journal Nature (13 août 2024A272) rappelle sans équivoque :
Il faut le répéter encore et encore : la science ne peut pas être remise en question. Les fortes concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère réchauffent la planète. Le droit international est également clair : dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, juridiquement contraignant, les nations se sont engagées à maintenir les températures moyennes à 1,5 °C des niveaux préindustriels. Pourtant, comme les émissions continuent d’augmenter, la hausse des températures mondiales dépassera très certainement cette limite. […]
À la fin de l’année dernière, 2666 actions en justice liées au climat avaient été intentées dans le monde entier, selon un rapport du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, publié en juin (voir « Le climat devant les tribunaux »). La plupart des plaignants sont des particuliers, jeunes et vieux, ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG). Tous cherchent à tenir les gouvernements et les entreprises responsables de leurs engagements en matière de climat. En 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a reconnu qu’en cas de succès, les litiges climatiques « peuvent conduire à un renforcement de l’ambition globale d’un pays en matière de lutte contre le changement climatique ». Notez l’expression « en cas de succès ».
Si vous avez lu ce qui précède, il est quasiment impossible de mesurer la différence d’un dixième de degré par rapport aux périodes historiques, étant donné l’imprécision de la mesure des « températures » passées et présentes…
⇪ Réparer la « science défaillante »

Daniel Sarewitz écrivait dans son article Stop treating science denial like a disease (Cessez de traiter le déni de science comme une maladie) (2017A241) :
Nous demandons à la science de réaliser l’impossible : parvenir à une compréhension scientifiquement cohérente et politiquement unifiée de problèmes qui sont par nature ouverts, indéterminés et contestés.
Steven Koonin avait proposé, en 2017, la création d’une “Red Team” (équipe rouge), un groupe de scientifiques chargé de vérifier rigoureusement l’un des rapports d’évaluation du GIEC en essayant d’en identifier et d’en évaluer les faiblesses (Koonin SE, 2021A135 p. 197) :
En principe, on demanderait à un groupe contradictoire qualifié : « Qu’est-ce qui ne va pas avec cet argument ? » Et, bien entendu, la “Blue Team” (vraisemblablement les auteurs du rapport) aurait la possibilité de réfuter les conclusions de l’équipe rouge. (À noter que l’utilisation de “Red” et “Blue” est traditionnelle dans l’armée, où ces exercices ont vu le jour ; cela n’a rien à voir avec la politique américaine.)
L’examen par la Red Team d’un rapport d’évaluation du climat pourrait renforcer la confiance dans cette évaluation et démontrer la solidité (ou l’absence de solidité) de ses conclusions. Elle soulignerait la fiabilité de la science qui se soumet à son examen, et mettrait en évidence, pour les non-spécialistes, les incertitudes ou les points « gênants » qui ont été occultés ou minimisés. En bref, elle améliorerait et étayerait « La Science » par de la science.
Bien entendu, le GIEC des Nations unies et le gouvernement américain affirment que leurs rapports d’évaluation respectifs font autorité, puisqu’ils ont déjà fait l’objet d’un examen rigoureux par les pairs avant d’être publiés. Alors pourquoi exiger un niveau de contrôle supplémentaire ?
La réponse la plus directe à cette objection est que ces rapports présentent d’importantes failles dues à la manière dont ils ont été synthétisés et interprétés.
François Gervais résume ainsi les arguments de Koonin (Gervais F, 2022A94 p. 95, souligné par l’auteur) :
L’une des principales contributions du livre est son compte rendu détaillé de la façon dont le message sur le changement climatique est déformé au fur et à mesure qu’il passe par des filtres successifs. Les travaux publiés sont traduits en rapports, puis en résumés de rapports, qui sont ensuite repris par des médias alarmistes, sans qu’ils se soient évidemment donné la peine de lire les travaux originaux.
Steven Koonin précise (2021A135 p. 199) :
Un grand groupe d’experts bénévoles (y compris, [aux USA], pour l’Évaluation nationale du climat, un groupe convoqué par les académies nationales) révise le projet. Mais, contrairement à l’examen par les pairs des articles de recherche, les désaccords entre les réviseurs et les auteurs principaux ne sont pas résolus par un arbitre indépendant ; l’auteur principal peut choisir de rejeter une critique en disant simplement : « Nous ne sommes pas d’accord. » […] Et — point très important — les « Résumés à l’intention des décideurs » du GIEC sont fortement influencés, si ce n’est rédigés, par des gouvernements qui ont intérêt à promouvoir des politiques particulières.
Deux jours avant la March for Science, le Wall Street Journal avait publié un article dans lequel Steven Koonin proposait une évaluation des déclarations de la science du climat par une “Red Team” (Koonin SE, 2021A135 p. 200) :
J’ai utilisé la description alarmante et trompeuse des données sur les ouragans de l’ANC 2014 pour illustrer la nécessité d’un tel examen, et j’ai expliqué comment il pourrait être mené à bien (Koonin SE, 2017A134).
Cet article avait reçu 750 commentaires pour la plupart favorables. Mais trois articles y avaient répondu par la négative, arguant que les rapports avaient déjà été révisés par les pairs. Steven Koonin commente (2021A135 p. 201) :
Il est révélateur qu’aucun de ces articles n’ait abordé la déformation des données sur les ouragans du NCA 2014 que j’avais mise en évidence, ni expliqué comment elle avait survécu à « l’examen minutieux de plusieurs décennies » de « multiples niveaux d’évaluation formelle et informelle par des experts ». […]
Alors que l’intérêt de l’administration pour un examen par la Red Team s’est poursuivi jusqu’à la mi-2019, d’autres objections ont été émises par des politiciens non scientifiques qui se sont laissés induire en erreur en croyant que « la science est établie ». Le 7 mars 2019, le sénateur Schumer (et d’autres […]) ont soumis un projet de loi sénatoriale S.729 :
… interdire l’utilisation de fonds des agences fédérales pour établir un groupe d’experts, un groupe de travail, un comité consultatif ou tout autre effort visant à remettre en question le consensus scientifique sur le changement climatique […].
Bien que ce projet de loi n’ait jamais abouti, ce n’était certainement pas la première fois que le Congrès tentait d’empêcher une administration de faire quelque chose. […] En tant qu’étudiant en histoire, j’ai trouvé que ce projet de loi rappelait de manière désagréable un décret du Concile de Trente, en 1546, qui tentait de supprimer toute remise en question de la doctrine de l’Église. […].
Comment exercer un esprit critique constructif vis-à-vis des messages émanant de ces rapports relus et révisés par des non-scientifiques ? Steven Koonin propose quelques pistes (2021A135 p. 203–204):
Quiconque désigne un scientifique par les termes péjoratifs de « négationniste » ou « alarmiste » fait de la politique ou de la propagande.
Tout appel au prétendu « consensus de 97% » parmi les scientifiques est un autre signal d’alarme. L’étude à l’origine de ce chiffre (Cook J et al., 2013A47) a été démystifiée de manière convaincante (Toi RSJ, 2016A288). Quoi qu’il en soit, personne n’a jamais précisé ce sur quoi ces 97 % de scientifiques sont censés s’être accordés. Que le climat change ? Bien sûr, je suis d’accord ! Que les humains influencent le climat ? Absolument, j’en suis ! Que nous constatons déjà des effets météorologiques désastreux et que nous sommes confrontés à un avenir encore plus catastrophique ? Ce n’est pas du tout évident […].
La confusion entre météo et climat est un autre signal d’alerte.
L’omission de chiffres est également un signal d’alarme. Entendre dire que « le niveau de la mer augmente » est alarmant […].
Une autre tactique courante consiste à citer des chiffres alarmants hors contexte. Un titre comme « Les océans se réchauffent à la même vitesse que si cinq bombes d’Hiroshima étaient larguées chaque seconde » semble en effet effrayant, d’autant plus qu’il fait référence aux armes nucléaires (Kottasová I, 2020A137). Mais si l’on poursuit la lecture de cet article, on apprend que la température des océans n’augmente que de 0.04°C par décennie.
Les discussions non spécialisées sur la science du climat confondent souvent le climat actuel (observations) et le climat possible (projections de modèles selon divers scénarios).
Tout le monde peut (et devrait) lire les articles sur la science du climat en gardant à l’esprit ces signaux d’alerte. […] Les médias audiovisuels sont mal adaptés à cette tâche, car leurs reportages sont brefs et se résument à des extraits sonores. (Attention en particulier aux présentateurs météo qui se sont transformés en « présentateurs climat et météo » — rendre compte de changements sur trente ans n’est pas exactement un « flash d’information »).
David R Legates et collègues ont écrit (2015A149 p. 316) :
Le consensus de 97.1 % revendiqué par Cook et al. (2013A47) s’avère, après inspection, être non pas 97.1 % mais 0.3 %. Leur affirmation d’un consensus de 97.1 % est donc sans doute l’un des plus grands éléments de désinformation qui ait circulé de chaque côté du débat sur le climat.
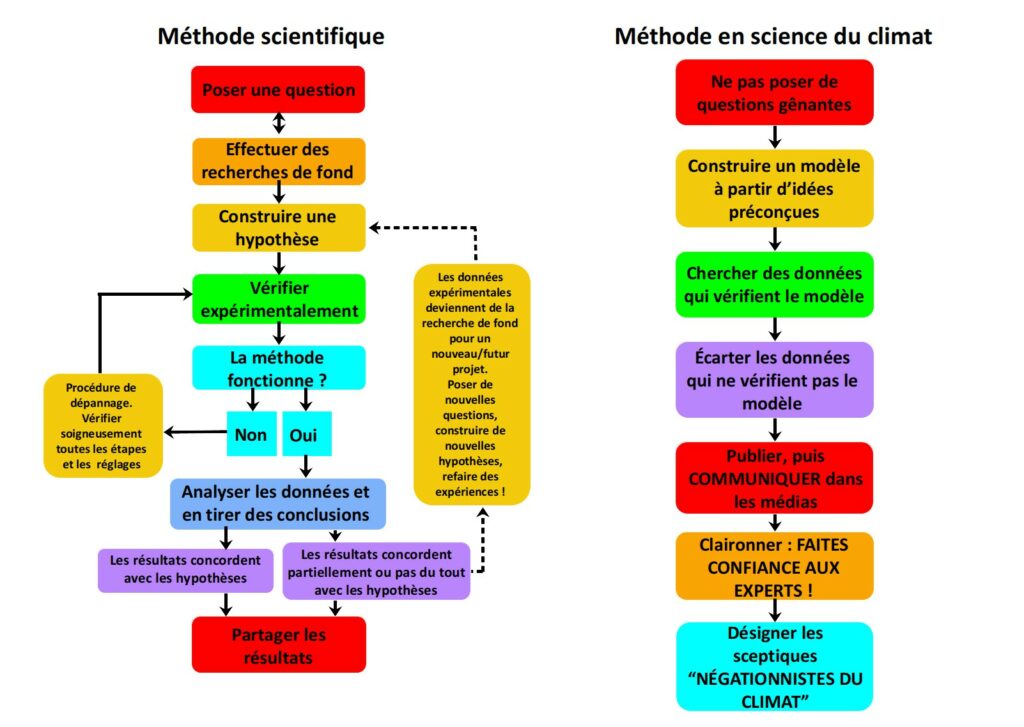
Richard Lindzen ajoute (2024A154) :
Que la revendication du consensus ait toujours été de la propagande devrait être évident, mais la revendication du consensus a ses propres aspects intéressants. Lorsque le réchauffement climatique a été exposé pour la première fois au public américain lors d’une audience au Sénat en 1988, Newsweek Magazine a publié une couverture montrant la Terre en feu avec le sous-titre « Tous les scientifiques sont d’accord ». C’était à une époque où il n’y avait qu’une poignée d’institutions traitant du climat, et même ces institutions étaient plus préoccupées par la compréhension du climat actuel que par l’impact du CO₂ sur le climat. Néanmoins, quelques politiciens (notamment Al Gore) en faisaient déjà leur thème de prédilection. Et, lorsque l’administration Clinton-Gore a remporté les élections en 1992, il y a eu une augmentation rapide d’environ 15 fois du financement lié au climat. Cela a en effet créé une augmentation importante du nombre d’individus prétendant travailler sur le climat, et qui ont compris que le soutien exigeait un accord avec le prétendu danger du CO₂. Chaque fois qu’il y avait une annonce de quelque chose qui devait être trouvé (c’est-à-dire l’élimination de la période chaude médiévale, l’attribution du changement au CO₂, etc.), il y avait, inévitablement, de soi-disant scientifiques qui prétendaient avoir trouvé ce qui était demandé (Ben Santer pour l’attribution et Michael Mann pour l’élimination de la période chaude médiévale) et recevaient des récompenses et une reconnaissance remarquables malgré les arguments absurdes. Cela a produit une sorte de consensus.
Michael Sidiropoulos (2019A263) a présenté un concept actualisé de la méthode scientifique, avec l’inclusion, dans la validation, de deux étapes supplémentaires : des critères de démarcation et un critère de falsification modifié.
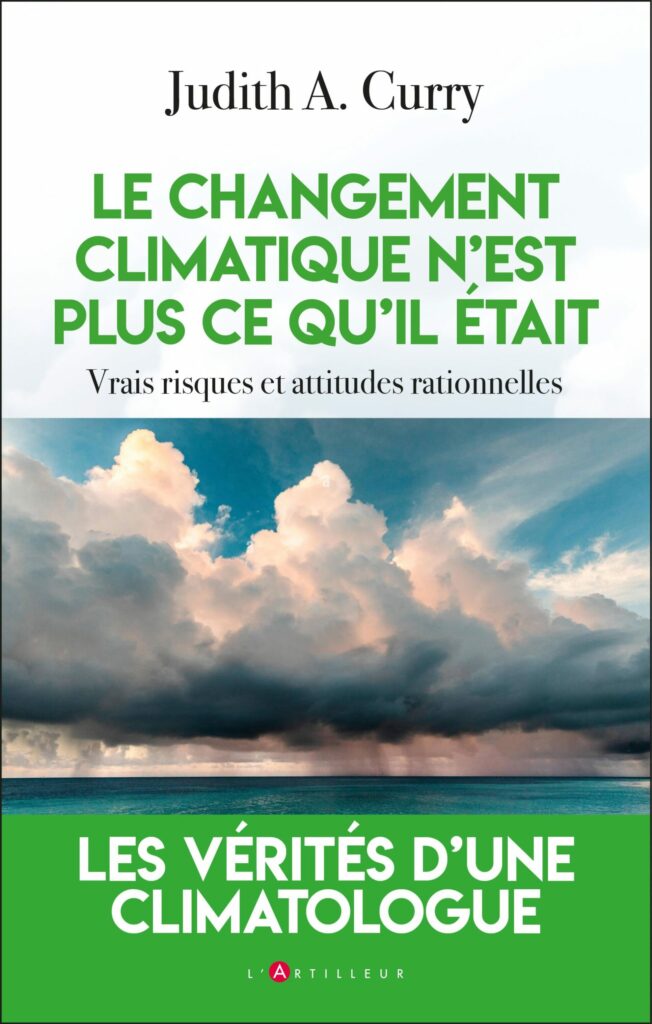
Dans son ouvrage Le changement climatique n’est plus ce qu’il était traduit (avec révisions) de Climate Uncertainty and Risk : Rethinking Our Response, la climatologue Judith A Curry écrit (2024A52 p. 102–104 ; 2023A51 p. 55–56) :
L’expression « suivez la science » sonne bien. Mais la science ne conduit nulle part. Elle peut éclairer diverses lignes de conduite, quantifier les risques et les arbitrages. Mais pas faire des choix à notre place. En suivant la science, les décideurs évitent d’assumer la responsabilité des choix qu’ils font. Quand la science est invoquée pour légitimer le transfert de responsabilités d’un corps démocratique à un corps technocratique, elle sort les décisions de l’arène du débat politique. […]
Dans les débats politiques, « Je crois en la science » est une affirmation souvent proclamée par des individus qui n’y comprennent pas grand chose. […]
Confrontés à une science qui conteste leurs biais politiques, ces mêmes « croyants » n’hésitent pas une seconde à parler de « pseudoscience », sans prendre en considération (et sans même comprendre) les véritables preuves ou arguments [Tracinsky R, 2019A290].
La « vérité consensuelle » est entretenue en triant les faits objectifs, en les altérant et en les décrivant de manière à ce qu’ils soient conformes au récit. Andy May rappelle ce qui inscrit dans le temps une démarche scientifique, en contraste avec une décision politique (2020A173 p. 203, 205) :
Le consensus est un processus politique. Le public forme une opinion consensuelle, puis vote et adopte des lois ou des règles qui reflètent cette opinion. En science, nous formulons d’abord une hypothèse ou une idée qui explique un phénomène naturel observé, tel qu’un réchauffement ou un refroidissement. L’étape suivante consiste à tenter de la réfuter. En cas d’échec, l’idée survit. Nous publions ce que nous avons fait et d’autres tentent de réfuter l’idée ; s’ils n’y parviennent pas, l’idée survit. Une fois que cela a duré assez longtemps, l’hypothèse devient une théorie. Une théorie scientifique ne fait que survivre, elle n’est jamais prouvée, elle doit toujours être soumise à des tests. […] Les confirmations ne prouvent pas une théorie, mais elles lui permettent de survivre.
Patrice Poyet s’interroge sans optimisme sur l’avenir (2022A221 p. 426) :
Comment une idéologie sans fondement peut-elle faire dérailler des esprits brillants au point de les rendre inutiles au progrès de l’humanité ? C’est une question déroutante, et j’essaierai d’y répondre à l’avenir avec l’aide de mes amis compétents en philosophie, psychologie, etc. Car, comme on peut l’observer en pleine lumière, la science n’est même plus discutée, tout juste des arguments faisant vaguement appel à des idées « largement reconnues » mais non fondées ni prouvées par la « communauté scientifique ». Et mieux comprendre comment les mécanismes psychologiques opèrent pour faire fonctionner ces cerveaux de manière si erronée est une entreprise qui en vaut vraiment la peine.
Remettre la pseudo-science climatique sur les rails ne réussira pas par un simple raisonnement scientifique solide et des preuves évidentes. Il faudra, soit attendre que le climat leur claque au nez en évoluant dans le sens contraire — mais soyez prêts à entendre que ce refroidissement se produit parce qu’ils avaient raison avec la théorie du réchauffement climatique anthropique (AGW) et que cela correspond exactement à ce qu’ils disaient — soit mieux comprendre comment un aveuglement massif basé sur des gratifications et des financements immédiats et attrayants, appuyé par un conditionnement de masse, a réussi à effacer tous les principes scientifiques d’un raisonnement cohérent.
La troisième partie de l’ouvrage de Judith Curry (2024A52 p. 259–477 ; 2023A51 p. 163–309) — qui pourrait faire l’objet de nouveaux articles — traite de l’évaluation et de la gestion du risque climatique, de la prise de décision en situation de profonde incertitude, des processus d’adaptation, de résilience et de développement, de l’atténuation du risque et, pour finir, du discours politique à propos du risque climatique (2024A52 p. 456 ; 2023A51 p. 294) :
Pour parler simplement, les principes de gestion du risque (gestion qui doit être proportionnée, alignée, complète, intégré et dynamique, cf. section 11.1) sont ignorés en matière de politique climatique.
⇪ Agendas (à peine) cachés

La thèse d’une crise climatique causée par l’activité humaine serait-elle un simple prétexte à la mise en place d’une gouvernance supranationale ? C’est ce qu’affirment certains analystes — inévitablement étiquetés « complotistes » — des propositions politiques antérieures à la fondation du Club de Rome. Lire à ce sujet « Le Club de Rome : comment l’hystérie climatique est utilisée pour créer une gouvernance mondiale » (Smith B, 2023A265) et un essai du géographe Jacob Nordangård (2023) : Club de Rome : la technocratie et les élites du monde.
Il y aurait donc un agenda caché derrière la politique climatique mise en place par le Club de Rome et, dans la même foulée, le Great ResetN60 du Forum Économique MondialN61. Voir à ce sujet mon article : Vers un nouvel « ordre mondial» ?
De nombreuses déclarations vont dans le sens d’un projet politico-économique — qualifié de « communiste » par des capitalistes irréductibles — visant à une nouvelle répartition des richesses indépendamment de l’engagement pour la protection de la biosphère. Autrement dit, il ne serait pas indispensable de croire au « réchauffement causé par le CO2 d’origine humaine », dans la mesure où toute forme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, même soldée par une inefficacité climatique, se traduirait par une redistribution profitable au bien-être des populations et — ne l’oublions pas — au commerce international.
On peut en effet lire ce message en filigrane de la proposition d’Emmanuel Macron, à la COP 27 en Égypte, de « réformer le système financier international » à l’image de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce discours est en phase avec une déclaration, douze ans plus tôt, du vice-président du GIEC Ottmar Edenhofer (2010A71) :
Tout d’abord, nous, les pays industrialisés, avons quasiment confisqué l’atmosphère à la communauté mondiale. Mais il faut dire clairement que nous redistribuons de facto le patrimoine mondial par le biais de la politique climatique. Que les détenteurs de gaz, de charbon et de pétrole n’en soient pas ravis, c’est évident. Il faut se débarrasser de l’illusion selon laquelle la politique climatique internationale est une politique environnementale. Cela n’a presque plus rien à voir avec la politique environnementale, ni avec des problèmes tels que la disparition des forêts et le trou dans la couche d’ozone.
Benoît Rittaud expose le point de vue, moins enthousiaste, des « bénéficiaires » de cette redistribution (2023bA238 p. 108):
C’est l’occasion ici de signaler que l’hostilité anti-occidentale de nombreux pays tels que les BRICS tient pour une bonne part aux leçons de morale qui leur sont assénées dans ce qui a tout d’un néocolonialisme déguisé. […]
Pour beaucoup de pays anciennement colonisés, le complexe climato-industriel est en quelque sorte une nouvelle déclinaison de cette stratégie qui, sous couvert de fonds soi-disant « verts » (qui consistent le plus souvent en une réallocation comptable d’aides déjà existantes, voire en des prêts à taux zéro), est l’occasion d’imposer l’application de politiques décidées ailleurs.
Le colonialisme avait su s’appuyer sur une certaine science de son temps et ses théories telles que le racisme scientifique ou l’eugénisme. Le néocolonialisme d’aujourd’hui fait de même avec l’écologie et le climat et, là encore, des scientifiques et des experts, qui se croient protégés par leurs connaissances et leur intégrité, servent en réalité d’idiots utiles à ces mouvements qui les dépassent. Certains décideurs ne font hélas pas mieux.
Cet agenda redistributif est ancien, puisqu’il a fait l’objet d’une déclaration de Maurice Strong, le milliardaire canadien fondateur de l’UNEP, lors d’une conférence des Nations Unies sur l’environnement en 1972 : « Les ressources de la Terre sont l’héritage commun de toute l’humanité. Elles ne doivent plus être exploitées au profit de quelques pays seulement, au détriment des pays les plus pauvres de la planète. » (Brooker C, 2015A30) Mais quel rapport avec les « gaz à effet de serre » ?
Les dirigeants des pays en développement déclarent qu’ils ont été et sont contraints d’utiliser des énergies vertes coûteuses, qui produisent moins d’énergie par capital investi. Il est donc encore plus difficile pour des milliards de personnes d’échapper à la pauvreté. Le terme utilisé pour désigner ce type de politiques, imposées aux pays en développement par la Banque mondiale, le Forum économique mondial et d’autres acteurs, est désormais connu sous le nom de « colonialisme vert ». Rémy Prud’homme écrit (2024A215 p. 137) :
Le Nord est persuadé d’avoir l’obligation de contraindre, au besoin par la force, le Sud à suivre son exemple, dans l’intérêt de tous. On reconnaît là l’argument des colonisateurs du Nord qui autrefois apportèrent, au besoin par la force, la « civilisation » aux « barbares » du Sud. Cet impérialisme arrogant est, et sera, de moins en moins accepté par le Sud.
Les « marchés du carbone » sont en passe de devenir « l’un des principaux produits d’exploitation de l’Afrique » — tout un programme (de recolonisation diraient certains) imaginé par le groupe McKinsey (de Rouville G, 2024A57 p. 108). Ils consistent à produire des crédits carbone, liés à une activité vertueuse — comme la plantation d’arbres — affectés à des entreprises comme Total, Nestlé, etc., qui en ont besoin pour compenser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Le Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales montre un des revers de la médaille (WRM, 2024A307 p. 32) :
Certaines des plus grandes sociétés du monde investissent dans des plantations d’arbres industrielles indépendantes pour compenser leurs émissions. Par exemple, en République du Congo, les communautés n’ont nulle part où faire pousser leur nourriture parce que le géant pétrolier TotalEnergies est en train de s’emparer des terres pour y installer 40 000 hectares de monoculture d’arbres, afin que les dégâts (et les profits) liés à ses activités d’extraction pétrolière et gazière puissent perdurer sous prétexte que la société compense en plantant des arbres.
Richard Lindzen a confirmé ce que je perçois comme un déraillement du discours sur le climat, les citoyens — et surtout les électeurs — n’ayant plus la capacité de se poser des questions sur le fondement scientifique du discours climato-alarmiste (Lindzen R, 2018A153 p. 6) :
Il y a quelques années, Christiana Figueres, alors secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique [UNFCCC], a déclaré que, pour la première fois dans l’histoire, l’humanité se donnait pour mission de modifier intentionnellement le système économique.
Mme Figueres n’est pas la seule à le penser. Le plus proche conseiller du pape François a fustigé les conservateurs sceptiques du changement climatique aux États-Unis, blâmant le capitalisme pour leurs opinions. S’adressant aux journalistes, le cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga a critiqué les « mouvements » aux États-Unis qui s’étaient opposés de manière préventive au projet d’encyclique de François sur le changement climatique. « L’idéologie qui entoure les questions environnementales est trop liée à un capitalisme qui ne veut pas cesser de détruire l’environnement parce qu’il ne veut pas renoncer à ses profits », a‑t-il déclaré.
Sans surprise, un tel positionnement donne de l’urticaire aux inconditionnels de l’autorégulation dans une économie de marché de libre-échange. Mais ni les clivages gauche-droite, « communisme » contre « capitalisme », ni les anathèmes qui leur sont associés, n’apportent quoi que ce soit de concret au débat scientifique. Il est d’ailleurs déconcertant de voir un dignitaire ecclésiastique embrayer sur une critique du capitalisme après que son clan ait combattu le communisme jusqu’au démantèlement de l’Union soviétique… Tout cela n’a rien à voir avec la foi chrétienne — ni la « religion du CO2 » !
⇪ Virage à droite

Je trouve regrettable que le même déraillement du discours « climatiquement correct » se soit immiscé dans un exposé scientifique par ailleurs minutieux et rigoureux.
Le déraillement prend ici la forme d’un éloge immodéré du modèle productiviste en opposition radicale aux discours de l’écologie politique. C’est l’objet de la dernière partie du film de Martin Durkin (2024A68 1:08:54). Une telle prise de position ne peut qu’entretenir l’indifférence des citoyens face aux destructions de l’environnement liées aux pratiques industrielles et agricoles, ainsi qu’à leurs choix de vie.
Ce « virage à droite » est encore plus marqué par une défense du capitalisme selon la vision d’Adam Smith. Dans un élan de prosélytisme, Patrice Poyet (2022A221 p. 432) n’hésite pas à appuyer son propos sur une citation hors-contexte de l’historien Yuval Noah Harari (2015, traduction 2022A106 p. 365) :
[…] l’idée de Smith selon laquelle la pulsion égoïste qui pousse l’homme à accroître ses profits est la base de la richesse collective est l’une des idées les plus révolutionnaires de l’histoire humaine : révolutionnaire non pas seulement dans une perspective économique, mais plus encore dans une perspective morale et politique. Ce que dit Smith, au fond, c’est qu’il est bien d’être cupide et qu’en m’enrichissant je profite à tout le monde, pas seulement à moi. L’égoïsme est altruiste.
Hélas pour Poyet, Harari n’adhère aucunement à la vision de Smith. Il écrit au contraire (2022A106 p. 384) :
Sous sa forme extrême, cependant, croire à la liberté du marché c’est être aussi naïf que croire au Père Noël. Il n’existe rien qui ressemble à un marché libre exempt de tout travers politique. La ressource économique qui compte le plus est la confiance en l’avenir, et cette ressource est constamment menacée par les voleurs et les charlatans. Les marchés eux-mêmes n’offrent aucune protection contre la fraude, le vol ou la violence.
Mais tout ceci est hors sujet !
⇪ Une « permacrise »

Source : BBC News (6 décembre 2023A313)
L’absence d’un débat dépassionné, et l’accord de la majorité des gens « normaux » sur la réalité d’une « urgence climatique », sont révélateurs d’un mécanisme de formation des masses comme l’a théorisé Mattias Desmet.
Chargée d’anxiété, cette « formation » s’apparente à une psychose. Voir par exemple la stérilisation volontaire de jeunes gens qui renoncent à mettre au monde des enfants dans un monde « sans avenir » (Whetter D, 2023A313).
La COP 28, en 2023 à Dubai, a fait état de problèmes mentaux liés au climat. Mais si la perspective d’un « effondrement climatique » imminent alimente l’éco-anxiété de personnes fragiles, n’est-elle pas l’œuvre de pompiers pyromanes ? « Nous vivons une période où la réalité scientifique est éclipsée par des discours populistes d’agitation des peurs. » Bien que détachée de son contexte, cette phrase d’une députée écologiste illustre parfaitement le bombardement médiatique indécent qui a fait suite à la COP 28.
Claude Allègre écrivait (2010A9 p. 257) :
Dans le système de distribution mondialisé et chaotique des informations dans lequel nos sommes plongés, il est maintenant établi que quelques individus agissant de façon discrète et coordonnée, ont les moyens de manipuler l’opinion, en tout cas de l’orienter. […] Al Gore, personnage central de l’aventure, s’est engagé dans la vie politique avec une ambition énorme, et l’idée de se faire le champion de la défense de la planète et des nouvelles technologies de l’information. […] Son ambition a rencontré celle de quelques scientifiques désireux de se faire un nom à partir d’une discipline qu’ils entendaient créer, et qu’on pourrait appeler la climatologie scientifique. Deux scientifiques marquent cette ambition : Stephen Schneider et James Hansen, qui seront successivement les alarmistes du global cooling puis du global warning. […]
Tout cela, c’est la mécanique. Mais elle n’a pu avoir cette étonnante efficacité que parce qu’elle a agi sur une opinion publique occidentale en perte de repères philosophiques et apeurée par la mondialisation.
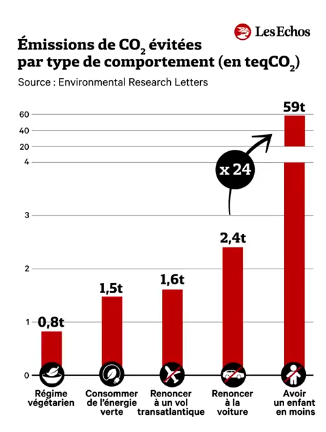
L’éco-anxiété permet de rendre populaire un investissement (de l’argent des contribuables) dans le développement de technologies et services focalisés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre : la décarbonation. Des milliers d’emplois sont en jeu, ce programme est “too big to fail” !
Les mauvais coucheurs qui n’entrent pas dans la danse ne sont autres que des ennemis du genre humain… Puisque « nous sommes en guerre », tous les coups ne sont-ils pas permis ? (Kempf H, 2023A128 ; Belaud A, 2023A19 ; Bock-Côté M, 2023A25). Députée européenne de la France Insoumise et vice-présidente de l’intergroupe Green New Deal, Manon Aubry aurait déclaré en août 2023 : « Une limitation des libertés au nom du changement climatique n’est pas liberticide. »
Au contrôle de l’information — la lutte contre les fake news, plébicitée à gauche comme à droite — s’ajouterait le contrôle du mode de consommation énergétique de chaque citoyen. Soit par des actions incitatives à la « sobriété », soit par des mesures de fiscalité environnementale comme la taxe carbone, provisoirement mise en échec par le mouvement des Gilets jaunes en France, ou des quotas individuels de production de gaz à effet de serre : la carte carbone (Pottier A, 2021A220).
Patrice Poyet nous prévient (2022A221 p. 516) :
Après les confinements de Covid-19 qui ont inauguré une nouvelle ère de destruction massive des libertés individuelles les plus élémentaires, viendra le temps des confinements climatiques et des pass carbone qui vous pourriront la vie, le fascisme vert ayant la gentillesse, comme souvent avec ces délires autoritaires, de vous prévenir à l’avance de ce qui vous attend (Le Quéré et al., 2021A146 ; Nerini et al., 2021A202). Vous n’aurez aucune excuse et ne pourrez pas prétendre que vous n’étiez pas au courant.
Le mécanisme précité de formation des masses est du même ordre que ce que Cass R Sunstein et Adrian Vermeule ont appelé « polarisation des groupes », origine selon eux de « cascades conspirationnistes ». Tout événement donne lieu à une avalanche de commentaires qui ne font que renforcer les convictions de ceux qui les partagent (2009A276 p. 216) :
Il existe des liens évidents entre les cascades et le phénomène bien connu de la polarisation des groupes, par lequel les membres d’un groupe délibérant finissent généralement par adopter une position plus extrême, conforme à leurs tendances avant même de faire l’objet de délibérations.
Sauf que les travaux de Sunstein et Verneule ne s’intéressaient qu’à la naissance de théories du complot, dans lesquelles ils incluaient le déni du changement climatique, à la fois faux et dangereux (2009A276 p. 206). Ils suggéraient une tactique efficace pour éradiquer les croyances (jugées) complotistes, celle de l’infiltration cognitive (2009A276 p. 224) :
Les agents du gouvernement (et leurs alliés) peuvent pénétrer dans les salons de discussion, les réseaux sociaux en ligne, ou même les groupes de l’espace réel, et tenter de saper les théories conspirationnistes en émettant des doutes sur leurs prémisses factuelles, leur logique de causalité ou leurs implications pour l’action, politique ou autre.

Tout cela suppose que les « agents du gouvernement et leurs alliés » seraient en possession des outils intellectuels leur permettant d’appréhender des mécanismes d’une extraordinaire complexité. Or, la plupart de ceux qui claironnent « la Vérité » sur le climat sont des personnes sans bagage scientifique — de celles qui n’ont appris que le minimum nécessaire pour étayer leurs convictions…
Faute d’une vision claire, aussi bien la polarisation des groupes que l’infiltration cognitive conduisent à un glissement du discours sur le climat, à partir d’hypothèses scientifiques faibles, car non vérifiées, vers un consentement, version populaire du « consensus ». La dimension morale et la fermeture à toute analyse critique sont les marques d’une position religieuse.
Sous le titre Réprimande et rédemption, Benoît Rittaud écrit (2022A236) :
Le chemin de la rédemption […] emprunte à la fois à la religion et au totalitarisme. La première se lit en filigrane dans les appels à une sobriété toute franciscaine (« heureuse », rassurons-nous), dans la possibilité de racheter nos péchés par les indulgences (les compensations carbone) ou encore dans les grandes processions (les manifestations pour « éveiller les consciences »). Quant à la seconde, elle se voit dans le recours constant à la peur et à la menace, mais aussi dans le fait que chaque instant de notre vie doit désormais être mesuré à l’aune unique du climat. Il nous faut y penser lorsque nous nous nourrissons, lorsque nous nous habillons, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous achetons, ou même lorsque nous jetons.
Le climat ne se contente pas d’être un sujet parmi d’autres, ni même de disposer du statut de « problème le plus important ». Non : il doit être le point focal de toute considération, quelle qu’elle soit. Tout doit trouver le moyen de s’y ramener, qu’il s’agisse d’économie, de défense, des institutions, voire du covid. La « justice climatique » voisine donc avec la consommation « éco-responsable », les « grèves pour le climat » ou encore la Constitution qui, durant le dernier quinquennat, et dans l’indifférence générale, aurait dû se voir affublée de « la lutte contre le changement climatique » dans son article premier.
Vue sous cet angle, la « crise climatique » s’inscrit dans ce qu’un article du Financial Times désigne comme « permacrise » : « un ensemble de risques globaux liés dont les effets s’additionnent, de sorte que l’impact global dépasse la somme de chaque partie » (Fazi T, 2023A78) :
Personne ne remettrait en question l’idée qu’il y a beaucoup de crises dans le monde à tout moment. Mais on pourrait également affirmer que cela a toujours été le cas, en particulier du point de vue des milliards de personnes qui vivent dans le Sud. Il semble donc raisonnable de se poser la question suivante : cette utilisation obsessionnelle du mot « crise » est-elle simplement la reconnaissance d’une situation exceptionnellement mauvaise ? Ou y a‑t-il d’autres facteurs en jeu ?
Même avant la pandémie de grippe aviaire, plusieurs chercheurs éminents avaient suggéré qu’au cours des dernières décennies, la crise constituait une « méthode de gouvernement » dans laquelle « chaque catastrophe naturelle, chaque crise économique, chaque conflit militaire et chaque attaque terroriste est systématiquement exploité par les gouvernements pour radicaliser et accélérer la transformation des économies, des systèmes sociaux et des appareils de l’État. » […]
En poussant ces analyses un peu plus loin, on pourrait affirmer que le récit contemporain de la crise permanente, ou de l’urgence, représente un changement qualitatif de la « crise comme mode de gouvernement » — qui ne se limite plus à l’exploitation des crises, mais se fonde sur l’évocation constante de la crise elle-même, voire sur la fabrication de crises proprement dites. Dans un tel système, la « crise » ne représente plus un écart par rapport à la norme ; elle est la norme, le point de départ par défaut de toute politique. […]
Cela représente un changement radical par rapport à la manière dont la notion de crise a été définie jusqu’à présent. Historiquement, la « crise » a souvent été associée à l’idée d’opportunité et même de progrès. La permacrise représente l’inversion contemporaine de cette conception, car elle exclut toute idée de progrès, désignant plutôt une situation durablement difficile, ou qui s’aggrave — une situation qui ne peut jamais être résolue, mais seulement gérée.
Andy May écrivait, en préface de son ouvrage Politics and Climate Change, a History (2020A173 p. 14) :
Nous nous pencherons sur la tentative des politiciens de contrôler la recherche scientifique et ses résultats. Ils le font en finançant de manière sélective des projets qui recherchent des catastrophes potentielles, idéalement des catastrophes mondiales. Les gens aiment les histoires de catastrophes, les journalistes aiment les histoires de catastrophes, les scientifiques aiment être cités dans les journaux et à la télévision. Il n’est donc pas surprenant qu’avec la prise en charge du financement de la recherche scientifique par les pouvoirs publics, les scientifiques aient délaissé la recherche visant à aider les gens au profit de la recherche sur les catastrophes potentielles, aussi lointaines soient-elles. La science est passée de l’amélioration de la vie humaine à l’élaboration d’intrigues pour des films catastrophes.
Et si les humains peuvent être tenus pour responsables de la catastrophe, c’est encore mieux, car les politiciens peuvent alors mandater des personnes « pour le plus grand bien ». Le pouvoir du politicien augmente parce que l’exercice du pouvoir l’augmente et que les gens renonceront à leurs libertés en échange de la sécurité, que le danger soit réel ou non.
⇪ À quel prix ?
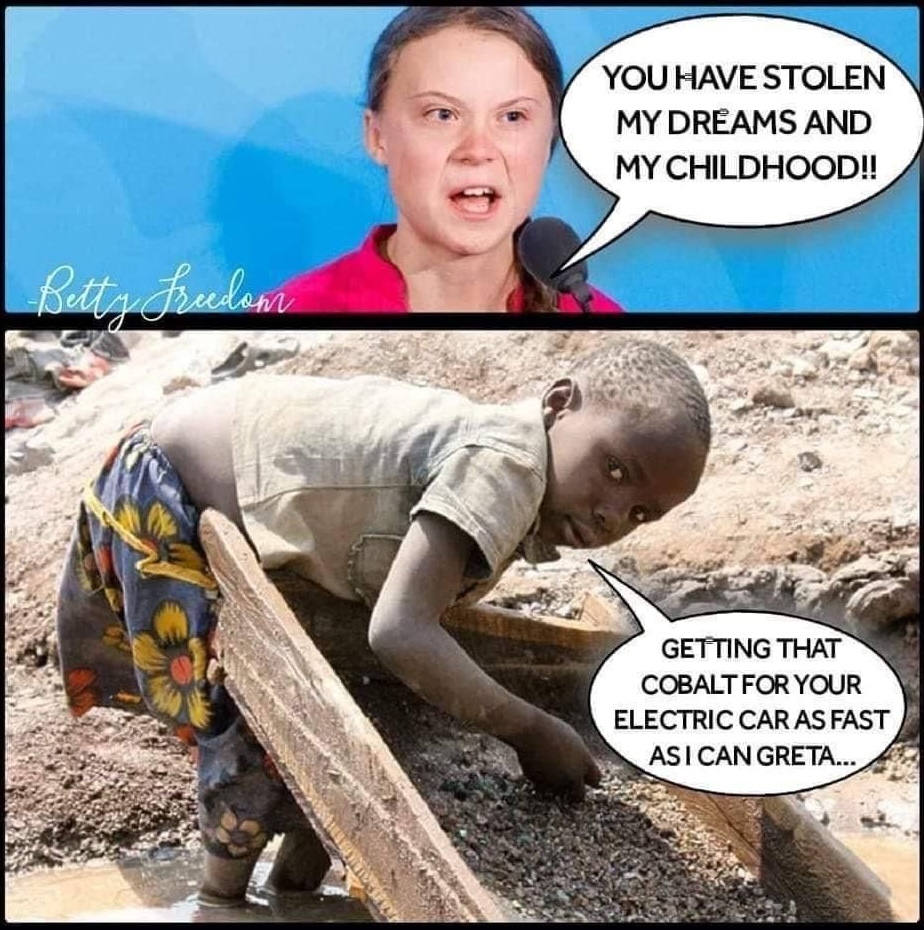
— Je me dépêche de ramasser ce cobalt pour ta voiture électrique, Greta !
La morale au service de l’écologie ? (source)
Le remue-méninges à propos du CO2 responsable du « dérèglement du climat » occupe le devant de la scène médiatique, au détriment de la lutte contre la pollution des nappes phréatiques, des cours d’eau et des océans, la pollution lumineuse, la dégradation de la biodiversité par des pratiques agricoles inadaptées, la stérilisation des sols, l’extraction minière de ressources minérales exigeant une consommation massive d’eau — entre autres, les matériaux (lithium, cobalt, etc.) servant à la fabrication de batteries de véhicules électriques destinés à « sauver le climat » (voir Prud’homme R, 2024A215 p. 39–60 pour une évaluation détaillée du coût)…
Guillaume de Rouville écrit (2024A57 p. 72, 62) :
Les mêmes matériaux critiques pour le développement du complexe militaire, des technologies de la révolution digitale et de la transition écologique seront sortis de leur gangue terrestre à coups de pelleteuses géantes et de produits chimiques finissant leur cours dans l’eau « potable » des peuples autochtones sacrifiés au nom du développement durable. […]
Si nous n’arrêtons pas la folie extractive rendue « durable et raisonnable » au nom des énergies renouvelables et de la transition énergétique, dans moins de trente ans la Terre ne sera plus qu’un vaste champ de mines. Un champ de bataille pour les appétits prédateurs des multinationales verdies par l’idéologie écolo-extractive.
Des reportages comme Andalousie : la hantise des panneaux solaires (diffusé sur Arte le 2 juin 2025) montrent les dégradations de l’environnement, de l’activité agricole et de la biodiversité causée par l’installation de gigantesques fermes solaires en Espagne. Ce qui est intéressant, car les personnes dénonçant les abus des technocrates ont d’autres solutions d’utilisation bénéfique de ces sources d’énergies : la maire qui s’oppose aux fermes solaires industrielles a fait installer un champ de panneaux solaires servant à alimenter le pompage de l’eau utilisée par les habitants.
Des forêts sont saccagées pour l’installation d’éoliennes (Gosselin P, 2025A101) :
Dans la forêt de Reinhardswald, près de Kassel, connue sous le nom de « forêt enchantée », un paysage naturel et culturel jusqu’alors intact, avec des arbres vieux de plus de 500 ans, est aujourd’hui irrémédiablement détruit. Pourquoi ? Pour protéger la nature et le climat, affirment l’industrie éolienne et les défenseurs de l’environnement.
Après le sommet sur le climat de Copenhague (COP 15) en 2009, vécu comme un échec par ceux qui espéraient « un accord international capable de lutter efficacement contre le changement climatique », Claude Allègre avait poussé un cri de colère qui, malheureusement, reste d’actualité (2010A9 p. 36) :
Alors que 10 000 personnes meurent chaque jour par manque d’eau potable, le sommet de l’eau à Ankara l’an dernier s’est déroulé dans l’indifférence générale. Aucun chef d’État ne s’est déplacé, ni non plus à Rome en novembre 2009 pour le sommet de la FAO. Cela leur a évité d’entendre le Président Diouf terminer la séance finale solennelle en demandant à l’auditoire de se lever, et de compter jusqu’à six : « Un, deux, trois, quatre, cinq, six… Eh bien, pendant que vous comptiez, un enfant de plus dans le monde est mort de faim. »
Cela leur a évité de faire la simple division qui leur aurait montré que les sommes dépensées pour le sommet de Copenhague — plus d’un demi-milliard d’euros — auraient permis de sauver 100 000 enfants ! Alors, à côté de cela, quand on a observé le cirque de Copenhague, on ne peut que s’écrier, pour échapper au malaise : « Messieurs et Mesdames, assez ! Occupez-vous des vrais problèmes ! »
(En France) « Le coût de la mise en œuvre de la planification écologique représente environ trente fois le coût de la Justice » (Prud’homme R, 2024A215 p. 147).

© ADEBA – NON au projet Solena à Viviez, oui aux alternatives. Source : Reporterre
En 2018, Richard Lindzen réprouvait la tournure des événements (2018A153 p. 7) :
En août dernier, un article a été publié dans les actes de l’Académie nationale des sciences. Parsemé de « pourrait » et de « peut-être », il conclut qu’une « action humaine collective » est nécessaire pour « éviter que le système terrestre n’atteigne un seuil potentiel » et pour qu’il reste encore habitable. Selon les auteurs, cela impliquerait « la gestion de l’ensemble du système terrestre — biosphère, climat et sociétés », et cela pourrait impliquer « la décarbonation de l’économie mondiale, un renforcement des puits de carbone de la biosphère, des changements de comportement, des innovations technologiques, de nouvelles dispositions en matière de gouvernance, et une transformation des valeurs sociales ».
N’oublions pas que, dans un monde qui adhère à I’incohérence du « principe de précaution », la simple affirmation d’une possibilité lointaine justifie une action radicale.
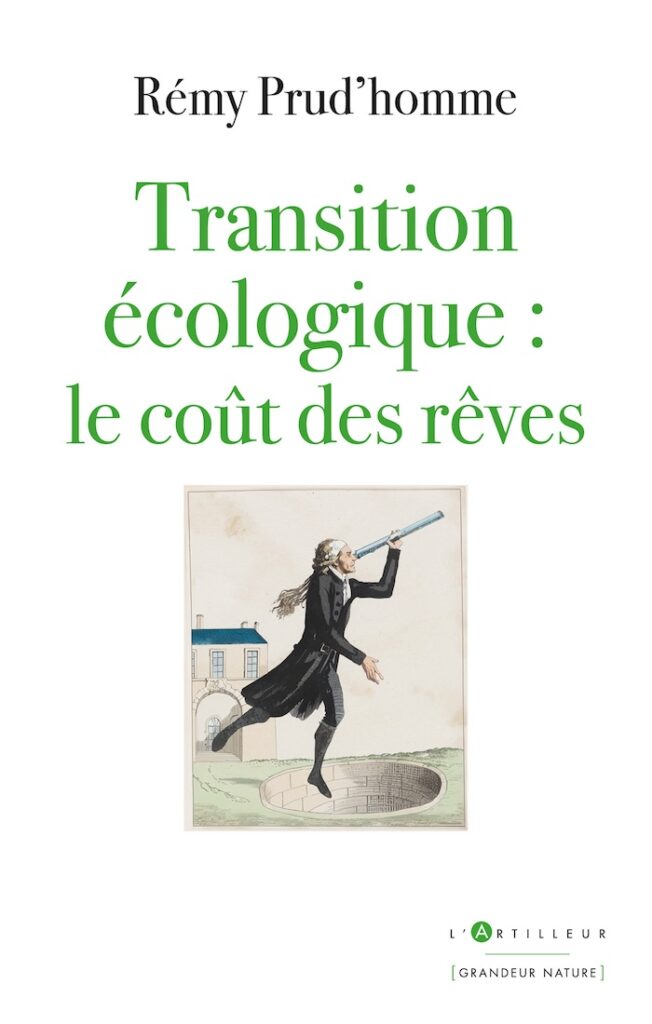
Dans son ouvrage Transition écologique : le coût des rêves, l’économiste Rémy Prud’homme écrit (2024A215 p. 14, 145) :
[…] la sagesse commande, depuis toujours […] de ne retenir que les projets dont les bénéfices sont plus grands que les coûts.
C’est justement ce que les Verts répugnent à faire. Ils jugent tous les projets à la seule aune de leur contribution àla réduction des émissions de CO2, condition nécessaire et suffisante à l’inscription d’un projet sur la liste de leur « planification écologique ». Cette réduction des rejets vaut bénéfice, un bénéfice qu’il est inutile d’évaluer. Le bon, le bien, la vertu, ne se décomptent pas : ils se pratiquent. C’est une attitude de croyant, de dévôt.
En ce qui concerne les coûts, c’est la même chose, en pire. Compter, c’est déjà pécher, un exercice coupable ou au minimum méprisable. Dans la bonne bourgeoisie française, on ne parle jamais d’argent à table (même si on y pense souvent). Quand on aime, on ne compte pas. Dans l’abondante littérature sur la planification écologique citée plus haut, vous pouvez lire des dizaines, parfois des centaines, de pages sans rencontrer le mot « euro ». C’est ainsi, par exemple, que ce mot maudit ne figure pas dans la synthèse du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat [2020N62]. Les grands prophètes ne frayent pas avec les petits comptables. De minimis non curat prateor. […] Les intellectuels qui l’ont préparé se flattent de ne pas être de vulgaires « comptables ».
Judith Curry écrit (2024A52 p. 324–325 ; 2023A51 p. 204) :
En janvier 2022, le Global Risks Report du Forum économique mondial identifiait les trois risques les plus sévères à l’échelle mondiale pour les dix prochaines années : la perte de la biodiversité, les conditions météorologiques extrêmes et, en numéro un, « l’échec de l’action climatique » [WEF, 2022A306]. Comment « l’échec de l’action climatique » — celui d’une stratégie spécifique visant à l’élimination des combustibles fossiles — est-il devenu un risque indépendant, dépassant apparemment le risque du changement climatique lui-même ? En tentant de faire face aux risques du changement climatique causé par l’homme dans le contexte du principe de précaution, les dangers inconnus et incertains (naturels et anthropogéniques) du changement climatique ont été remplacés par l’urgence de mettre en place une solution spécifique — la réduction rapide des émissions de combustibles fossiles.
La polarisation des esprits sur « l'empreinte carbone » permet aux entreprises — y compris dans le secteur de l’extraction de combustibles fossiles — de s’acheter une « notoriété verte » en compensant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre par des opérations appréciées du public, comme la plantation d’arbres.
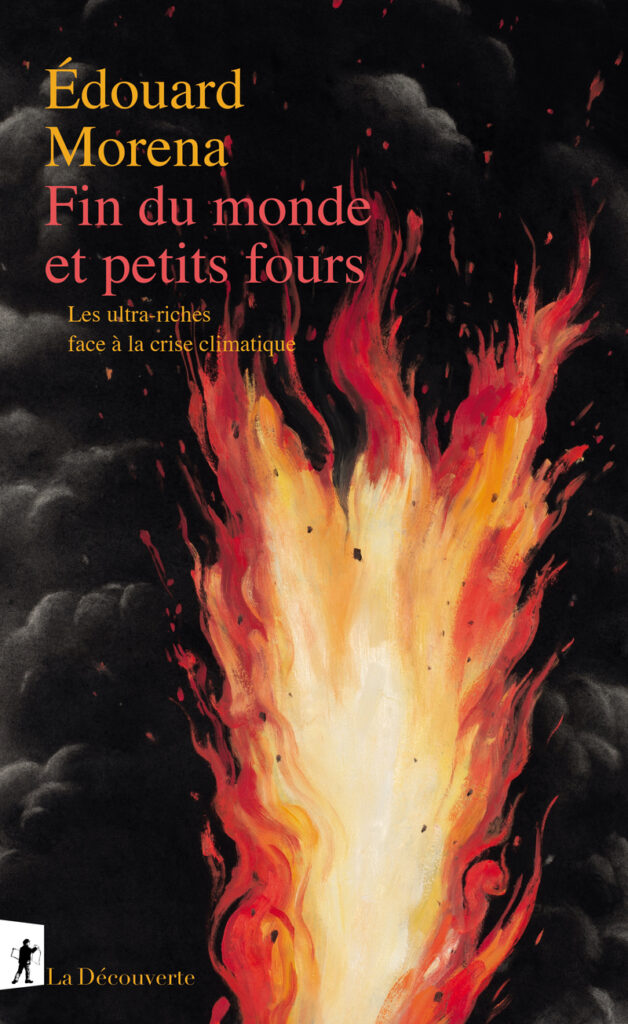
« Les élites économiques sont des acteurs clés du débat climatique international. Elles sont les promoteurs acharnés du capitalisme vert, un projet politique taillé sur mesure et qui garantit leurs intérêts de classe dans un monde en surchauffe » (Morena E, 2023aA188 ; 2023bA189).
Mais ce rideau de fumée (verte) masque les problèmes de destruction de l’environnement liés à la surexploitation de ressources et à la défiguration de territoires, qu’aucune « décarbonation » ne contribuera à résoudre.
Cette obsession du « carbone » a été extrapolée à d’autres molécules, notamment des dérivés de l’azote dont les charges critiques sont — ici encore — évaluées par des modèles mathématiques inadéquats, légitimant une politique agricole qui menace d’expropriation les paysans les moins fortunés. Pour les Pays-Bas, voir l’article Le simulacre de crise de l’azote ou l’expertocratie délirante.
Sans oublier les milliards d’euros engloutis dans des projets pharaoniques de « séquestration du carbone » (Webb D, 2023A310), ou encore de dispersion d’aérosols pour diminuer l’impact des rayons du soleil (CAMS, 2023A32 ; Koonin SE, 2021A135 p. 240–241).
François Gervais évoque le sujet qui fâche : le chiffrage de cette politique environnementale (2022A94 p. 162, 168) :
Nos ancêtres les Gaulois n’avaient qu’une crainte, que le ciel leur tombe sur la tête. Dans le passé, sécheresses ou inondations étaient attribuées à l’humeur des dieux vengeurs ou des démons. Aujourd’hui, une rhétorique instrumentalise la météo comme prétexte à un changement de paradigme énergétique, lui-même annonciateur d’un changement d’économie, donc de société. […] Faites peur à suffisamment de monde, en particulier les plus jeunes, pour leur faire croire ce que vous souhaitez qu’ils croient, et vous créerez de futurs activistes qui deviendront les fidèles zélotes de l’idéologie de la neutralité carbone au nom d’une « justice climatique ». Si Machiavel avait voulu planifier le plus grand transfert de richesse de l’Histoire, la « finance climatique » pour prétendument sauver la Terre de l’apocalypse aurait certainement été tout en haut de sa liste. […]
L’objectif de ne pas dépasser 0.5° C supplémentaire doit être comparé au coût afférent. On reprendra le chiffrage de la Banque Mondiale de 89 000 milliards de dollars d’ici 2030. Au rythme évalué selon les propres chiffres du rapport AR6 (2021N3) du GIEC de 0.07° C par décennie, on reste très loin de 0.5° C d’ici là. Si l’argent est dépensé, cela sera donc pour de toutes autres raisons que celles qui servent de prétexte. Certains en profiteront immédiatement, tous les autres seront appelés à payer sous une forme ou une autre dans un délai plus ou moins long. […]
Les pouvoirs publics ont dépensé sur le dos des contribuables des milliards pour subventionner les énergies renouvelables sans le moindre impact visible sur l’évolution du CO2. […] La variation de température, si l’on fait abstraction des pics El Niño, phénomènes naturels, reste proche de zéro depuis le protocole de Kyoto, du moins bien plus faible que les projections alarmistes.

Interrogé, en mai 2023, par un sénateur sur le coût de la « neutralité carbone en 2050 » aux États-Unis, le secrétaire adjoint du ministère de l’énergie, David Turk, a répondu « 50 milliards de dollars ». Quand le sénateur lui a demandé quel serait le bénéfice de cette opération, en termes de diminution du réchauffement, il n’a pas su que répondre. On peut en avoir une idée dans la section Réalité de « l'empreinte carbone»…
Il est regrettable toutefois — quoique prévisible — que le « climatoscepticisme » du président Trump réélu en 2024 s’appuie exclusivement sur des arguments économiques, alors qu’il aurait pu exiger au préalable un réexamen des données scientifiques dont il est question ici. Il est donc facile de lui reprocher de privilégier la fin du mois sur la fin du monde !
À la fin du vingtième siècle, les mouvements écologistes ont réhabilité le nucléaire comme solution « provisoire » jusqu’à une totale « transition » vers les énergies renouvelables. Les industriels et les décideurs politiques se frottent les mains (Topçu S, 2013A289 p. 327) :
Face à la menace climatique, et dans la lignée des nouvelles exigences de « bonne gouvernance », désormais centrée sur l’écologie et la participation du public, les organismes nucléaires inventent, à partir du milieu des années 1990, le nucléaire « vert », en parfaite contradiction avec les stigmatisations de l’écologie faites deux décennies auparavant.
« Ce n’est pas un hasard si, en France, l’un des apôtres du “catastrophisme carboné” est Jean Jouzel, ingénieur. au Commissariat à l’énergie atomique (CEA). » (Allègre C, 2010A9 p. 199)
⇪ Retour au réel
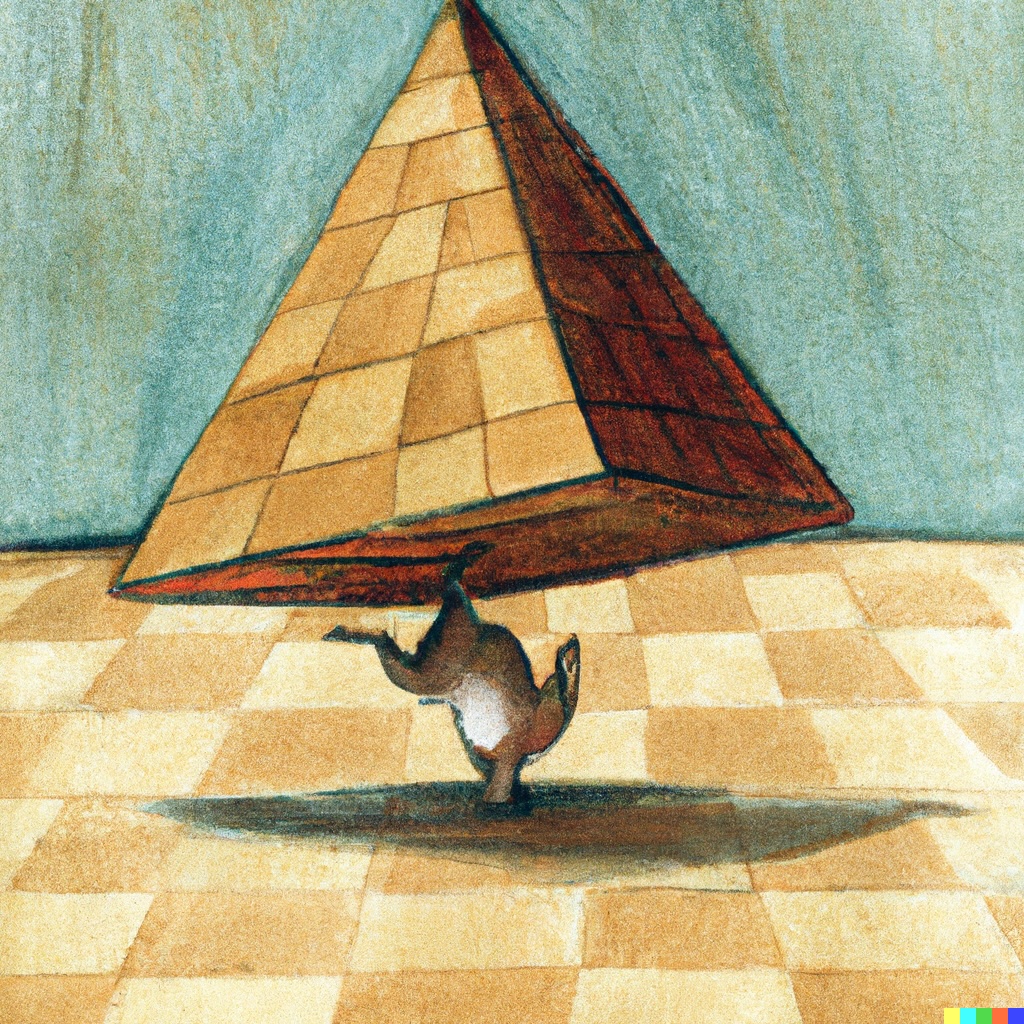
L’hypothèse d’un « effet de serre » — pour parler chic, d’un forçage radiatifN5 — causé majoritairement par le CO2 et autres molécules produites par l’activité humaine, serait-elle donc un leurre ? Ce phénomène n’a jamais été prouvé expérimentalement dans les conditions de température, pression et composition de l’air au niveau du sol (Gerlich G & RD Tscheuschner, 2009A89 ; Geuskens G, 2020A98 ; 2018A96 ; 2019A97). L’évaluation de son amplitude relève d’expériences de penséeN63 qui font débat. Mais surtout, même en accordant un crédit aux chiffres du GIEC, la part de l’activité humaine dans ce mécanisme serait négligeable, comme montré ci-dessus et dans d’autres publications (Terre et Climat, 2023A281 ; Happer W & R Lindzen, 2023A105). Si c’est le cas — nous l’avons vu dans les sections précédentes — l’évolution du climat est principalement l’effet de phénomènes « naturels » qui échappent au contrôle des humains, mais devraient bien sûr faire l’objet de mesures d’adaptation.
Oser mettre un point d’interrogation — ou de suspension — sur la composante anthropique du changement climatique équivaut à fracturer la pointe d’une pyramide érigée à l’envers. Et avec elle, la raison d’être de l’investissement monumental, financier et politique, des nations (occidentales) dans leur transition énergétique, sous la menace de procès pour « inaction climatique ».
À l’échelle continentale, l’engagement dans la « transition écologique » se matérialise par le Pacte vert (Green Deal) européen (WikipédiaN59 ; Belardo T et al., 2023A18) de 100 milliards d’euros, appuyé par le Forum Économique Mondial. Ce dernier s’est donné pour mission d’exercer une pression collective en faveur de la neutralité carbone que l’Agence internationale de l’énergie a baptisée Zéro émission nette d’ici 2050 (Schwab K & T Malleret, 2021A258 p. 82). Ces 100 milliards méritent la comparaison avec le petit milliard alloué à la protection du milieu marin (70 % de la surface planétaire)…
Pendant que le roi Charles III, de visite en France en septembre 2023, plaidait pour une nouvelle « entente franco-britannique » sur le climat et la biodiversité — considérant que « le plus grand défi de tous [est] le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature » — le Premier ministre britannique Rishi Sunak annonçait le report de plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni, disant à mi-mot que l’objectif de « neutralité carbone » en 2050 lui paraissait irréalisable… Avait-il une arrière-pensée (inavouable) concernant son utilité ?
Les médias francophones annoncent un recul de l’engouement pour le projet « Zéro émission nette », soulignant son coût économique et sociétal. La Réserve Fédérale des USA et BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, ont renoncé à cet objectif climatique après le retour de Donald Trump (Tohi W, 2025A287). Toutefois, à partir de considérations économiques, et sans émettre aucun doute sur son utilité. En Europe, tous les partis politiques se sont alignés sur un climato-alarmisme qui rallie une majorité d’électeurs (en 2024). Toute critique de cet alarmisme est taxée de « complotisme » ou « d’extrême-droite » — ce qui revient au même. Le Gieco-scepticisme trace donc sa route en dehors de la sphère politique (électoraliste).
Les incohérences et les contradictions du « zéro carbone » nous conduisent, à brève échéance, vers des lendemains de très grave précarité énergétique. François Gervais écrit (2023A95) :
Souscrivons-nous aux oukases de Novethic, affilié à la Caisse des dépôts, organisme que l’État français a missionné pour sa politique de financement de la transition écologique, reprenant entre autres les projets de lois et décrets liberticides de B&L évolution [Louis CA & G Martin, 2019A159] ?
Judith Curry écrit (2024A52 p. 462–463, 468, 469, 470 ; 2023A51 p. 297, 300–301) :
Il semble de plus en plus probable que le réchauffement climatique au cours du XXIe siècle sera loin d’être aussi marqué qu’on ne l’avait pensé auparavant ; le discours change donc pour affirmer que « les impacts seront plus graves qu’on ne l’avait jamais cru ». Ce changement de perception incite à donner la priorité à l’adaptation (portant sur les risques d’urgence) et non plus à la réduction des émissions (qui porte sur le risque incrémental, plus lent). […]
Et, finalement, il nous faut reconnaître que ce qui a été présenté comme une « crise planétaire » consiste, pour l’essentiel, en des milliers d’urgences locales, ces vulnérabilités étant révélées par les événements météorologiques extrêmes. […]
L’éviction prématurée des incertitudes de la politique climatique dominante supprime les intérêts et les besoins de communautés, de cultures et d’environnements marginalisés. Refuser de prendre en compte l’incertitude et les ambiguïtés qui entourent le changement climatique a été dépeint comme une forme invisible d’oppression excluant d’autres avenirs possibles [Scoones I & A Sterling, 2020A259].
Lorsqu’on formule une politique d’incertitude climatique, il faut rejeter la peur, considérer l’incertitude comme « une invitation à des espoirs multiples, et la reconnaissance respectueuse des différences, plutôt que des peurs singulières » [ibid.] […]
La politique de l’incertitude peut permettre de réaliser un avenir meilleur, mais elle suppose l’humilité (et non l’hubris) concernant ce que nous savons, l’espoir (et non la peur) concernant ce qui est possible, et l’acceptation d’une plus grande diversité de valeurs [Scoones I & A Sterling, 2020A259].
La « bulle climatique » finira-t-elle par exploser ? Avec quels effets ?
L’enjeu de ces questions est abyssal… Lisez les sources, ensuite commentez, corrigez, questionnez. Mais souvenez-vous : des faits, pas des opinions !
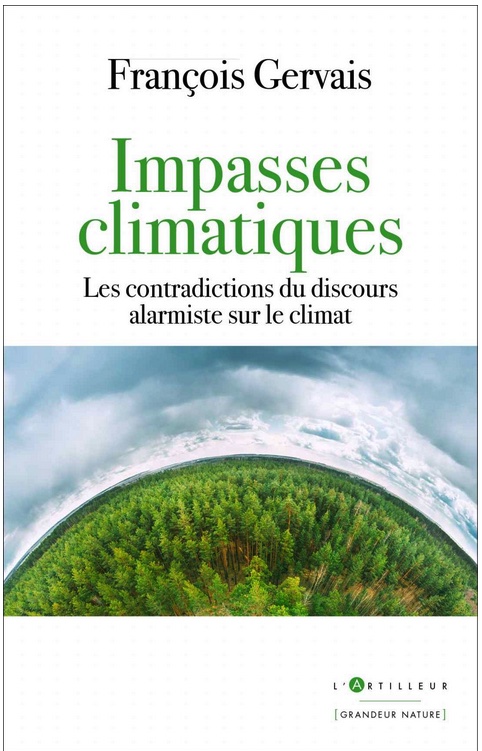
L’ouvrage Impasses climatiques (Gervais F, 2022A94) a rendu possible la rédaction de ce premier essai, de par la pertinence de ses analyses et la diversité des sources auxquelles il fait référence. J’ai été toutefois déçu par le dernier chapitre consacré aux énergies dites « propres », instruments d’une « transition énergétique » dont les chapitres précédents démontraient la précocité, si ce n’est l’inutilité… Les arguments me paraissent réduits aux éléments de langage de promoteurs (ou de détracteurs) de solutions industrielles.
Notamment (pages 245–249) lorsqu’il se fait l’avocat d’un renouveau de l’atome civil avec ce raisonnement grotesque : « Pour l’instant, le nombre total de décès dus aux accidents de centrales nucléaires civiles reste cependant très inférieur à celui lié aux ruptures de barrages [hydroélectriques]. » Tout est dans le « pour l’instant » ! Et tant pis pour la Biélorussie, victime en 1986 d’un « incident » nucléaire qui a contaminé le tiers de son territoire et rendu des centaines de milliers d’hectares de terres agricoles définitivement interdites à toute exploitation (Topçu S, 2013A289 p. 219)… Sans oublier les suites de Fukushima et le pognon de dingue englouti dans ces programmes.
François Gervais mentionne évasivement le « problème récurrent » (sic) de stockage des déchets radioactifs (p. 247), mais il fait l’impasse sur le défi technologique du démantèlement des anciennes centrales, tout en accordant un crédit à l’utilisation du thorium (OdN, 2022aA205) ou à la fusion thermonucléaire (OdN, 2022bA206).
Pour autant, il n’est pas le seul à s’égarer dans les arguments les plus éculés des nucléocrates : Patrice Poyet, Ian Clark, Judith Curry, Michel Vieillefosse, Samuel Furfari et Benoît Rittaud sont logés à la même enseigne…
⇪ ✓ Articles, ouvrages, documents
🔵 Notes pour la version papier :
- Les identifiants de liens permettent d’atteindre facilement les pages web auxquelles ils font référence.
- Pour visiter « 0bim », entrer dans un navigateur l’adresse « https://leti.lt/0bim ».
- On peut aussi consulter le serveur de liens https://leti.lt/liens et la liste des pages cibles https://leti.lt/liste.
- A1 · h49b · AP News (1989). A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels. AP News website.
- A2 · w5nn · Abelson, PH (1967). Global Weather. Editorial in Science 155, 3759 : 153.
- A3 · b36q · Akasofu, SI (2011). A Suggestion to Climate Scientists and the Intergovernmental Panel on Climate Change. EOS, Transactions American Geophysical Union 89, 11 : 108.
- A4 · v0tv · Al Gore (2007). Film “An Inconvenient Truth”
- A5 · j6bp · Al Gore (2017). Film “Une suite qui dérange”
- A6 · kl1q · Alimonti, G & L Mariani (2023). Is the number of global natural disasters increasing ? Environmental Hazards. Published online, 7 August.
- A7 · r5g9 · Alimonti, G et al. (2022). A critical assessment of extreme events trends in times of global warming. Eur. Phys. J. Plus 137 : 112. Rétracté mais republié par G Alimonti et L Mariani (2023).
- A8 · li2a · Allen, RJ & RG Anderson (2018). 21st century California drought risk linked to model fidelity of the El Niño teleconnection. npj Climate and Atmospheric Science 1, 21.
- A9 · i7f4 · Allègre, C (2010). L’imposture climatique ou la fausse écologie. Paris : Plon. ISBN 978–2‑259–20985‑4.
- A10 · nbq4 · Arezki, H (2022). FLOP26 : l’échec des négociations climatiques ou les victoires du mondialisme. Blog La Trogne.
- A11 · wd96 · Arrhenius, S (1896). On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. Philosophical Magazine and Journal of Science 5, 41 : 237–276.
- A12 · b9o5 · Bagla, P (2009). No sign yet of Himalayan meltdown, Indian report finds. Science 326, 5955 : 924–925.
- A13 · u64d · Balaji, V et al. (2022). Are general circulation models obsolete ? PNAS 119, 47 : e2202075119.
- A14 · j4z3 · Bast, D (2008). 30,000 Scientists Sign Petition on Global Warming. Opinion paper. The Hearthland Institute.
- A15 · dob7 · Bastin, G (2013). Modélisation et analyse des systèmes dynamiques. Site personnel : 216 pages.
- A16 · nj3m · Bastin, JF et al. (2017). The extent of forest in dryland biomes. Science 356, 6338 : 635–638.
- A17 · lza1 · Beenstock, M (2012). Polynomial cointegration tests of anthropogenic impact on global warming. Earth Syst. Dynam. Discuss., 3 : 561–596.
- A18 · ur5i · Belardo, T et al. (2023). Innovating for the European Green Deal. White Paper. World Economic Forum.
- A19 · ywz1 · Belaud, A (2023). Bientôt une nouvelle loi pour museler le climatoscepticisme dans les médias ? Site de l’Institut de Recherches Economiques et Fiscales.
- A20 · v4nx · Berry, EX (2019). Human CO2 Emissions Have Little Effect on Atmospheric CO2. International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences 3, 1 : 13–26.
- A21 · d4bn · Berthier, E et al. (2010). Contribution of Alaskan glaciers to sea-level rise derived from satellite imagery. Nature Geoscience 3 : 92–95.
- A22 · b6oq · Bjelle, EL et al. (2018). Climate change mitigation potential of Norwegian households and the rebound effect. Journal of Cleaner Production 172 : 208–217.
- A23 · ad4a · Blamet, P (2021). Les modèles climatiques : artefacts trompeurs ? Site Association des climato-réalistes.
- A24 · dqw0 · Boas, I et al. (2019). Climate migration myths. Nature Climate Change 9 : 901–903.
- A25 · na2d · Bock-Côté, M (2023). Proposition de loi interdisant le climatoscepticisme : la radicalisation de l’extrême centre. Le Figaro, 22 septembre.
- A26 · yu3g · Borreggine, M et al. (2023). Sea-level rise in Southwest Greenland as a contributor to Viking abandonment. PNAS 120, 17 : e2209615120.
- A27 · f5mu · Bousso, R (2021). BP gambles big on fast transition from oil to renewables. Special Report. Reuters.
- A28 · w83a · Bray, D & H von Storch (2007). Climate scientists : Perceptions of climate change science. GKSS — Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht.
- A29 · xs5j · Breiter, B et al. (2014). Revision of the EPICA Dome C CO2 record from 800 to 600 kyr before present. Geophysical Research Letters 42, 2 : 542–549.
- A30 · mkd1 · Brooker, C (2015). Farewell to the man who invented ‘climate change’. The Telegraph, 5 December.
- A31 · m37f · Brysse, K et al. (2013). Climate change prediction : Erring on the side of least drama ? Global Environmental Change 23, 1 : 327–337.
- A32 · anm3 · CAMS (2023). Aérosols : la réduction des émissions de SO₂ contribue-t-elle au réchauffement climatique ? Site Association des climato-réalistes.
- A33 · jg63 · Caillon, N et al. (2023). Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III. Science 299, 5613 : 1728–1731.
- A34 · kb9i · Chen, C et al. (2019). China and India lead in greening of the world through land-use management. Nat Sustain 2 : 122–129.
- A35 · afl3 · Christiansen, B & FC Ljungqvist (2011). The extra-tropical NH temperature in the last two millennia : reconstructions of low-frequency variability. Climate of the Past Discussions 7 : 3991–4035.
- A36 · lr4w · Christy, JR & R Spencer (2003). Global temperature report, 1978–2003. Earth System Science Center. The University of Alabama in Huntsville : 18 pages.
- A37 · d78r · Christy, JR (2016). Testimony on 2 Feb 2016 of John R. Christy, University of Alabama in Huntsville. U.S. House Committee on Science, Space & Technology : 23 pages.
- A38 · z4qa · Chylek, P et al. (2004). Global Warming and the Greenland Ice Sheet. Climatic Change 63 : 201–221.
- A39 · kg4f · Chylek, P et al. (2011). Ice-core data evidence for a prominent near 20 year time-scale of the Atlantic Multidecadal Oscillation. Geophysical Research Letters 38, 13.
- A40 · d0ky · Chylek, P et al. (2016). The role of Atlantic Multi-decadal Oscillation in the global mean temperature variability. Clim Dyn 47 : 3271–3279.
- A41 · qgf7 · Citizen Light (2025a). Corruption climatique #1. Série Les Guerres invisibles. Vidéo.
- A42 · w6u7 · Citizen Light (2025b). Corruption climatique #2. Série Les Guerres invisibles. Vidéo.
- A43 · lz1p · Clark, I (2023).A Reality Check on Climate and Net Zero. YouTube video.
- A44 · yaw3 · Clark, S (2023). Film “The Many Errors of An Inconvenient Truth”. YouTube.
- A45 · fdd9 · Clauser, J (2024). The cloud thermostat is the dominant climate controlling mechanism that stabilizes Earth’s climate ; the IPCC catastrophe narrative is a myth. Irish Climate Science Forum. Traduction de Camille Veyres (PDF).
- A46 · if3g · Cogley, JG (2011). Himalayan Glaciers in 2010 and 2035. In : Singh, V.P., Singh, P., Haritashya, U.K. (eds) Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht.
- A47 · cxa3 · Cook, J et al. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environ. Res. Lett. 8 : 024024.
- A48 · ecw4 · Courtillot, V (2009). Nouveau voyage au centre de la Terre. Paris : Odile Jacob.
- A49 · lz4n · Crok, M & A May eds. (2023). The Frozen Climate Views of the IPCC. An analysis of AR6. Site de Clintel Foundation : 172 pages.
- A50 · zll2 · Curry, JA (2021). Climate is everything. Site Climate Etc.
- A51 · vzo7 · Curry, JA (2023). Climate Uncertainty and Risk : Rethinking Our Response. London : Anthem Press.
- A52 · y3ml · Curry, JA (2024). Le changement climatique n’est plus ce qu’il était. Paris : L’Artilleur, éditions du Toucan.
- A53 · bt1h · Dagsvik, JK & SH Moen (2023). To what extent are temperature levels changing due to greenhouse gas emissions ? Discussion Papers 1007. Statistics Norway, Research Department. ISSN 1892–753X.
- A54 · txl4 · De Larminat, P (2014). Climate Change : Identification and Projections. London : Wiley-ISTE. ISBN : 978–1‑848–21777‑5.
- A55 · mv3c · De Larminat, P (2016). Earth climate identification vs. anthropic global warming attribution. Annual Reviews in Control, 42 : 114–125.
- A56 · wdm2 · deMenocal, PB et al. (2000). Coherent High- and Low-Latitude Climate Variability During the Holocene Warm Period. Science 288, 5474 : 2198–2202.
- A57 · eu6f · de Rouville, G (2024). Promenade dans les abysses écologiques : Les tribulations d’un écolo-réaliste à la COP 28 de Dubaï. Autopublication Amazon.
- A58 · g9vf · Debey, A (2024). A‑t-on encore le droit au débat sur le climat ? Site “L’Impertinent”.
- A59 · r1df · Deheuvels, P (2024). Évolution du climat – Vérités indésirables. Site de l’Association des climato-réalistes : 29 février.
- A60 · ajh2 · Derman, E (2012). Models Behaving Badly : Why Confusing Illusion with Rality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life. New York : Free Press.
- A61 · uo74 · Descroix, L (2021). Rapport “Sécheresse, désertification et reverdissement au Sahel”. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification : 19 pages.
- A62 · s7bi · Diffenbaugh, NS et al. (2015). Anthropogenic warming has increased drought risk in California. PNAS 112, 13 : 3931–3936.
- A63 · e8a7 · Donchyts, G et al. (2016). Earth’s surface water change over the past 30 years. Nature Climate Change 6 : 810–813.
- A64 · a50l · Dorian, P (2025). Arctic sea ice continues to show resiliency… nearly normal temperatures expected during the all-important summer (melting) season. Site ARCFIELD.
- A65 · zbc1 · Duran, J (2010). Présentation. Site “Pensée unique” (archive).
- A66 · ahr2 · Duran, J (2013). Une nouvelle crosse de hockey : Le manche s’allonge et se tord… Mais la crosse perd sa lame. Le (les) bonnet(s) d’âne du mois. Site “Pensée Unique” (archive)
- A67 · b550 · Durkin, M (2007). Film “The Great Global Warming Swindle”. YouTube.
- A68 · a5t8 · Durkin, M (2024). Video “Climate : The Cold Truth”. YouTube & Rumble.
- A69 · woq3 · Duvat, V (2018). A global assessment of atoll island planform changes over the past decades. WIREs Climate Change : e557.
- A70 · b1zy · Dübal, HR & F Vahrenholt (2021). Radiative energy flux variation from 2001–2020. Atmosphere 12, 10 : 1297.
- A71 · f28b · Edenhofer, O (2010). Klimaschutz als Entwicklungshilfe. Stuttgarter Zeitung. 17 septembre.
- A72 · m86v · Eisenman, I et al. (2011). Consistent Changes in the Sea Ice Seasonal Cycle in Response to Global Warming. Journal of Climate 24, 20 : 5325–5335.
- A73 · rt1t · Ekholm, N (1901). On the Variations of the Climate of the Geological and Historical Past and their Causes. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 27, 117 : 1–62.
- A74 · m13f · Elsner, JB et al. (2008). The increasing intensity of the strongest tropical cyclones. Nature 455 : 92–95.
- A75 · eg05 · Enfield, DB (2006). Projecting the risk of future climate shifts. International Journal of Climatology 26, 7 : 885–895.
- A76 · vkr6 · Essenhigh, RH (2009). Potential Dependence of Global Warming on the Residence Time (RT) in the Atmosphere of Anthropogenically Sourced Carbon Dioxide. Energy Fuels 23, 5 : 2773–2784.
- A77 · rr8l · FAO (2021.). The impact of disasters and crises on agriculture and food security, Rome.
- A78 · lp0j · Fazi, T (2023). Why the West’s elites invented a permacrisis. Site UnHeard.
- A79 · u77m · Ferry, L ed. (2011). Querelles écologiques et choix politiques. Paris : Odile Jacob.
- A80 · o6mp · Feynman, R (1974). Cargo Cult Science. Some remarks on science, pseudoscience, and learning how to not fool yourself. Caltech’s 1974 commencement address.
- A81 · k6e7 · Ford, MR & PS Kench (2015). Multi-decadal shoreline changes in response to sea level rise in the Marshall Islands. Anthropocene 11 : 14–24.
- A82 · m2ov · Formetta, G & L Feyen (2019). Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-related hazards. Global Environmental Change 57 : 101920.
- A83 · w65c · Fourier, JBJ (1824). Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires. Cambridge University Press.
- A84 · n019 · Frank, P (2024). Cenozoic Carbon Dioxide : The 66 Ma Solution. Geosciences 14, 9 : 238.
- A85 · r61s · Frederikse, T et al. (2020). The causes of sea-level rise since 1900. Nature 584 : 393–397.
- A86 · bul8 · Furfari, S (2020). L’Utopie Hydrogène. Autopublication.
- A87 · t1la · Garnier, E (2018). Le changement climatique entraîne-t-il plus de catastrophes ? Revue Risques – Les cahiers de l’assurance 115 : 19–38.
- A88 · plh7 · Gasparrini, A et al (2015). Mortality risk attributable to high and low ambient temperature : a multicountry observational study. The Lancet 386, 9991 : 369–375.
- A89 · u3qw · Gerlich, G & RD Tscheuschner (2009). Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics. International Journal of Modern Physics 23, 03 : 275–364.
- A90 · f33m · Gervais, F (2014). Tiny warming of residual anthropogenic CO2. International Journal of Modern Physics 28, 13 : 1450095.
- A91 · b9m3 · Gervais, F (2016). Anthropogenic CO2 warming challenged by 60-year cycle. Earth-Science Reviews, 155 : 129–135.
- A92 · f7fx · Gervais, F (2018). L’urgence climatique est un leurre. Paris : L’Artilleur.
- A93 · o3hw · Gervais, F (2021). Climate Sensitivity and Carbon Footprint. Science of Climate Change : 70–97.
- A94 · o85p · Gervais, F (2022). Impasses climatiques : les contradictions du discours alarmiste sur le climat. Paris : L’Artilleur.
- A95 · y7nm · Gervais, F (2023). Le déraisonnement climatique. Climat, énergie, ressources : revenir à la science pour éviter la ruine. Paris : L’Artilleur.
- A96 · hx2u · Geuskens, G (2018). Forçage radiatif, sensibilité climatique et rétroactions positives. Site Science, climat et énergie.
- A97 · lk5o · Geuskens, G (2019). Le réchauffement climatique d’origine anthropique. Site Science, climat et énergie.
- A98 · f5cw · Geuskens, G (2020). L’effet de serre et le bilan énergétique de la Terre. Site Science, climat et énergie.
- A99 · vp6n · Golyandina, N & A Zhigljavsky (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. Chapter 2, 61 p., Basic SSA. Springer, ISBN 978–3‑642–34913‑3.
- A100 · jc67 · Goosse, H et al. (2010). Introduction to climate dynamics and climate modelling. Cambridge University Press. ISBN 9781107445833.
- A101 · wer6 · Gosselin, P (2025). Wind Industry Now Destroying 1000-Year Old German Forest That Inspired Grimm Fairy Tales. Site NoTricksZone.
- A102 · r1f4 · Grudd, H (2008). Torneträsk tree-ring width and density ad 500‑2004 : a test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summer. Climate Dynamics 31 : 843–857.
- A103 · m7jb · Guo, WD et al. (2013). Earthquakes and Soil Temperature Evolution over China in Summer 1998 and Their Relation to the Severe Flood Events. Chinese Journal of Geophysics 47, 3 : 465–470.
- A104 · umh5 · Gys, E (2009). Le moulin à eau de Lorenz. Site Images des Mathématiques.
- A105 · ybt3 · Happer, W & R Lindzen (2013). Comment on the Environmental Protection Agency’s (“EPA”) Proposed Rule. U.S. Environmental Protection Agency.
- A106 · po0p · Harari, YN (2022). Sapiens : Une brève histoire de l’humanité. Paris : Albin Michel. Titre original “Sapiens : A Brief History of Humankind (2015)”. ISBN 978–2‑226–47982‑2.
- A107 · q5ng · Harde, H & ML Salby (2021). What Controls the Atmospheric CO2 Level ? Science of Climate Change : 54–69.
- A108 · iw9k · Harde, H (2017). Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere. Global and Planetary Change 152 : 19–26.
- A109 · j70o · Harde, H (2019). What Humans Contribute to Atmospheric CO2 : Comparison of Carbon Cycle Models with Observations. Earth Sciences 8, 3 : 139–159.
- A110 · oxh8 · Hausfather, Z (2014). How not to calculate temperature. Site The Blackboard, June 5.
- A111 · eeg7 · Henry, J (2024). Où la controverse des coraux qui meurent resurgit. Blog personnel : 19 mars.
- A112 · pia3 · Hille, KB (2016). Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds. NASA News and Events.
- A113 · oze8 · Hinchliffe, T (2022). ‘We own the science & the world should know it’: UN rep to WEF disinformation panel. Site The Sociable.
- A114 · v11b · Hirschler, B (2013). Davos strives to make climate talk more than hot air. Reuters.
- A115 · k55g · Holdaway, A et al. (2021). Global-scale changes in the area of atoll islands during the 21st century. Anthropocene 33 : 100282.
- A116 · o8ar · Hollande, F (2015). Discours pour l’ouverture du forum “Vers la COP 21 : la société civile mobilisée pour le climat”. Manille, 26 février.
- A117 · nf5w · Hourdin, F et al. (2017). The Art and Science of Climate Model Tuning. Bulletin of the American Meteorological Society 98, 3 : 589–602.
- A118 · d2cd · Hu, W et al. (2023). Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition. Science 381, 6661 : 979–984.
- A119 · kt9h · Huang, SP et al. (2008). A late Quaternary climate reconstruction based on borehole heat flux data, borehole temperature data, and the instrumental record. Geophysical Research Letters 35, 13 : L13703.
- A120 · la5o · Humlum, O et al. (2013). The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature. Global and Planetary Change 100 : 51–69.
- A121 · t794 · Jacob, M & CL Nass (2022). British meteorologist falsely blames climate change on sun, moon. AFP Fact Check.
- A122 · is69 · Jacoby, GC & R D’Arrigo, R (1989). Reconstructed Northern Hemisphere annual temperature since 1671 based on high-latitude tree-ring data from North America. Climatic Change 14 : 39–59.
- A123 · p0i4 · Jaeger, CC & J Jaeger (2010). Three Views of Two Degrees. Climate Change Economics 01, 03 : 145–166.
- A124 · pm57 · Jin, Q & C Wang (2017). A revival of Indian summer monsoon rainfall since 2002. Nature Clim Change 7 : 587–594.
- A125 · y425 · Joerin, UE et al. (2008). Holocene optimum events inferred from subglacial sediments at Tschierva glacier, Eastern Swiss Alps. Quaternary Science Reviews 27, 3–4 : 337–350.
- A126 · ujw5 · Kay, JE et al. (2015). The Community Earth System Model (CESM) Large Ensemble Project : A Community Resource for Studying Climate Change in the Presence of Internal Climate Variability. Bulletin of the American Meteorological Society 96, 8 : 1333–1349.
- A127 · ja1k · Kelly, MJ (2016). Trends in Extreme Weather Events since 1900 – An Enduring Conondrum for Wise Policy Advice. Journal of Geography and Natural Disasters 6, 1 : 1000155.
- A128 · l36s · Kempf, H (2023). Climatoscepticisme dans les médias : des députés planchent sur une loi. Site Reporterre.
- A129 · csv7 · King, D (2004). Global warming ‘biggest threat’. BBC News, 9 January.
- A130 · ld22 · Knutti, R et al. (2017). Beyond equilibrium climate sensitivity. Nature Geoscience 10 : 727–736.
- A131 · t2nc · Kobashi, T et al. (2009). Persistent multi-decadal Greenland temperature fluctuation through the last millennium. Climatic Change 100 : 733–756.
- A132 · w2rh · Kokabi, AR & M Génon (2003). Jean Jouzel : “Emmanuel Macron doit cesser de semer la confusion”. Site Reporterre, 25 septembre.
- A133 · c7oa · Koonin, SE (2014). Climate Science Is Not Settled. The Wall Street Journal, 19 September.
- A134 · u128 · Koonin, SE (2017). A ‘Red Team’ Exercise Would Strengthen Climate Science. The Wall Street Journal, 20 April.
- A135 · jr03 · Koonin, SE (2021). Unsettled : What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters. Dallas : BenBella Books.
- A136 · be03 · Koonin, SE (2022). Climat, la part d’incertitude. Paris : L’Artilleur.
- A137 · b0ts · Kottasová, I (2020). Oceans are warming at the same rate as if five Hiroshima bombs were dropped in every second. CNN, 13 January.
- A138 · z47o · Koutsoyiannis, D & ZW Kundzewicz (2020). Atmospheric Temperature and CO2 : Hen-or-Egg Causality ? Sci 2, 4 : 83.
- A139 · qm68 · Koutsoyiannis, D (2008). From climate certainties to climate stochastics. Special Workshop “New Statistical Tools in Hydrology”. IHP 2008 Capri Symposium : “The Role of Hydrology in Water Resources Management”. UNESCO & IAHS. Isle of Capri, Italy, 13–16 October.
- A140 · uia4 · Koutsoyiannis, D (2024). Refined Reservoir Routing (RRR) and Its Application to Atmospheric Carbon Dioxide Balance. Water 16, 17 : 2402.
- A141 · kf41 · Koutsoyiannis, D. (2024). Relative Importance of Carbon Dioxide and Water in the Greenhouse Effect : Does the Tail Wag the Dog ? Science of Climate Change 4.2 : 36–78.
- A142 · wmi5 · Koutsoyiannis, D et al. (2023). On Hens, Eggs, Temperatures and CO2 : Causal Links in Earth’s Atmosphere. Sci 5, 35. Online.
- A143 · xysb · Kritee, K et al. (2018). High nitrous oxide fluxes from rice indicate the need to manage water for both long- and short-term climate impacts. PNAS 115, 39 : 9720–9725.
- A144 · m9xo · Kuo, C et al. (1990). Coherence established between atmospheric carbon dioxide and global temperature. Nature 343 : 709–714.
- A145 · k7pm · Lamarque, P et al. (2014). Plant trait-based models identify direct and indirect effects of climate change on bundles of grassland ecosystem services. PNAS 111, 38 : 13751–13756.
- A146 · bpj1 · Le Quéré, C et al. (2021). Fossil CO2 emissions in the post-COVID-19 era. Nature Climate Change 11 : 197–199.
- A147 · i025 · Le Roy Ladurie, E (2004). Histoire humaine et comparée du climat, vol. 1 : canicules et glaciers XIIIe-XVIIIe siècles. Paris : Fayard. ISBN 2–213-61921–2.
- A148 · mq5o · Le Roy Ladurie, E (2011). Vers un désastre climatique ? Le Monde, débats, 3 décembre.
- A149 · c7me · Legates, D et al. (2015). Climate Consensus and ‘Misinformation’: A Rejoinder to Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change. Science & Education, 24 : 299–318.
- A150 · h1su · Legrand, JL (2025). Désinformation climatique dans la télévision et la radio françaises : le grand bluff de la détection automatisée. Site de l’Association des climato-réalistes.
- A151 · il5m · Leroux, M (2007). Les échanges méridiens commandent les changements climatiques. Séminaire de travail sur l’évolution du climat, Académie des sciences, Paris, 5 mars : 12 pages.
- A152 · g3yh · Lindzen, R (2006). Climate of fear. Wall Street Journal, 12 April.
- A153 · zzw8 · Lindzen, R (2018). Global Warming For The Two Cultures. London : Annual GWPF Lecture.
- A154 · rr39 · Lindzen, RS (2024). Le rôle du consensus dans les mouvements politiques se réclamant de la science. Conférence au au Mathias Corvinus Collegium, Belgique. Site de l’Association des climato-réalistes.
- A155 · g15k · Liu, Y & R Avissar (1999). A Study of Persistence in the Land–Atmosphere System with a Fourth-Order Analytical Model. Journal of Climate 12, 8 : 2154–2168.
- A156 · a5jd · Lomborg, B (2020). Welfare in the 21st century : Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change. Technological Forecasting and Social Change 156 : 119981.
- A157 · hwg8 · Lomborg, B (2024). False Alarm : How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet. New York : Basic Books.
- A158 · wg1i · Longhurst, A (2012–2015). Doubt and Certainty in Climate Science. E‑book.
- A159 · nwh5 · Louis, CA & G Martin (2019). Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? B&L évolution.
- A160 · nu4p · Luijendijk, A et al. (2018). The State of the World’s Beaches. Scientific Reports 8, Article number : 6641.
- A161 · mg3d · Lynas, M et al. (2021). Greater than 99 % consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters 16, 11.
- A162 · p0qj · Lüdecke, HJ (2016). Simple Model for the Antropogenically Forced CO2 Cycle Tested on Measured Quantities. Journal of Geography, Environment and Earth Science International 8, 4 : 1–12.
- A163 · j8rm · MD (2024). Catastrophes naturelles mondiales : état des lieux. Site de l’Association des climato-réalistes
- A164 · ze7q · MacRae, AMR (2019). The Next Great Extinction Event Will Not be Global Warming – It Will Be Global Cooling. Tropical Hot Spot Research, August.
- A165 · ob6l · Mahaney, WC et al.(2018). Reconnaissance of the Hannibalic Route in the Upper Po Valley, Italy : Correlation with Biostratigraphic Historical Archaeological Evidence in the Upper Guil Valley, France. Archaeometry 61, 1 : 242–258.
- A166 · put7 · Maréchaux, G (2024). Pourquoi le climatoscepticisme séduit-il encore ? The Conversation, 10 janvier.
- A167 · aya1 · Maslowski, W et al. (2012). The Future of Arctic Sea Ice. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40 : 625–654.
- A168 · wrg6 · Masson-Delmotte, V (2018). Global Warming of 1.5°C. IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. Cambridge University Press.
- A169 · zmo0 · Masson, H (2019). La science classique s’arrête où commence le chaos… Site Science, climat et énergie.
- A170 · s94q · Masson, H (2023). Mathématiquement, le GIEC a tout faux ! Site Science, climat et énergie.
- A171 · hbe6 · Mathieu, A, & C Veyres (2021). Enquête sur l’urgence climatique. Site de l’Institut de Recherches Economiques et Fiscales : 36 pages.
- A172 · ttc1 · Mauritsen, T & E Roeckner (2020). Tuning the MPI-ESM1.2 Global Climate Model to Improve the Match With Instrumental Record Warming by Lowering Its Climate Sensitivity. Journal of Advances in Modeling Earth Systems 12, 5 : e2019MS002037.
- A173 · sz0t · May, A (2020). Politics and Climate Change : a History. American Freedom Publications LLC. ISBN 978–1636252629.
- A174 · tq6g · Mayewski, PA et al. (1993). Greenland ice core ‘signal’ characteristics – An expanded view of climate change. Journal of Geophysical Research Atmospheres 981 : D7 : 12839–12847.
- A175 · kdu0 · McIntyre, S & R McKitrick (2003). Corrections to the Mann et. al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemispheric Average Temperature Series. Energy & Environment 14, 6 : 751–771.
- A176 · y0m4 · McIntyre, S & R McKitrick (2005). Hockey sticks, principal components, and spurious significance. Geographical Research Letters 32, 3 : L03710.
- A177 · y13v · McIntyre, S (2010). Climategate : A Battlefield Perspective. Annotated Notes for Presentation to Heartland Conference, Chicago : 21 pages.
- A178 · mor6 · McIntyre, S (2023). Discovery of Data for One of the ‘Other 26’ Jacoby Series. Site Climate Audit : 12 December.
- A179 · leb1 · McKitrick, R & J Christy (2020). Pervasive Warming Bias in CMIP6 Tropospheric Layers. Earth and Space Science 7, 9 : e2020EA001281.
- A180 · l25u · McKitrick, R (2011). What is Wrong With the IPCC ? Proposals for a Radical Reform. ISBN 978–0‑9566875–4‑8.
- A181 · hc9y · Mears, CA & FJ Wentz (2017). A Satellite-Derived Lower-Tropospheric Atmospheric Temperature Dataset Using an Optimized Adjustment for Diurnal Effects. Journal of Climate 30, 19 : 7695–7718.
- A182 · r6nz · Minobe, S et al. (2025). Global and regional drivers for exceptional climate extremes in 2023–2024 : beyond the new normal. NPJ Clim Atmos Sci 8, 138.
- A183 · j64c · Mora, C et al. (2017). Global risk of deadly heat. Nature Climate Change 7 : 501–506.
- A184 · nx80 · Moranne, JM (2024a). La Physique du climat. Oubliez l’“Effet de Serre” et revenez aux fondamentaux. Annexes techniques de Camille Veyres. Ouvrage en ligne.
- A185 · a71r · Moranne, JM (2024b). Climat et CO2 : décryptage d’une manipulation. Comment transformer un optimum climatique en catastrophe économique. Bookelis. ISBN 979–10-424‑2928‑7
- A186 · o20h · Morano, M (2010). More Than 1000 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims. Climate Depot, CFACT : 321 pages.
- A187 · onn3 · Morel, P (2009). Réchauffement planétaire et science du climat. Conférence au Bureau des Longitudes, 7 octobre.
- A188 · g5ue · Morena, E (2023a). Vidéo “La transition bas-carbone doit profiter au plus grand nombre”. France 24 : YouTube.
- A189 · ke24 · Morena, E (2023b). Fin du monde et petits fours. Paris : La Découverte.
- A190 · por0 · Mullineaux, J (2024). Eva Morel, de QuotaClimat : “CNews est l’emblème de la polarisation de l’opinion”. Site Vert.
- A191 · l0x6 · Munshi, J (2017). Responsiveness of Atmospheric CO2 to Fossil Fuel Emissions : Updated (July 5, 2017). Available at SSRN.
- A192 · k7hv · Myhre, G et al. (1998). New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases. Geophysical Research Letters 25, 14 : 2715–2718.
- A193 · k0vv · Myhre, G et al. (2013). Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. Chapter 8, In “Climate Change 2013 : The Physical Science Basis”. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- A194 · r93q · Mörner, NA (1969). The late Quaternary history of the Kattegatt Sea and the Swedish West Coast. Sveriges geologiska undersökning.
- A195 · mw5k · Mörner, NA (1971). Eustatic changes during the last 20,000 years and a method of separating the isostatic and eustatic factors in an uplifted area. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 9, 3 : 153–181.
- A196 · u8lb · Mörner, NA (2015). Glacial Isostasy : Regional — Not Global. International Journal of Geosciences 6 : 577–592.
- A197 · wp9g · Mörner, NA (2016). Sea Level Changes as Observed in Nature. Evidence-Based Climate Science (Second Edition). Data Opposing CO2 Emissions as the Primary Source of Global Warming : 215–229.
- A198 · zqj3 · N, Jean (2023). Des éditeurs corrompus par des scientifiques sans scrupules. Site Science, climat, énergie.
- A199 · m8h9 · Nakamura, M (2018). Confessions of a climate scientist : The global warming hypothesis is an unproven hypothesis. Édition Kindle en japonais.
- A200 · wyg9 · National Research Council (2015). Climate Intervention : Reflecting Sunlight to Cool Earth. National Academies Press.
- A201 · kxp5 · Nations Unies (1992). Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (texte). Site United Nations Climate Change.
- A202 · a4l7 · Nerini, FF et al. (2021). Personal carbon allowances revisited. Nature Sustainability 4 : 1025–1031.
- A203 · anh4 · Nikolov, N & KF Zeller (2024). Roles of Earth’s Albedo Variations and Top-of-the-Atmosphere Energy Imbalance in Recent Warming : New Insights from Satellite and Surface Observations. Geomatics 4, 3 : 311–341.
- A204 · oh2y · Nussbaumer, SU (2011). Alpine climate during the Holocene : a comparison between records of glaciers, lake sediments and solar activity. Journal of Quaternary Science 26, 7 : 703–713.
- A205 · f0yc · OdN (2022a). La fable des réacteurs “au THORIUM”. Site Observatoire du Nucléaire.
- A206 · x63x · OdN (2022b). Fusion nucléaire : une énième “avancée décisive” pour abuser les gogos… et décrocher de nouveaux budgets. Site Observatoire du Nucléaire.
- A207 · c0s1 · Ollila, A. (2014). The potency of carbon dioxide (CO2) as a greenhouse gas. Development in Earth Science 2 : 20–30.
- A208 · o9cf · Oreskes, N & ZM Conway (2011). Merchants of Doubt. New York : Bloomsbury.
- A209 · e4uk · Park, J (2009). A re-evaluation of the coherence between global-average atmospheric CO2 and temperatures at interannual time scales. Geophysical Research Letters 36, L22704.
- A210 · i45p · Parker, A & CD Ollier (2015). Discussion of Foster & Brown’s Time and Tide : Analysis of Sea Level Time Series. Physical Science International Journal 6, 2 : 119–130.
- A211 · p26v · Parrenin, F et al. (2013). Synchronous Change of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature During the Last Deglacial Warming. Science 339, 6123 : 1060–1063.
- A212 · mw6g · Pausata, FSR et al. (2020). The Greening of the Sahara : Past Changes and Future Implications. One Earth 2, 3 : 235–250.
- A213 · gv6y · Peccei, A (1969). Extrait de “A. Tidal Wave to Global Problems”, in “The Chasm Ahead”. London : The McMillan Company.
- A214 · i8qw · Petit, JR et al. (1999). Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core. Nature 399 : 429–436.
- A215 · i68u · Phillips, NA (1956). The general circulation of the atmosphere : A numerical experiment. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 82, 352 : 123–164.
- A216 · x8b0 · Pielke Jr, R (2014). Disasters Cost More Than Ever — But Not Because of Climate Change. Site FiveThirtyEight : 19 March.
- A217 · bvz8 · Pierrehumbert, R (2014). Climate Science Is Settled Enough. Slate, October 1.
- A218 · qp21 · Pont, JC (2020). “Confessions d’un climatologue : l’hypothèse du réchauffement climatique est une hypothèse non prouvée”. Lettre d’information sur le climat n°13. Site de l’Association des climato-réalistes.
- A219 · ppk1 · Poorter, L et al. (2016). Biomass resilience of neotropical secondary forests. Nature 530 : 211–214.
- A220 · jaa6 · Pottier, A (2021). La carte carbone peut-elle être simple, efficace et juste ? IGDPE Editions.
- A221 · ky5g · Poyet, P (2022). The Rational Climate e‑Book (2nd Edition) (2.31) [Computer software]. Zenodo. e‑ISBN 978–99957‑1–929‑6
- A222 · gu3w · Prud’homme, R (2024). Transition écologique : le coût des rêves. Paris : L’Artilleur, éditions du Toucan.
- A223 · oup5 · Prud’homme, R (2025). Coût des catastrophes naturelles : un mensonge de plus. Site Association des climato-réalistes.
- A224 · p7fd · Quirk, T (2009). Sources and Sinks of Carbon Dioxide. Energy & Environment 20, 1 : 105–121.
- A225 · ty4q · Raina, VK (2009). Himalayan glaciers : A state-of-art review of glacial studies, glacial retreat and climate change. Ministry of Environment and Forests, Government of India (MoEF).
- A226 · va2d · Raina, VK (2012). Global Warming and the Glacier Retreat : An Overview. In : Sinha, R., Ravindra, R. (eds) Earth System Processes and Disaster Management. Society of Earth Scientists Series. Springer, Berlin, Heidelberg : 9–23.
- A227 · pib3 · Rasool, SI & SH Schneider (1971). Atmospheric carbon dioxide and aerosols : effects of large increases on global climate. Science 173, 3992 : 138–141.
- A228 · c11t · Reiter, P (2005). Memorandum : The IPCC and technical information, example : Impacts on Human Health. Select Committee on Economic Affairs for the House of Lords.
- A229 · pw9b · Reporterre (2023). Le pionnier de l’histoire du climat Emmanuel Le Roy Ladurie est mort. Article en ligne, 23 novembre.
- A230 · pv24 · Richard, K (2020). Wild Horses And Mammoths Were Still Eating Grass Year-Round In The Arctic Until 2500–4000 Years Ago. NoTrickZone, August 31. Site NoTricksZone.
- A231 · ys39 · Richardson, V (2019). Susan Crockford fired after finding polar bears thriving despite climate change. The Washington Times : October 20.
- A232 · x9pm · Richet, P (2021). The temperature – CO2 climate connection : an epistemological reappraisal of ice-core messages. History of Geo- and Space Sciences 12 : 97–110. (Removed)
- A233 · yqi5 · Rittaud, B (2010). Le mythe climatique. Paris : éd. du Seuil. ISBN 978–2021011326.
- A234 · zr4t · Rittaud, B (2015). La peur exponentielle. Paris : Presses Universitaires de France. ISBN 978–2130633693.
- A235 · klj4 · Rittaud, B (2019). Débat entre Chloé Nabédian et Benoît Rittaud sur Sud Radio. Site Association des climato-réalistes.
- A236 · f9pi · Rittaud, B (2022). La seule urgence sur le climat est de cesser d’en avoir peur. Site Association des climato-réalistes.
- A237 · l08r · Rittaud, B (2023a). Arctique, encore une mauvaise bonne nouvelle. Site Association des climato-réalistes.
- A238 · n95z · Rittaud, B (2023b). Mythes et légendes écologistes. Paris : L’Artilleur. ISBN 978–2‑81001–181‑0.
- A239 · srl3 · SCM (2015). La lutte contre le Réchauffement Climatique : une croisade absurde, coûteuse et inutile. Livre Blanc rédigé par la Société de Calcul Mathématique SA.
- A240 · l5p9 · Salby, ML (2012). Physics of the Atmosphere and Climate. Cambridge University Press. ISBN 978–0521767187.
- A241 · k8af · Sarewitz, D (2017). Stop treating science denial like a disease. The Guardian.
- A242 · qa6z · Sargent, F (1967). Taming the Weather. Scientist and citizen 9, 5 : 81–88.
- A243 · kie3 · Satija, N et al. (2017). Hurricane Harvey And The New Normal. Science Friday, 9 January.
- A244 · bon1 · Scafetta, N (2009). Empirical analysis of the solar contribution to global mean air surface temperature change. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 71 : 1916–1923.
- A245 · jqr4 · Scafetta, N (2012). Testing an astronomically based decadal-scale empirical harmonic climate model versus the IPCC (2007) general circulation climate models. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 80 : 124–137.
- A246 · qc23 · Scafetta, N (2013). Discussion on climate oscillations : CMIP5 general circulation models versus a semi-empirical harmonic model based on astronomical cycles. Earth-Sci. 126 : 321–357.
- A247 · qm64 · Scafetta, N (2021a). Reconstruction of the Interannual to Millennial Scale Patterns of the Global Surface Temperature. Atmosphere 12, 2 : 147.
- A248 · x9eu · Scafetta, N (2021b). Reconstitution des caractéristiques des variations de la température moyenne de surface du globe aux échelles de temps allant de l’année au millénaire. Traduction par Camille Veyres de (Scafetta N, 2021a). Site de l’Association des climato-réalistes.
- A249 · guh2 · Scafetta, N (2021c). Testing the CMIP6 GCM Simulations versus Surface Temperature Records from 1980–1990 to 2011–2021 : High ECS Is Not Supported. Climate 9, 11 : 161.
- A250 · ntt8 · Scafetta, N (2023). Impacts and risks of “realistic” global warming projections for the 21st-century. Geoscience Frontiers 15, 2 : 101774.
- A251 · s5vv · Scafetta, N et al. (2020). A 60-Year Cycle in the Meteorite Fall Frequency Suggests a Possible Interplanetary Dust Forcing of the Earth’s Climate Driven by Planetary Oscillations. Geophysical Research Letter 47, 18 : e2020GL089954.
- A252 · p39v · Schlesinger, ME & N Ramankutty (1994). An oscillation in the global climate system of period 65–70 years. Nature 367 : 723–726.
- A253 · vb79 · Schmidt, G (2024). Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory. Nature 627 : 467.
- A254 · g1ie · Schneider, SH (1989). The Greenhouse Effect Science and Policy. Science 243, 4892 : 771–781.
- A255 · k4pk · Schneider, SH (2011). The Roles of Citizens, Journalists, and Scientists in Debunking Climate Change Myths. Site ClimateChange.net.
- A256 · lkv9 · Schneider, T et al. (2017). Climate goals and computing the future of clouds. Nature Climate Change 7 : 3–5.
- A257 · dkk9 · Schoeberl, ML et al. (2023). The Estimated Climate Impact of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Eruption Plume. Geophysical Research Letters 50, 18 : e2023GL104634.
- A258 · tt6z · Schwab, K & T Malleret (2022). Le Grand récit : Pour un avenir meilleur. Forum Publishing.
- A259 · k5ki · Scoones, I & A Sterling (2020). The Politics of Uncertainty Challenges of Transformation. Boca Raton : Routledge.
- A260 · ss57 · Segalstad, T (1998). Carbon cycle modelling and the residence time of natural and anthropogenic atmospheric CO2 : on the construction of the “Greenhouse Effect Global Warming” dogma. In Bate, R (ed.), Global warming : the continuing debate. Cambridge (UK) : European Science and Environment Forum (ESEF).
- A261 · a5sa · Severinghaus, J (2004). What does the lag of CO2 behind temperature in ice cores tell us about global warming ? Site RealClimate.
- A262 · hd6p · Shahid, SB et al. (2024). 32 years of changes in river paths and coastal landscape in Bangladesh, Bengal Basin. J. Sediment. Environ. Published online.
- A263 · dzn5 · Sidiropoulos, M (2019). Demarcation Aspects of Global Warming Theory. Online preprint : 15 pages. (Preprint)
- A264 · r18x · Simpson, IR et al. (2024). Observed humidity trends in dry regions contradict climate models. Proc Natl Acad Sci USA 121, 1 : e2302480120.
- A265 · ci4q · Smith, B (2023). Le Club de Rome : comment l’hystérie climatique est utilisée pour créer une gouvernance mondiale. Site Géopolitique Profonde.
- A266 · z58x · Société de géographie (2010). À propos de l’étude de « The Lancet » sur l’excès de mortalité imputable au réchauffement climatique. Reprise d’un communiqué de l’Association des Climato-Réalistes, 7 décembre.
- A267 · m3y8 · Soon, W et al. (2023). The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors : Challenges of Inadequate Data. Climate 11, 9 : 179.
- A268 · bl2w · Spencer, RW (2007). How Serious is the Global Warming Threat ? Society 44 : 45–50.
- A269 · qi25 · Spencer, RW (2016). A Guide to Understanding Global Temperature Data. Texas Public Policy Foundation : 22 pages.
- A270 · l2un · Spencer, RW (2024). Global Warming : Observations vs. Climate Models. Backgrounder 3809, January.
- A271 · jm83 · Spencer, RW et al. (2017). UAH Version 6 global satellite temperature products : Methodology and results. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences 53 : 121–130.
- A272 · ev9f · Springer Nature (2024). Who is legally responsible for climate harms ? The world’s top court will now decide. Nature editorial, 13 August.
- A273 · i0ox · Stainforth, DA et al. (2005). Uncertainty in predictions of the climate responses to rising levels of greenhouse gases, Nature 433 : 403–406.
- A274 · ex76 · Stallinga, P (2020). Comprehensive Analytical Study of the Greenhouse Effect of the Atmosphere. Atmospheric and Climate Sciences, 10 : 40–80.
- A275 · ley5 · Stéfanon, M (2012). Heat waves and droughts in Mediterranean : contributions of land-atmosphere coupled processes on mesoscale. Thèse préparée au Laboratoire de Météorologie Dynamique, Institut Pierre Simon Laplace, 123 pages.
- A276 · j22r · Sunstein, CR & A Verneule (2009). Conspiracy Theories : Causes and Cures. The Journal of Political Philosophy 17, 2 : 202–227.
- A277 · r6tl · Supran, G & N Oreskes (2017). Assessing ExxonMobil’s climate change communications (1977–2014). Environmental Research Letters 12, 8 : 084019.
- A278 · mcr0 · Svensmark, H & E Friis-Christensen (1997). Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage—a missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 59, 11 : 1225–1232.
- A279 · p7ru · Svensmark, H (2012). Evidence of nearby supernovae affecting life on Earth. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 423, 2 : 1234–1253.
- A280 · n73i · Svensmark, H et al. (2021). Atmospheric ionization and cloud radiative forcing. Sci Rep 11 : 19668.
- A281 · hmw5 · Terre et Climat (2023). Le consensus scientifique sur le rôle néfaste du CO2 n’existe pas. Site La question climatique.
- A282 · pu7u · Thomas, T (2019). A Climate Modeller Spills the Beans. Quadrant on line, 23 septembre.
- A283 · b61t · Thomas, T (2023a). How Science is done these days. Quadrant Online, 22 August. Voir traduction : Toni Thomas (2023b).
- A284 · sol6 · Thomas, T (2023b). Comment de nos jours on fait de la science. Traduction par Camille Veyres de “How Science is done these days” (Thomas T, 2023a). Site de l’Association des climato-réalistes.
- A285 · b5hr · Thompson, PR et al. (2016). Are long tide gauge records in the wrong place to measure global mean sea level rise ? Geophysical Research Letters 43, 19 : 10, 403–10, 411.
- A286 · r6lh · Thunberg, G (2019). Listen to the science’. Greta Thunberg tells Congress video. Guardian News.
- A287 · ek7y · Tohi, W (2025). Federal Reserve, BlackRock retreat from climate coalitions as economic realities take precedence. Site Climate.news.
- A288 · n6gk · Tol, RSJ (2016). Comment on “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature”. Environ. Res. Lett. 11 : 048001
- A289 · jb5t · Topçu, S (2013). La France nucléaire : l’art de gouverner une technologie contestée. Paris : éditions du Seuil.
- A290 · l2fh · Tracinsky, R (2019). Why I Don’t “Believe” in “Science”. Site The Bulwark.
- A291 · c00o · Troude, M (21 août 2024). La température de l’océan Atlantique équatorial baisse à une vitesse record. Slate.
- A292 · wth3 · Tyndall, J (1871). Contributions to Molecular Physics in the Domain of Radiant Heat. London : Longmans, Green, and co.
- A293 · y73a · UNDRR (2020). The human cost of disasters : an overview of the last 20 years (2000–2019). Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- A294 · s8qc · UNDRR (2022). Global assessment report on disaster risk reduction (GAR). Our World at Risk : Transforming Governance for a Resilient Future.
- A295 · jms4 · Van Vliet, J (2023). Pourquoi l’effet du CO2 sur le climat est exclu par la physique. Site Science, climat et énergie.
- A296 · d8os · Van Vliet-Lanoë, B & J Van Vliet (2022a). Changements météorologiques et changement climatique : un refroidissement en marche sur l’Atlantique Nord (1/2). Site Science, climat et énergie.
- A297 · cc6s · Van Vliet-Lanoë, B & J Van Vliet (2022b). Les Anticyclones Mobiles Polaires ou AMP, mécanismes logiques de forçage de la météo (2/2). Site Science, climat et énergie.
- A298 · u940 · Van Wyk de Vries, M et al.(2017). A new volcanic province : an inventory of subglacial volcanoes in West Antarctica. Geological Society of London 461, 1 : 231–247.
- A299 · r62i · Veyres, C & JC Maurin (2022). Pour revisiter le cycle du carbone. Travail en cours, version révisée en communication personnelle.
- A300 · j9ur · Veyres, C (2019a). N’ayez pas peur ! Onze faits démontrent qu’il n’y a pas et qu’il ne saurait y avoir de réchauffement climatique dû aux combustibles fossiles. Site de Camille Veyres.
- A301 · rcg4 · Veyres, C (2019b). Réponses à des Questions Fréquemment Posées (FAQ). Site de Camille Veyres.
- A302 · h4zx · Veyres, C (2020a). Sur la preuve de fautes intentionnelles. Site de Camille Veyres.
- A303 · lr9i · Veyres, C (2023). Faits et fables. Annexe de La physique du climat, à l’usage de ceux qui aiment comprendre. Site de Camille Veyres.
- A304 · cc37 · Vieillefosse, M (2022). Réchauffement climatique, une affaire entre la Nature et l’Homme. Paris : L’Harmattan.
- A305 · b91g · Voosen, P (2016). Climate scientists open up their black boxes to scrutiny. Science 354, 6311 : 401–402.
- A306 · d4px · WEF (2022). Global Risks Report 2022. World Economic Forum.
- A307 · zw0z · WRM (2024). Les plantations d’arbres destinées au marché du carbone. Pourquoi, comment et où se développent-elles ? Note d’information, Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales.
- A308 · nkw8 · Walter, C (2013). Written evidence submitted by Christopher Walter Viscount Monckton of Brenchley (IPCC0005).
- A309 · ez9n · Watts, N et al. (2020). The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change : responding to converging crises. The Lancet 397, 10269 : 129–170.
- A310 · uqz9 · Webb, D (2023). Achieving net zero : Why costs of direct air capture need to drop for large-scale adoption. Opinion Paper. World Economic Forum.
- A311 · vj0y · Wei, HZ et al. (2021). Evolution of paleo-climate and seawater pH from the late Permian to postindustrial periods recorded by boron isotopes and B/Ca in biogenic carbonates. Earth-Science Reviews 215 : 103546.
- A312 · sn0c · Weisheimer, A et al. (2011). On the predictability of the extreme summer 2003 over Europe. Geophysical Research Letters, 38, 5 : L05704.
- A313 · u4no · Whetter, D (2023). I got a vasectomy due to climate grief. Now, I’m compelled to let go of my backup plan. CBC News, 6 décembre.
- A314 · fe0f · Wikipedia (2023). Tuvalu : Diminution de la surface des îles par la montée des eaux.
- A315 · ff6a · Wilson, CL & WH Matthews, eds. (1971). Inadvertent Climate Modification. Report of Conference, Study of Man’s Impact on Climate (SMIC), Stockholm. Cambridge, MA : MIT Press. ISBN 978–0262191012.
- A316 · o3o9 · Winton, M (2011). Do Climate Models Underestimate the Sensitivity of Northern Hemisphere Sea Ice Cover ? Journal of Climate 24, 15 : 3924–3934.
- A317 · b0zl · Yau, AN et al. (2016). Reconstructing the last interglacial at Summit, Greenland : Insights from GISP2. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113, 35 : 9710–9715,
- A318 · e5qb · Zeitvogel, K (2011). 50 million ‘environmental refugees’ by 2020, experts say. Phys. Org. 22 février.
- A319 · vm5m · Zeng, N et al. (2005). Terrestrial mechanisms of interannual CO2 variability. Global Biogeochemical Cycles 19, 1 : GB1016.
- A320 · u4r2 · Zhao, B et al. (2022). Prolonged drying trend coincident with the demise of Norse settlement in southern Greenland. Science Advances 8, 12.
- A321 · b07t · Zhou, Y et al. (2023). Some Statistical Characteristics of “Geothermal Vortex” in China from 1980 to 2017. PREPRINT (Version 1) available at Research Square.
- A322 · rv7s · Zhu, J et al. (2020). High climate sensitivity in CMIP6 model not supported by paleoclimate. Nature Climate Change 10 : 378–379.
- A323 · y35k · Zhu, J et al. (2021). Assessment of Equilibrium Climate Sensitivity of the Community Earth System Model Version 2 Through Simulation of the Last Glacial Maximum. Geophysical Research Letters 48, 3 : e2020GL091220.
⇪ ▷ Liens
- N1 · i5rs · Dissonance cognitive – Wikipedia
- N2 · ja6i · Argument d’autorité – Wikipedia
- N3 · xt4q · Sixth Assessment Report – IPCC
- N4 · abs3 · Providing the facts about CO2 and climate change – CO2 Coalition
- N5 · w7wd · Forçage radiatif – Wikipedia
- N6 · q0f1 · AR4 Climate Change 2007 : Synthesis Report (IPCC/GIEC)
- N7 · xc27 · Bilan carbone – Wikipedia
- N8 · dky1 · Taxe carbone – Wikipedia
- N9 · z4iv · Bourse du carbone – quotas – Wikipedia
- N10 · 6hea · Protoxyde d’azote – Wikipedia
- N11 · sijz · Alternate wetting and drying – Wikipedia
- N12 · iz0f · Modèle de circulation générale – Wikipedia
- N13 · ec6h · Troposphère – Wikipedia
- N14 · ck8p · Circulation thermohaline – Wikipedia
- N15 · tjv8 · Jet stream – Wikipedia
- N16 · t2u5 · El Niño (ENSO) – Wikipedia
- N17 · c6ne · La Niña (météorologie) – Wikipedia
- N18 · d04a · Graphique en crosse de hockey – Wikipedia
- N19 · hnf7 · Coefficient of determination – Wikipedia
- N20 · a3ff · Oscillation atlantique multidécennale – Wikipedia
- N21 · vqg0 · Oscillation décennale du Pacifique – Wikipedia
- N22 · nw53 · HadCRUT – Wikipedia
- N23 · s1x4 · Climate Change Impacts in the United States : The Third National Climate Assessment
- N24 · q0ht · Îlot de chaleur urbain – Wikipedia
- N25 · d7mu · Site “UAH Global Temperature Report” – Roy Spencer
- N26 · nt0p · Climate Science Special Report : Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I
- N27 · z325 · Annual 2022 Tornadoes Report
- N28 · bu2j · Sensibilité climatique à l’équilibre – Wikipedia
- N29 · f5i1 · Albédo – Wikipedia
- N30 · a2ol · Trajectoires socio-économiques partagées – Wikipedia
- N31 · t0ck · Sensibilité climatique – Wikipedia
- N32 · u06r · Identification de système – Wikipedia
- N33 · iy8m · Filtre de Kalman – Wikipedia
- N34 · hvp4 · Cycles de Milankovitch – Wikipedia
- N35 · moh7 · Rapport “Parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050”
- N36 · x6f7 · Climategate (Conservapedia)
- N37 · of96 · Tides and Currents – NOAA
- N38 · s7az · Marine ice sheet instability
- N39 · nn6d · IPCC AR6 Sea Level Projection Tool
- N40 · vg8f · Subsidience (géologie) – Wikipedia
- N41 · ihn0 · Pléistocène – Wikipedia
- N42 · g13b · Erik le Rouge – Wikipedia
- N43 · o1ux · Isostatic depression – Wikipedia
- N44 · f669 · Lithosphère – Wikipedia
- N45 · a54a · Inlandsis – Wikipedia
- N46 · rz7f · Arctic Sea Ice News and Analysis
- N47 · mrb7 · Northern Hemisphere Extent Anomalies August 1979 – 2023
- N48 · pm8t · Southern Hemisphere Extent Anomalies August 1979 – 2023
- N49 · v583 · Holothurie – Wikipedia
- N50 · nw64 · Jour de la Terre
- N51 · nv1g · Événement météorologique extrême – Wikipedia
- N52 · sa3a · EM-DAT – The international disaster database
- N53 · d5if · Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)
- N54 · z69w · Segmented regression – Wikipedia
- N55 · r73p · Superficie forestière brûlée et nombre d’incendies (Canada)
- N56 · p74c · Global Warming Petition Project
- N57 · p7k0 · There is no climate emergency (Il n’y a pas d’urgence climatique) – World Climate Declaration
- N58 · b6ls · Métavers – Wikipedia
- N59 · nb1o · Pacte vert pour l’Europe (European Green deal) – Wikipedia
- N60 · mpi3 · The Great Reset (2020). La Grande réinitialisation (The Great Reset) – Wikipedia
- N61 · h1t3 · Forum économique mondial – Wikipedia
- N62 · q1yu · Convention Citoyenne pour le climat (2019–2020)
- N63 · v3zt · Expérience de pensée – Wikipedia
Article créé le 28/08/2023 - modifié le 28/06/2025 à 15h43






 4318
4318


3 thoughts on “Discours sur le climat”